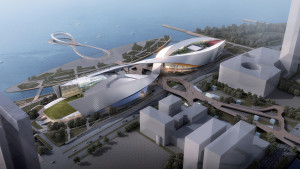Kirill Karabits, chef principal du Bournemouth Symphony
Orchestra, a enregistré une intégrale des symphonies de Serge
Prokofiev. Alors que le monde de la musique s’apprête à fêter les
125 ans de la naissance du compositeur russe, le chef d’orchestre
ukrainien nous parle de sa fascination pour Prokofiev.

Que vous inspirent
les symphonies de
Prokofiev ?
Je pense que ses sept
symphonies sont des
chefs d’œuvre,
chacune à leur
manière. Elles sont
toutes différentes et
représentent les nombreuses facettes du talent si divers de
Prokofiev. Certaines d’entre elles, comme la première et la
cinquième sont les plus représentatives de ce talent. D’autres, en
revanche, comme la sixième et la septième nécessitent une
interprétation et une écoute plus délicates.
Quelle est la place de ces symphonies dans le répertoire du
20e siècle ?
Elles constituent toutes des pièces importantes dans le répertoire
au même titre que les symphonies de Chostakovitch, à la différence
près que ce dernier était un réaliste et décrivait sans détour un
sentiment et une émotion. Avec Prokofiev, c’est différent. Il a
conféré à sa musique un esprit où règne la liberté humaine,
regardant vers l’avenir plutôt que de montrer la tristesse comme en
témoigne sa vision de la commémoration des victimes de la seconde
guerre mondiale.
Quel a été votre objectif lorsque vous avez décidé d’enregistrer ces
symphonies avec le Bournemouth Symphony Orchestra ?
Ma motivation première a été de populariser ses symphonies les
moins connues et de mettre l’accent sur les œuvres de jeunesse que
Prokofiev composa lorsqu’il vécut en Ukraine avant 1910.
On a souvent parlé de la première symphonie, composée il y un
siècle tout juste, comme d’une symphonie néoclassique. Or, il a
abandonné son néoclassicisme dans les symphonies suivantes.
Qu’en pensez-vous ?
Le langage musical que Prokofiev développa à travers ses
symphonies, son utilisation des instruments et des couleurs de
l’orchestre devinrent de plus en plus perfectionnés. Cependant, les
modèles et les prouesses contenus dans la première symphonie se
retrouvent dans ses symphonies ultérieures. En fait, je dirais que
toute sa musique est néoclassique.
Prokofiev, symphonies 1-7,
Bournemouth Symphony Orchestra,
dir. Kirill Karabits,
Onyx Classics
Laurent Paadt