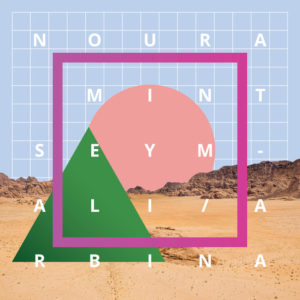Le Dover Quartet
Le Dover Quartet
était en concert à
Bruxelles
Considéré comme
l’un des quatuors les
plus prometteurs, le
Dover Quartet a,
une nouvelle fois,
ravi les spectateurs venus écouter les quatre musiciens américains.
Formé en 2008, il enchaine depuis cinq ans, les tournées aux Etats-
Unis et en Europe. De passage à Bruxelles, au conservatoire royal, il
a fait, une nouvelle fois, la preuve de son immense talent.
Tout a commencé avec le 23e quatuor de Mozart que la formation a
récemment gravé sur un disque remarquable. La légèreté et la
vivacité de l’interprétation ont permis d’apprécier la parfaite
harmonie entre les différents instruments. Ce dialogue permanent
notamment dans le menuetto a mis en lumière une prodigieuse
complémentarité. Dans cette conversation musicale permanente,
l’alto de Milena Pajaro-Van de Stadt a tiré son épingle du jeu. Jamais
dominant mais omniprésent, il a semblé virevolter, tantôt taquinant
le violon, tantôt s’amusant avec le violoncelle mais sans jamais se
laisser apprivoiser. Cette interprétation constitua un bel hommage
à un ancien professeur de violon du conservatoire et mozartien de
génie, le légendaire Arthur Grumiaux.
L’Adagio pour cordes du fameux premier quatuor à cordes de
Samuel Barber constitua, à n’en point douter, le clou du spectacle.
Enigmatique, incandescent, oppressant et mystique à la fois, le
Dover Quartet restitua à merveille toute l’émotion contenue dans
cette œuvre qui va bien au-delà de la musique pour nous dire
quelque chose de la vie elle-même et de sa fugacité. Portés la
douceur infinie du violon de Joël Link qui étendit le vibrato jusqu’à
la quasi-rupture, les quatre musiciens embarquèrent les
spectateurs dans un voyage musical dont ils se souviendront
longtemps.
Il ne restait plus qu’au 13e quatuor à cordes de Beethoven de
parachever ce merveilleux concert. Dans un extraordinaire
déchaînement de passion, le Dover Quartet, porté cette fois par le
violon de Bryan Lee dans l’adagio et le violoncelle de Camden Shaw
qui sonna le tocsin de la fugue, poursuivit son incroyable histoire qui
ne s’acheva pas sitôt la dernière jouée mais se poursuivit dans
toutes les têtes et dans tous les cœurs.
Laurent Pfaadt
A écouter : Dover Quartet, Tribute: Dover Quartet Plays Mozart,
Cedille Records, 2016
Retrouvez la programmation du BOZAR sur :
www.bozar.be/fr/homepages/73642-music