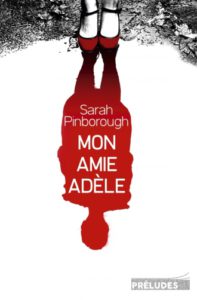Deuxième édition de Piano au Musée Würth
Voilà un festival qui devrait constituer l’un des rendez-vous musicaux
incontournables de la région. Une fois de plus, le musée Würth alliera
l’art à la musique. Il sera possible, en plus d’admirer jusqu’au 8 janvier
2018 les trésors de l’exposition « la tête aux pieds », d’écouter Chopin,
Brahms, Schubert ou Beethoven sous les doigts de musiciens
d’exception.
Avec Philippe Bianconi ou le génial Nelson Goerner qui clôturera
cette deuxième édition, le piano résonnera en maître. Le virtuose
argentin qui compte parmi les meilleurs interprètes de Chopin ou
de Liszt – et pour cause, il remporta le premier concours Liszt de
Buenos Aires en 1986 – régalera les spectateurs des deux
premières nocturnes et de la troisième sonate de Chopin qu’il a
d’ailleurs gravé sur le disque (EMI). De Chopin, il en sera
également question avec la pianiste polonaise, Ewa Osinska, qui
aura une fois de plus à cœur de faire résonner les accords du plus
français des compositeurs polonais et accompagnera les
spectateurs sur des chemins de traverse notamment ceux d’un
autre compositeur polonais, le génial Karol Szymanowski.
D’autres compositeurs seront à redécouvrir : Nicolaï Medtner ses
doigts de l’Ukrainien Vadym Kholodenko, vainqueur du concours
Van Cliburn en 2013 ou Alban Berg dont l’œuvre pour piano reste
largement méconnue et que

dans son récital
d’inauguration s’emploiera à
nous faire aimer. Pour ceux
qui souhaitent des « tubes », il
faudra venir écouter la
sonate des adieux d’Ana
Kipiani, un jeune talent à
suivre, les variations Diabelli
par Herbert Schuch qui
rendra hommage au grand
Beethoven ou les Préludes de
Debussy d’un Philippe
Bianconi qui nous emmènera,
à n’en point douter, sur les
traces du légendaire Arturo
Benedetti Michelangeli.
Des escapades dans la musique de chambre et le jazz seront
possibles durant ces neuf jours. Le violoncelle de Marc Coppey,
ancien du quatuor Ysaye, le violon de Nicolas Dautricourt et le
piano de Vincent Larderet emmèneront les spectateurs se
contempler dans les miroirs de Ravel. Marc Coppey rejoindra
ensuite le pianiste Peter Laul pour les troisième, quatrième et
cinquième sonates de Beethoven. Enfin préparez-vous à pénétrer
dans l’un des univers jazzy les plus originaux avec les musiciens du
Colin Vallon trio qui, avec les titres de leur dernier album, Danse
(ECM records), ne manqueront de vous émouvoir et de vous
déstabiliser. Avec de surcroît des tarifs plus qu’attractifs, il serait
donc dommage de passer à côté de cette parenthèse enchantée.
Laurent Pfaadt
Piano au musée Würth, 10-19 novembre 2017.
Toutes les informations à retrouver sur :
http://www.musee-wurth.fr/wp/index.php/festival-piano-au-musee/