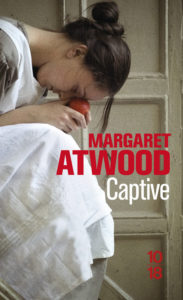« Cette histoire
« Cette histoire
illustre le degré
d’avilissement et de
perte de dignité de
certains pour garder
leur place au soleil. »
Paru au printemps
dernier, le Fou du roi
de l’écrivain marocain Mahi Binebine est un peu comme ces gâteaux
marocains, à la fois sucrés, fondants mais dont les amandes grincent
sous les dents. Sorte de conte des Mille et Une nuits moderne où
comédie et tragédie jouent une partie sans cesse renouvelée de
cache-cache, l’ouvrage est en lice pour le Renaudot 2017. Dans
cette histoire qui raconte la vie de son père, à la fois poète, bouffon
et responsable du sommeil du roi Hassan II, Mahi Binebine y dévoile
une partie de lui-même. Il a répondu à nos questions.
Ce qui frappe en premier lieu lorsqu’on lit votre ouvrage est le
règne de l’arbitraire.
Les années de plomb au Maroc ne sont pas une fiction. Nous avons
été terrorisés, nous avons vécus l’arbitraire, l’injustice, le népotisme.
Les rafles, les disparitions étaient monnaie courante. Et vous savez
quoi – je le vois en présentant ce roman un peu partout – Hassan II
fascinent encore les Marocains. A sa mort, les gens maltraités des
décennies durant l’ont pleuré sincèrement. Le syndrome de
Stockholm dans toute sa splendeur.
Quand vous écrivez : « entrer au palais royal (…) c’est un pacte
qu’on signe avec le diable », comment l’interpréter ?
Car une fois baigné dans cette lumière diabolique, on ne peut plus
s’en passer. La disgrâce est le pire châtiment que l’on puisse infliger
aux hommes du sérail. Une fois punis, écartés de cette lumière, ils
perdent leur identité, ils se font piétiner par tout le monde et ne
sont plus rien. Cette histoire illustre le degré d’avilissement et de
perte de dignité de certains pour garder leur place au soleil.
Votre procédé narratif est très personnel puisque vous vous
mettez dans la peau de votre père qui raconte son histoire. Il y a
notamment des scènes concernant les rapports entre votre père
et votre mère au sujet de votre frère. Comment avez-vous vécu
cette expérience ?
Dans ce roman j’ai donné la parole à mon père. Je lui ai permis de
s’expliquer, de raconter ses propres blessures. Pendant vingt-cinq
ans, un demi-frère a filmé mon père. Il déposait sa caméra sur le
poste de télévision et l’enregistrait racontant sa journée avec le roi.
J’ai visionnée en partie ces enregistrements grouillant d’anecdotes,
authentiques ou inventées par mon père. Les conteurs sont souvent
des menteurs, c’est bien connu. La même histoire revenait sous des
versions extrêmement différentes. J’en choisissais la plus
croustillante et la déclarais vérité vraie. Tout est donc réalité, en
étant fiction absolue.
Quelle a été la réception de l’ouvrage ? Par la famille royale ? Par la
vôtre ?
Mon roman a été bien accueilli. Des articles dans toute la presse, le
journal de vingt-heures de la deuxième chaîne nationale. Au temps
d’internet et des réseaux sociaux, la censure n’a plus de sens. Cela
dit, la fable de Lafontaine « le scorpion et la grenouille » a la peau
dure dans notre beau pays.
Quant à ma famille, les avis sont partagés. Certains ont déploré un
étalage de notre intimité, d’autres ont aimé le texte. Cependant,
étant un vieux routier, je sais que l’on ne peut pas plaire à tout le
monde.
Laurent Pfaadt
Mahi Binebine,
le Fou du roi, Stock,
176 pages, 2017
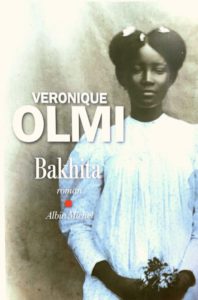 C’est un destin comme en raffole la
C’est un destin comme en raffole la