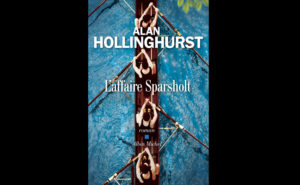Leonard Bernstein a
entretenu une
relation particulière
avec Vienne et à
travers elle avec
Gustav Mahler qu’il
contribua à
redécouvrir.
Leonard Bernstein
demeurera à jamais
le plus viennois des
compositeurs et des chefs d’orchestre américains. Partout, dans la
capitale autrichienne, il est possible de croiser l’ombre de Lenny,
suivant bien souvent celle de son illustre aîné, Gustav Mahler. Pour
cela, il faut arpenter le Ring, la célèbre avenue et entendre le
tramway entonner sa symphonie.
D’abord à l’Hôtel Bristol face au Staatsoper où le maestro avait ses
habitudes, succédant ainsi à un certain Serge Rachmaninov. Sa suite,
la 266, qui fut également celle du ténor Enrico Caruso, possédait
lors de ses venues un Bösendorfer sur lequel Bernstein composait et
il n’était pas rare qu’il convoque un membre du personnel ou le
concierge en chef pour recueillir leurs avis. D’ailleurs ce dernier,
Wolfgang, aujourd’hui à la retraite, se souvient encore aujourd’hui
avec émotion de ces moments privilégiés partagés avec ce grand
chef qu’il appelait simplement Lenny et à qui il réservait quelques
bouteilles de Ballantine’s douze ans d’âge ou les meilleurs steaks
tartares de la ville. Un jour de 1986, alors que la suite grouillait
d’invités, Wolfgang demanda au maestro si le mets était à son goût.
Mais Bernstein fit la moue. Le concierge demanda alors au chef ce
qui n’allait pas. Bernstein commanda du cognac qu’il versa sur la
viande et sa bonne humeur revint. Et lorsque Leonard Bernstein
quitta la capitale autrichienne, il demanda à Wolfgang s’il pouvait
faire quelque chose pour lui, lui offrir des CDs ou lui signer des
autographes. La réponse du concierge ne se fit pas attendre : « Oui.
Revenez à Vienne ».
Chez Dacapo Klassik, le magasin de musique voisin, on se souvient
encore avec émotion de ses interprétations de Beethoven, Sibelius
ou Mahler. Celles-ci dégageaient « quelque chose que j’ai du mal à
définir. Peut-être une extrême sensibilité » avoue le disquaire qui peine
à trouver ses mots, près de trente ans après la mort de Bernstein.
Nos pas nous conduisent inévitablement devant le Musikverein. Ici
dans cette salle mythique résonnent encore les notes de Gustav
Mahler. Bernstein y vint pour la première fois dans les années 60
pour y diriger le mythique Wiener Philharmoniker qui fut l’orchestre
de Mahler. A cette époque, plus personne ou presque ne connaissait
le créateur du Lied von der Erde. « En commençant les répétitions, il
s’aperçoit de l’hostilité de l’orchestre, qui joue les œuvres de son ancien directeur en trainant les pieds, voir en y mettant de la mauvaise volonté »
écrit le journaliste Christian Merlin dans son livre consacré au
Philharmonique de Vienne (Buchet-Chastel, 2017). A force de
concerts et de persuasion, Bernstein fit redécouvrir celui qui reste
aujourd’hui, l’un des plus grands génies du 20e siècle. Entre 1960 et
1967, il est ainsi le premier à enregistrer la première intégrale des
neuf symphonies du maître. Et en même temps, lui, le juif new-
yorkais confronta le Wiener Philharmoniker à son ancien chef et à
ses vieux démons qui tenaient encore à cette époque quelques
archets. Lui-même affirmait d’ailleurs lucide « qu’il était impossible de
savoir si le public qui vous acclamait contenait une personne qui, vingt-
cinq ans plus tôt, vous aurez abattu. Mais, il est préférable de pardonner,
et si possible, d’oublier » rappelle-il dans une exposition que lui
consacre le musée juif de Vienne. Armé de sa seule baguette,
Leonard Bernstein obligea ainsi l’histoire de la musique viennoise à
regarder son passé dans les yeux d’un Mahler qui, banni de Vienne
par cet antisémitisme qui allait ravager l’Europe, s’installa à New
York où il dirigea l’orchestre philharmonique de New York jusqu’à
son décès en 1911. Près d’un demi-siècle plus tard, en 1960,
Leonard Bernstein devenait le chef de ce même orchestre. Dans la
foule, Alma Mahler, veuve du compositeur assistait au concert. A sa mort le 5 septembre 1990, Bernstein était enterré avec un
exemplaire de la cinquième symphonie de Mahler. La boucle était
bouclée.
Par Laurent Pfaadt
A voir : Leonard Bernstein. Ein New Yorker in Wien,
jusqu’au 28 avril 2019, Jüdisches Museum Wien