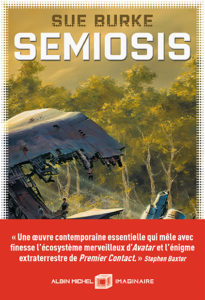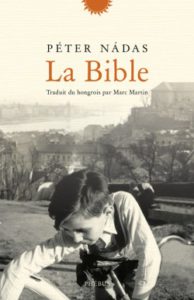Des oiseaux volant
au-dessus de vos
têtes, de la
végétation
luxuriante courant
sur les murs, un
singe qui veille sur
l’entrée de votre
chambre, des
tigres couchés sur
des banquettes, le
petit Elias, huit ans, est un peu perdu. Il se croit en pleine jungle. Et
pourtant, nous sommes bien dans un hôtel. Mais pas n’importe
lequel : au Brown’s.
Le Brown’s, c’est une vieille dame de 182 ans qui se porte plutôt
bien. Tandis que pierre après pierre, l’empire britannique étendait,
en ce XIXe siècle de toutes les conquêtes et sous le sceptre de sa
toute jeune reine Victoria, son influence sur l’ensemble du globe, à
Londres dans le quartier de Mayfair, se construisait l’un des hôtels
les plus mythiques de la ville. « Je ne descends pas dans un hôtel, je
descends au Brown’s » aurait affirmé un jour un Winston Churchill
qui affectionnait plus particulièrement le bar de l’établissement.
Car il faut le dire d’emblée, on ne vient pas à Brown’s pour y
passer une nuit ou deux mais plutôt pour y entamer un voyage
dans le temps.
Impossible de passer à côté de l’histoire avec un grand H. Les
Roosevelt, Théodore comme Franklin, ont honoré les lieux de
leurs présences et quelques gouvernements d’Europe occidentale
ont trouvé dans les confortables suites de l’hôtel, des consolations
à leurs exils forcés pendant la seconde guerre mondiale. Mais on
ne vient pas au Brown’s pour humer l’air de la guerre mais plutôt
celui du papier. Car ici, les plus grandes plumes passées ou
présentes ont dormi, parfois pensé et souvent griffonné. De
Joseph Conrad à Norman Mailer en passant par William Faulkner,
Tom Wolfe, Arthur C Clarke, Jorge Borges, JRR Tolkien ou Ian
McEwan, nombreux ont été les grands écrivains à avoir séjourné
au Brown’s. Agatha Christie s’en inspira pour A l’hôtel Bertram.
Stephen King y débuta son roman Misery. Ici, la littérature est
partout, sur les étagères, sur les murs, dans les couloirs. Alexandre
Dumas côtoie Fiodor Dostoïevski, Maurice Maeterlinck ou
George Mac Donald Fraser.
Cependant, difficile de résister à l’appel de la jungle. Et ce dernier
conduit inévitablement au premier étage vers la suite Rudyard
Kipling. Car c’est ici que le génial auteur écrivit Le livre de la jungle.
La suite a été rénovée récemment par Olga Polizzi, directrice
artistique du groupe Rocco Forte – qui signe également la
décoration de l’hôtel inspirée de l’univers de Kipling – dans le
cadre d’un vaste programme de rénovation baptisé « Rocco Forte
Suite Experience ». « Nous avons réinventé la Kipling afin que les
hôtes se sentent pleinement au cœur de Londres » assure-t-elle. Car il
faut bien en convenir, ici, tout respire l’authenticité, des meubles
du designer anglais Julian Chichester à la fameuse lettre
manuscrite de Kipling.
Des clients venus du monde entier mais plus particulièrement
d’Italie, d’Allemagne et des Etats-Unis se pressent pour vivre cette
expérience unique. Et même d’Angleterre pour tous ceux désirant
se perdre dans cette jungle littéraire. « Beaucoup de nos clients
viennent y chercher l’atmosphère du livre de la jungle. D’autres étaient
là il y a vingt ans et reviennent » assure Ines, la seule serveuse
française de l’équipe multiculturelle du Brown’s. Car l’atmosphère
de l’ancien empire ne serait rien sans un personnel dévoué et fier
de travailler ici. Grâce à lui, chaque client y retrouve une
atmosphère familiale et une attention de tous les instants qui se
transmet à chaque génération de concierges ou de maîtres
d’hôtels et qui contribue grandement à façonner ce lien unique
entre l’hôtel et ses clients.
Fier de son passé, l’histoire du Brown’s s’écrit également au futur
avec cette subtile combinaison de style british et de modernité. Il
est ainsi possible de regarder la télévision dans son bain après
avoir discouru, lové dans un fauteuil club, dans l’English Tea Room.
Le Brown’s propose ainsi à ses clients une expérience unique qu’ils
conserveront toute leur vie. Le petit Elias, quant à lui, est reparti
avec un singe en peluche sous le bras, singe qui l’attendait à son
arrivée dans la chambre. Il l’a appelé Roi Louie bien évidemment…
Par Laurent Pfaadt
Informations : www.roccofortehotels.com