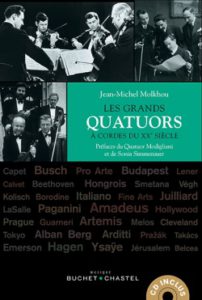 Un ouvrage célèbre les grands
Un ouvrage célèbre les grands
quatuors à cordes du 20e siècle
Ils sonnent à nos oreilles comme
autant de mythes : Borodine,
Amadeus, Kronos, LaSalle, Berg.
Parfois, leurs noms sont plus
célèbres que leurs compositeurs
éponymes. Et pour cause. Dans
l’univers de la musique classique
et plus particulièrement dans
celui de la musique de chambre,
ils font office de légendes. Après
les grands violonistes, après avoir
célébré le soliste, le génie et l’individu, Jean-Michel Molkhou,
critique musical pour le magazine Diapason, évoque dans son
nouvel ouvrage, toujours aussi passionnant et exhaustif, ces
ensembles à cordes si particuliers où deux violons, un alto et un
violoncelle cohabitent ensemble pour ne devenir qu’un seul
instrument à seize cordes.
A mi-chemin entre la formation orchestrale dont il ne partage à
vrai dire que peu de valeurs et de caractéristiques et le récital d’un
seul, le quatuor à cordes, né à la fin du XVIIIe siècle et popularisé
par Mozart, Haydn ou Boccherini célèbre le sens du collectif. Ici
plus qu’ailleurs, l’individu s’efface au profit du groupe. Ici plus
qu’ailleurs on apprend à écouter l’autre, à jouer avec lui. Alors que
les grands primarius – nom donné au premier violon – tels que
Norbert Brainin (Amadeus) ou Robert Mann (Julliard) demeurent
à bien des égards les égaux des grands solistes dans le petit
monde fermé de la musique classique, ils restent néanmoins de
parfaits inconnus aux yeux du grand public car ils se sont mis au
service des autres. Dans leur préface, les membres du quatuor
Modigliani insistent d’ailleurs sur « l’écoute et le respect de l’autre.
Sans ces principes fondamentaux, il est presque impossible de jouer
ensemble durablement et de chercher un idéal musical commun ».
Mais lorsqu’on a dit cela, on a presque rien dit. Car l’histoire des
quatuors à cordes regorgent d’exemples divers sur cette question
principale et sur la conception qu’ont leurs membres de leur
aventure commune. Derrière tout cela se dessine en réalité la
question de la démocratie. Véritable organisme vivant d’une
durée de vie en moyenne d’un demi-siècle et portant en lui les
tragédies et les joies humaines, le quatuor fonctionne tout aussi
bien avec l’omniprésence voire l’omnipotence d’un leader comme
dans la tradition russe ou régi par une stricte égalité entre ses
membres comme dans le quatuor allemand Artémis. Cultures
politique et musical semblent ainsi indissociables. Fusionnelles ou
détachées, il y a donc à la lecture du livre de Jean-Michel Molkhou
et de ces quelques 120 ensembles autant de conceptions que de
quatuors. Tout dépend de l’alchimie produite.
Les six heures de musique qui accompagnent comme à chaque fois
les ouvrages de la très belle collection les Grands Interprètes
permettent aux lecteurs de cheminer dans l’histoire de la musique
de chambre en compagnie de ceux qui se sont littéralement fait
les voix – tels les quatuors Beethoven et Taneïev pour
Chostakovitch ou Kolish et Berg pour la seconde école de Vienne
– des grands créateurs du siècle passé. Outre les magnifiques
archives célébrant les légendaires quatuors Budapest, Busch ou
Beethoven, chacun trouvera son morceau favori. Du 14e quatuor à
cordes de Schubert, cette « Jeune fille et la mort » à ceux moins
connus de Weinberg en passant par le 12e quatuor « américain »
de Dvorak ou le quatuor en ut majeur dit « l’Empereur » de Haydn
qui servit de base à l’hymne allemand, chacun mesurera alors
pleinement qu’il est ici question de quelque chose qui va bien au-
delà de la simple musique.
Par Laurent Pfaadt
Jean-Michel Molkhou, les grands quatuors à cordes du XXe siècle,
Buchet-Chastel, 474 p.




