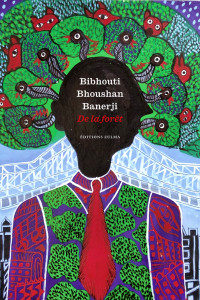Le premier roman de la grande
Le premier roman de la grande
voix de la littérature slovène enfin
traduit. Un sombre chef d’œuvre
Pour tous ceux qui s’intéressent à
cette littérature héritière de la
Mitteleuropa ou de ces voix nées
dans les Balkans pendant le
titisme, celle de Drago Jancar n’est
pas inconnue. Couronnée par le
Prix du meilleur livre étranger en
2014 pour Cette nuit, je l’ai vue
(Phébus, 2014), qu’il s’agisse du
jésuite Simon Lovrenc dans le très
beau Katarina, le paon et le jésuite (Passage du Nord-Ouest, 2009) ou
plus récemment du violoniste Ciril (Six mois dans la vie de Ciril,
Phébus 2016), l’écriture de Jancar s’articule autour de personnages
en quête de repères, de sens.
Son premier roman qui lui valut d’emblée la célébrité, la fuite
extraordinaire de Johannes Ott, paru en 1978 posa ainsi la première
pierre de cette œuvre récompensée par le Prix européen de
littérature en 2011. Dans une époque située au milieu du XVIIe
siècle, sous le règne de l’empereur du Saint Empire Romain
Germanique Léopold, un vagabond nommé Johannes Ott traverse
un empire ravagé par la peste et la superstition. Il est tour à tour
vagabond, marchand ou galérien. D’emblée, le récit construit une
série d’images dont il est difficile de se détacher mais qui convergent
toutes vers des ténèbres où, entre réalité et fantastique, le diable
semble revêtir diverses apparences. Jancar, comme dans chacun de
ses romans, parvient magnifiquement à restituer, avec ces odeurs et
ces angoisses, les époques qui servent de décors à ses comédies
humaines. Le lecteur se retrouve ainsi plongé dans des tableaux
sortis de Jérôme Bosch entre paysages eschatologiques et
prophètes de malheurs. La langue de Jancar est à l’image du récit :
labyrinthique où on avance à tâtons, une torche littéraire
enflammée à la main qui nous oblige parfois à revenir en arrière pour
retrouver notre chemin mental. La narration, volontairement
elliptique avec ses personnages taiseux ou rongés par les secrets
aide grandement à procurer ce sentiment de confusion qui nourrit
un récit qui semble devoir éternellement recommencer jusqu’à
l’absurde : « Pourquoi est-ce que je suis en fuite, et pourquoi est-ce que je
rôde de-ci de-là, avec cette peur et cette agitation dans la poitrine ?
Quelle énergie et quelle force inconnue me poussent à fuir continûment ?»
se questionne ainsi Ott.
Le livre est aussi un miroir. Passé les pérégrinations tumultueuses de
notre héros dans un monde apocalyptique, le lecteur, certes averti, y
découvre un autre reflet nettement plus politique. Ott serait-il
l’hétéronyme de Jancar ? Et avance-t-il lui-aussi dans un monde
oppressif, assailli par des idéologies de mort, des espions et
propageant une peste qu’il conviendrait mieux d’appeler démocratie? Peut-être. Il y a là en tout cas un farouche réquisitoire
contre un totalitarisme qui a troqué ses oripeaux religieux et
médiévaux contre une forme plus contemporaine et pernicieuse.
Car sans le savoir, Johan Ott diffuse d’autres hérésies nettement
plus ravageuses que celles que combattent les juges de l’Inquisition
ou les commissaires de la peste : l’égalité, la fraternité, la démocratie.
Ces poisons, aucun empereur, Habsbourg ou Slovène comme lui,
aucun bûcher, aucune torture, ni aucune fuite ne parvinrent à les
extirper de l’esprit de ceux qui l’ont ingéré. Telle est la leçon majeure
du livre.
Par Laurent Pfaadt
Drago Jancar, La fuite extraordinaire de Johannes Ott,
Chez Phébus, 352 p.