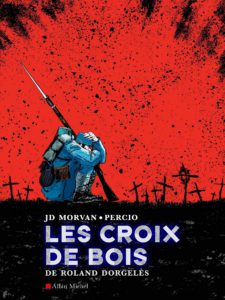Disparue en 2016,
Disparue en 2016,
l’architecte
irakienne laisse une
œuvre unique. En
témoigne cette
monographie
passionnante
Le propre d’un grand
architecte est de faire croire que ce qu’il construit n’est pas de l’architecture. Juste un
pont, un immeuble, une maison, un édifice, un objet s’inscrivant dans
son environnement, dans son temps. Presque invisible. Ce
sentiment d’absorption par le temps est particulièrement
perceptible dans l’œuvre de Zaha Hadid (1950-2016), architecte
majeure de la fin du 20e siècle et du début du 21e, première femme à
obtenir le Pritzker Prize (le Nobel de l’architecture) en 2004, qui
laissera à n’en point douter, une œuvre appelée à demeurer.
Pourtant d’emblée, les réalisations de l’architecte semblent
démentir cette affirmation. Question de temps avant tout. La
monographie réactualisée de Philip Jodidio qui couvre quelques
quarante années de réalisations permet de comprendre cette
ambition. Avec ses magnifiques photographies, l’ouvrage permet, de
la résidence du Premier ministre irlandais en 1979 à ses œuvres
posthumes comme le pont Danjiang de Taiwan en passant par le
centre d’art contemporain Lois and Richard Rosenthal à Cincinnati –
elle fut la première femme architecte à construire un musée – de
tracer le style Hadid et de l’analyser. Voilà la clef. Déconstruire les
représentations physiques et mentales, les idées convenues et
repenser l’architecture dans sa globalité. Hadid, c’est une révolution
intellectuelle appliquée aux fondamentaux géométriques de
l’architecture. Eclater la réalité comme un miroir pour la
reconstituer différemment.
Plonger dans cet ouvrage permet, avec ce paradigme en tête, de
comprendre cette temporalité qui rend invisible ses réalisations.
Car qui, aujourd’hui, en passant devant la caserne Vitra à Weil-am-
Rhein, cet éclat de miroir, ou le terminus du tram d’Hœnheim-Nord
près de Strasbourg, sait qu’il s’agit d’œuvres de Zaha Hadid ? Dans
un demi-siècle, d’autres visiteurs passeront devant le centre de
recherches et d’études pétrolières King Abdullah à Riyad ou devant
l’opéra de Guangzhou, monuments insérés dans ces villes du futur
sans savoir que ces derniers ont été qualifiés en leur temps de…
futuristes. Oui mais comment expliquer alors cette invisibilité
assumée ? Chez Hadid, chaque projet entretient un lien direct ou
indirect, conscient ou inconscient avec l’environnement dans lequel
il est inséré. Un critique a même parlé de créature chtonienne, ces
esprits souterrains de la mythologie grecque, à propos du Landscape
Formation One (LFone, Weil-am-Rhein, 1996-1999). Mais l’exemple
le plus abouti de cette fusion entre un bâtiment et son paysage
demeure le grandiose centre culturel Heydar Aliyev (2007-2013) à
Bakou. Ici, les bâtiments apparaissent comme des plis sortant
directement de la topographie du paysage, comme une extension
vivante de son environnement.
Alors, on tourne les pages et on découvre l’architecte au travail, à
travers ses constructions, mais également ses dessins, ses
maquettes et ses meubles passionnants. Chaque réalisation vient
déconstruire les représentations établies. Les ponts, arrachés à
l’utilitarisme des ingénieurs, deviennent des œuvres d’art, des
destinations en soi comme celui d’Abu Dhabi (pont Sheikh Zayed,
1997-2010) qui imite une vague. Comme il y a un siècle ces églises
arrachées aux fidèles pour les confier aux touristes. A l’occasion de
la remise du Prix Pitzker, le président du jury, Lord Jacob Rothschild
affirmait ainsi que « depuis plus d’une décennie, elle a été admirée pour
son génie de la vision d’espaces que des esprits moins imaginatifs
auraient pu penser irréalisables ».
Le 31 mars 2016, le crayon s’est pourtant brutalement interrompu. «
La complexité du dessin se transformait en complexité architecturale »
disait-elle. Ainsi, le crayon ne s’est pas arrêté mais est simplement
devenu, lui aussi, invisible. Reste ses réalisations magnifiques. La
boucle est bouclée.
Par Laurent Pfaadt
Zaha Hadid. Complete Works 1979–Today, Philip Jodidio, 2020
Edition TASCHEN, 672 p.
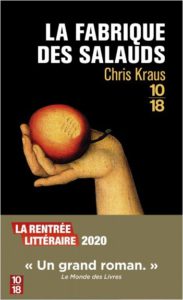 10/18, 1104 p.
10/18, 1104 p.