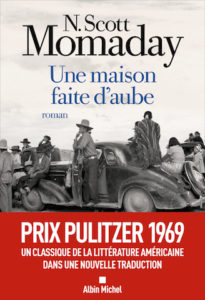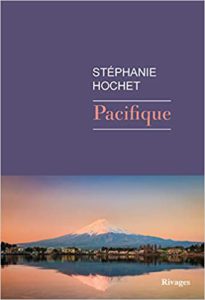Impossible de
Impossible de
terminer cette année
2020 sans dire
quelques mots du M,
l’enfant du siècle
d’Antonio Scurati,
l’un des meilleurs
livres d’histoire de
l’année. Mais est-ce bien un livre d’histoire ou un roman historique ? Peut-être un peu
des deux.
Il ne s’agit pas d’une énième biographie du Duce mais bel et bien de
la vie d’un aventurier qui s’est fait journaliste, écrivain, qui a adopté
toutes les idéologies naissantes du 20e siècle et ne recula devant
rien, absolument rien, pour satisfaire une ambition dévorante.
Dictateur fantasque, clown facétieux, Rastignac de bas étage, Benito
Mussolini avait tout du personnage de roman. Il n’en fallait pas
moins pour qu’Antonio Scurati en fasse ce personnage perdu dans
une histoire véridique, celle du fascisme, celle du totalitarisme à
l’italienne. Mais surtout, dans sa propre histoire. Dans ce livre qui a
remporté le prix Strega, l’équivalent du Goncourt italien, celui qui a
régné sur une Italie qu’il a contribué à mettre à genoux devant un
Adolf Hitler qui l’admira à ses débuts, apparaît nu, sans ce mythe
historique qui a fait de lui ce qu’il n’était pas en réalité. Ici M, tel que
le baptise l’auteur, est avant tout un génie de la communication
dénué de tout scrupule. Adepte de la violence verbale et physique
plutôt que de la vérité dont il a, le premier, compris qu’elle ne servait
à rien, Mussolini apparaît comme un manipulateur et un assassin
notamment celui du député socialiste Matteotti, dont la mort
constitue l’un des grands moments du livre. Grace à une plongée
dans la tête du Duce, Scurati le suit. On est à côté de lui durant ces
meetings où il assène électrochocs et fake news ou lors de la
fameuse marche sur Rome, le 28 octobre 1922. Populisme,
antisystème, anti-élitisme lui servent de boussoles. Dans nos oreilles
résonnent ses mots. Une petite bande originale scande les épisodes.
Elle ressemble un peu à celle d’enquête sur un citoyen au-dessus de
tout soupçon d’Ennio Morricone.
Storyteller de sa propre histoire, Mussolini s’est vu, avec ce livre,
appliquer le jugement de la littérature. Et il est, comme toujours,
implacable. Surtout pour un dictateur. Scurati l’a ainsi emprisonné
dans son propre roman pour l’examiner comme un rat de
laboratoire, finalement pathétique, et en révéler toute la vacuité.
Avec ce subtil collage de réflexions de Mussolini, de ses proches et
de ses ennemis, d’articles de journaux, de comptes rendus de police,
de journaux intimes ou de correspondances, Scurati propulse son
lecteur dans un tourbillon psychologique.
Parvenu à la fin du livre, le lecteur est KO debout, la boule au ventre
et furieux. Mais comment un type comme lui a-t-il pu réussir ?
Comment une époque privée de repères a-t-elle permis l’ascension
d’un gars comme lui, avançant jusqu’au sommet du pouvoir sans
rencontrer d’obstacles, avec la complicité de ces hommes tellement
brillants et avec l’aide de ces voyous ? L’histoire s’arrête pour
l’instant à la fin de l’année 1924, soit avant la mise en place de la
dictature fasciste. Mais les autres volumes arrivent et avec eux de
nombreux uppercuts historiques…
Par Laurent Pfaadt
Antonion Scurati, M, L’enfant du siècle,
Les Arènes, 868 p.