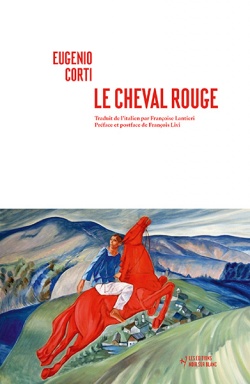Homo Domesticus de James C. Scott
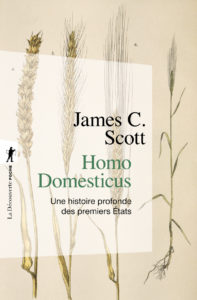
L’Histoire est écrite par les vainqueurs d’autant plus fermement
qu’elle se doit de documenter leur puissance et leur rayonnement
tout en dissimulant leurs fragilités. L’auteur détricote ce récit
fondateur des Empires aussi partiel que partial et que nos États
modernes perpétuent volontiers authentifiant ainsi leur mythe du
progrès de l’humanité dont ils seraient l’aboutissement. La réalité
est bien plus complexe et le livre offre une belle synthèse (24 pages
de bibliographie) de cet « âge d’or des Barbares » dont le destin était
intimement intriqué aux premiers États.
Si cette interprétation biaisée a pu se pérenniser, c’est que les
Empires produisaient une mémoire « en dur » avec leurs monuments
et leurs écrits qui affirmaient leur haute idée de la civilisation et
rejetaient dans l’ombre toutes les autres qui construisaient en
matériaux périssables, écrivaient sur des supports corruptibles ne
laissant aux archéologues que des témoignages ténus.
Ces barbares – chasseurs, cueilleurs, itinérants plutôt que nomades
– avaient pourtant élaboré un véritable écosystème avec des implantations agricoles saisonnières (cultures sur brûlis), des nasses
pour piéger les troupeaux lors des transhumances, etc. Cette
organisation collective leur permettait de ne travailler que deux à
trois heures par jour et la diversité de leurs activités d’être plus
athlétiques et en meilleure santé que les sédentaires.
L’auteur décrit avec une certaine gourmandise les prémices de
civilisation forgées par ces barbares. Un terreau qui, joint à des
conditions favorables à la culture extensive des céréales (vastes
zones fertilisées par les alluvions comme en Mésopotamie ou le long
du Nil), a permis aux Empires d’émerger en imposant la
sédentarisation des populations (très souvent au prix de la
servitude : « dans la plupart des milieux naturels, seules la pression
démographique ou une forme quelconque de coercition peuvent expliquer
qu’une population de chasseurs-cueilleurs soit passée à l’agriculture. »
p. 54).
Des céréales ? Car c’est un produit saisonnier récolté à périodes
fixes, facile à stocker et à transporter, donc à imposer ! La civilisation est avant tout logique comptable ! « Avec le recul, on peut percevoir les
relations entre les barbares et l’État comme une compétition pour le droit
de s’approprier l’excèdent du module sédentaire « céréales/main-
d’œuvre ». Ce module était en effet le fondement essentiel tant de la
construction de l’État que du mode d’accumulation barbare. » (p. 271)
Sauf que les fragilités sont nombreuses : monoculture (risques
accrus de famine), impôts, servitudes (esclavage souvent) et impact
sur la santé (travail harassant et maladies induites par la
concentration de population : « Il semble presque acquis que nombre de
ces États se sont effondrés sous le coup d’épidémies », p. 55). Il est
d’ailleurs troublant que les conditions à l’origine des zoonoses et des
épidémies d’il y a 5 000 ans renvoient à celles de la pandémie
actuelle (p. 134 à 135).
Mais toute histoire a une fin : « En reconstituant systématiquement les
réserves de main-d’œuvre de l’État grâce aux esclaves qu’ils lui livraient,
ou bien en mettant leur savoir-faire militaire au service de sa protection
et de son expansion, les barbares ont délibérément creusé leur propre
tombe. » (p. 283) Comme si le ver était dans le fruit et que seule
l’échelle avait changé : l’humanité serait ainsi passée du village au village global. Sauf qu’aujourd’hui, il n’y a plus d’échappatoire (à
l’époque, l’écosystème permettait le retour au nomadisme
pastoralisme).
par Luc Maechel
Une histoire profonde des premiers États
chez La Découverte poche, jan. 2021, 323 p., 13 €
(Yale University, 2017 – traduit de l’américain par Marc Saint-Upéry, La Découverte 2019)