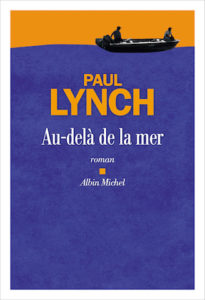Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain de Rabat présentait une exposition dédiée au voyage marocain d’Eugène Delacroix

© Musée des beaux-arts de Dijon
Ses chevaux, ses cavaliers, sa touche orientaliste sont connus de
tous et restent à jamais attachés à son art. C’est ici, dans le royaume
du Maroc, entre mer et désert que la peinture d’Eugène Delacroix
prit forme. L’’exposition du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et
Contemporain, élaborée en coopération avec les musées du Louvre
et Eugène Delacroix de Paris, revient ainsi sur le voyage qu’effectua
le peintre entre janvier et juin 1832 à l’occasion de l’ambassade
diplomatique du comte de Mornay, auprès du sultan Moulay-Abd-
Er-Rahman.
Si le fameux tableau du sultan est resté au musée des Augustins de
Toulouse, le visiteur reste fasciné par le travail préparatoire du
peintre, de l’esquisse venue du musée de Dijon (1832) aux eaux-
fortes et lithographies qui montrent son exceptionnel génie. Ces
dessins qui s’inscrivent dans la tradition des Daumier et Doré,
dévoilent un sens aigu de l’observation que le trait du peintre
restitue à merveille comme dans cette étude du bournous où chaque
fil se compte et s’admire. La lithographie de La Noce juive (1849),
certainement l’une des plus belles pièces de l’exposition, qui servit
de base au tableau du Louvre, se contemple sans fin, tant le trait, les
expressions des personnages et la composition appartiennent à la
fois à son temps et tracent une modernité artistique à venir.
D’ailleurs, les chevaux de Delacroix observés lors de fantasias et si
emblématiques de son art, impulsent dans les tableaux du Louvre
(Passage d’un gué, 1858) et Bordeaux (Cavalier de la garde du sultan,
1845), une sensation de mouvement qui inspira tant de peintres à
venir.
Car le musée Mohammed VI est avant tout une institution
consacrée à l’art moderne et contemporain et les commissaires ont
voulu inscrire Delacroix dans cette modernité qu’il a induit, tant
dans son alchimie picturale que dans ses compositions et dans
l’impact de l’expérience marocaine. Les œuvres d’Odilon Redon ou
d’Henri Matisse en témoignent assurément. Preuve que les voyages
continuent et continueront d’alimenter l’inconscient des artistes et
de visiteurs séduits par la beauté des coutumes et des paysages du
Maroc.
Par Laurent Pfaadt
« Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc », Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain de Rabat, jusqu’au 9 octobre 2021