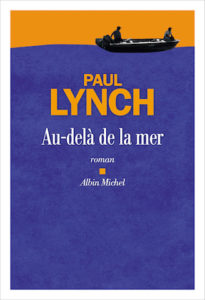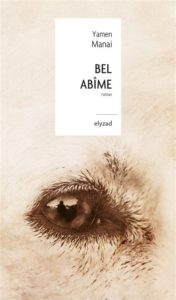Cette exposition se veut faire œuvre en associant différents
médiums, écritures, techniques et pratiques artistiques telles que :
une rencontre entre la calligraphie et la sculpture, la peinture et la
photographie, un cadavre exquis et un monochrome, une fleur des
champs et une fleur des villes…
Le tout est de réussir la scénographie, un beau pari.
Nous avons invité les artistes à unir leurs forces pour faire œuvre(s).
Ne pas rester seul, œuvrer ensemble pour créer des instants
propices à la rencontre : Une exposition. Ils ont répondu présent.
La rencontre entre Benoît Schwaller & Jean-Michel M. Pouey de
Juillacq : « […] Ce qui est remarquable, c’est que la directive, somme
toute très vague, et la récupération fortuite de deux cloches de
sonnerie d’école, aient conduit à réaliser ce chef-d’œuvre que Benoît
attendait de ma part sans pour autant en avoir esquissé le moindre
contour. D’un point de vue scientifique, cela relève du pur hasard,
car l’ensemble des projets de collaboration dans une œuvre
commune est très faible : un seul événement ! La probabilité de
tomber pile-poil dans le mille était donc extrêmement faible et
tendait vers zéro ! Peut-on alors avancer le mot « miracle » pour
qualifier le phénomène ou bien faut-il nous réjouir d’avoir échappé à
la catastrophe de l’échec ? On en viendrait presque à soupçonner
l’hypothèse de la possibilité d’une présomption d’existence de
Ptah, dieu des arts, mais cela reste bien évidemment encore à
démontrer ».
Les artistes
Karim Allaoui | Myrtille Béal & Brigitte Béguinot | Yaleika | Robert
Becker & Dominique Haettel | Louis Danicher | Moins12Prod |
Jean-Michel M.Pouey de Juillacq & Benoit Schwaller
Galerie Art’Course
67000 Strasbourg
www.galerieartcourse.com