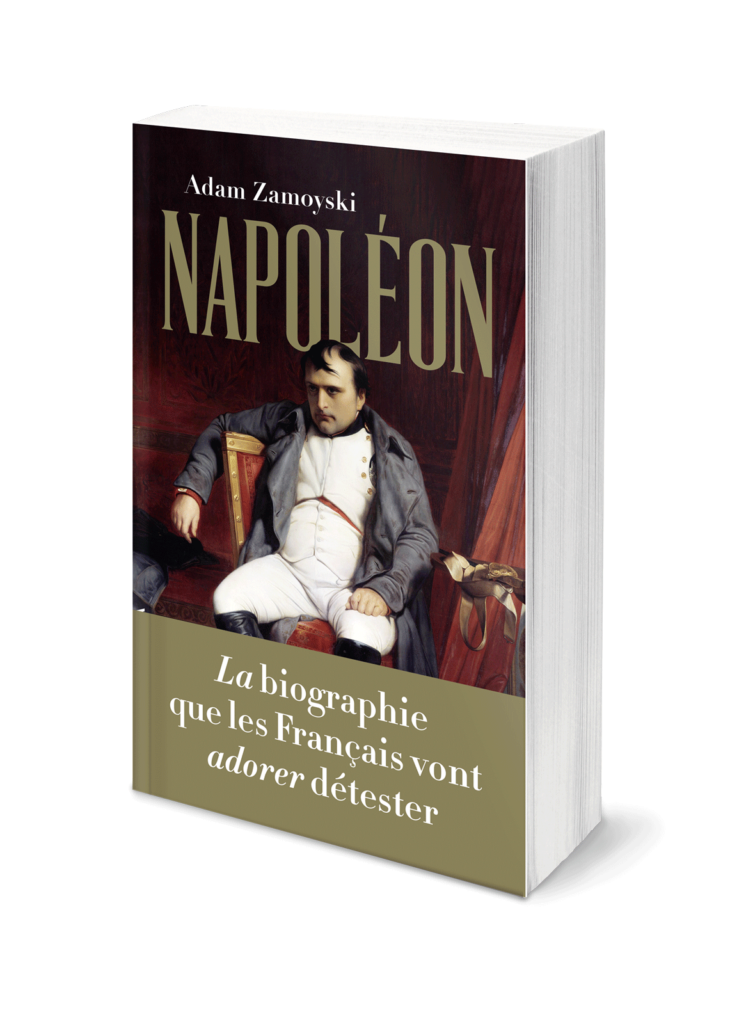A l’occasion de la Mozartfest de Würzburg, Jorg Widmann a sublimé le concerto pour clarinette de Mozart

© Dita Vollmond
Assister à un concert dans la Résidence du prince-évêque de Würzburg, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, est assurément une expérience unique. Assis sous les fresques du grand Tiepolo, le regard du spectateur oscille entre la beauté des œuvres d’art et celle d’un orchestre au sommet. On imagine aisément ce que devait ressentir les invités du prince lors des concerts privés qu’il donna sous le regard d’un Fréderic Barberousse à genoux au moment d’épouser Béatrice de Bourgogne.
Chaque fin de printemps, le prince des lieux se nomme Wolfgang Amadeus Mozart. Cette année, l’un des points d’orgue du festival qui lui est consacré, fut bel et bien son fameux concerto pour clarinette qu’il composa au crépuscule de sa vie (octobre 1791). Et pour l’interpréter, le festival a invité l’un de ses plus grands interprètes, Jorg Widmann, également compositeur et chef d’orchestre d’un soir du Mozarteumorchester de Salzbourg, orchestre qui a fait d’Amadeus son saint patron. Autant dire, ce qui se fait de mieux.
Tout était donc réuni pour vivre une soirée d’anthologie. Et ce fut le cas. Convoquant un Felix Mendelssohn et l’andante de sa sonate pour clarinette qu’il arrangea pour orchestre, Jorg Widmann donna le ton. Celui de l’entrée dans un songe voluptueux, bercés par une harpe et un célesta de toute beauté. Vint ensuite le concerto pour clarinette. L’orchestre, en fin connaisseur de la geste mozartienne, entra parfaitement dans l’oeuvre. Le ton demeura juste, les équilibres sonores posés par le chef. Puis vint le second mouvement et d’un coup, en l’espace d’un instant, la grâce s’empara de la salle. Les personnages peints ont certainement détourné, le temps d’un instant, leurs regards pour admirer notre prodige délivrant ses fabuleuses notes tirées du génie. Car tous avaient les yeux rivés sur la clarinette de Widmann, sceptre musical brandi devant le roi Mozart. Le soliste et son orchestre demeurèrent ainsi en parfaite harmonie, Jorg Widmann rayonnant de lyrisme et de justesse. Un clignement de paupières ramena l’assistance à la réalité sans briser pour autant un charme dispensé par un soleil déclinant qui nimbait de ses rayons de bronze statues et dorures de la Kaisersaal.
A l’heure de la pause, personne ne vit qu’un orage grondait au-dessus des jardins de la Résidence. Celui de la première symphonie en ut mineur d’un jeune Mendelssohn de quinze ans recouvrant l’auguste édifice. Comme un Dieu descendu du plafond peint, Jorg Widmann lança ses éclairs vers un orchestre qu’il conduisit tel un quadrige lancé à vive allure. La symphonie, menée tambour battant, acheva une soirée où princes et dieux mis au service de la musique n’étaient pas seulement sur les murs et les plafonds mais bel et bien sur la scène de la Mozartfest.
Par Laurent Pfaadt
La Mozartfest de Würzburg se poursuit jusqu’au 19 juin. Retrouvez sa programmation : http://www.mozartfest.de