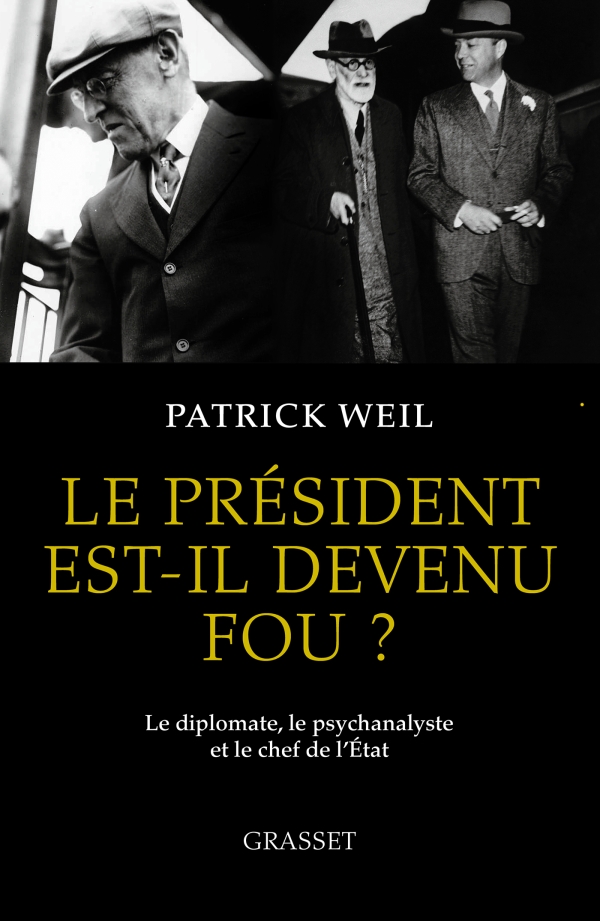Picasso – El Greco au Kunstmuseum Basel
Si pour L’Enterrement de Casagemas (Évocation) de 1901, Picasso revendique la filiation du Greco, l’affirmation, peu après avec Les Demoiselles d’Avignon (1907), de son style si singulier évacue instinctivement dans l’esprit du public toute référence aux anciens. La réalité est bien différente : il pratique le nu, le portrait, la nature morte et transcrit son admiration pour le vieux maître jusqu’à la fin de sa vie (Le Mousquetaire, 1967 ou Buste d’homme, 1970).
En proposant, avec presque quatre-vingts pièces des deux artistes, plus d’une trentaine de rapprochements entre l’illustre Crétois et Picasso – couvrant toute la carrière de ce dernier –, le Kunstmuseum de Bâle initie aussi l’hommage pour le cinquantième anniversaire de la mort du peintre franco-espagnol en 1973.
L’exposition privilégie les portraits même si quelques grands formats sont présentés. Cette intimité avec le sujet met l’accent sur la grande liberté stylistique du Greco : ces ciels de tourmente atmosphérique (La Pénitente Magdalène, ca. 1580-85) ou au contraire l’épure des fonds sombres (série des Apôtres, 1610-14) concentrant l’attention sur les visages, les jeux de mains (celui admirable du Christ prenant congé de sa Mère, ca. 1595 avec cette ombre animale qui mange le cœur de Jésus…) et toujours la délicatesse du geste qui se pose sur la poitrine, un livre, un crâne avec quelquefois un doigt d’attention dressé et aussi la luxuriante cascade des drapés (cette déclinaison des blancs du Saint-Barthélemy, 1610-14).
Un style, une densité et une tension narrative* qui fascine et que s’approprie Picasso d’abord par l’assimilation du geste – nombreux croquis de ses débuts dans la première salle – avec des fraises, des barbichettes ou ces visages légèrement allongés. Un univers à la Don Quichotte qu’il s’amuse à mettre en scène dans un bar de Montmartre (Pepe Romeu et autres croquis ca. 1899). En 1962, il linogravera même le cadre assorti de L’homme à la fraise et du Portrait de Jacqueline à la fraise. S’il transfère les nuées du siècle d’or dans les cieux des funérailles de son ami, ses « anges » nus évoquent sans ambiguïté des prostituées. À Bâle, cette Évocation est mise en regard avec L’Adoration du Nom de Jésus (1577-79) dont la composition est plus proche que celle de L’enterrement du comte d’Orgaz (1586-88) souvent cité : sur la droite, le porche de la toile de Picasso rappelle la gueule d’enfer du Greco et les nuages articulent terre et ciel de façon comparable.
Par-delà les anecdotes, c’est la structure qui intéresse Picasso dans les œuvres du Greco : autant l’articulation posturale des corps que l’organisation générale de ses toiles. Sans oublier la vitalité interne : comment la puissance de la composition surgit de l’énergie du sujet. Dans le Christ chassant les marchands du Temple (1610-14), le tourbillon des corps flagellés amplifie le mouvement du geste christique et le traitement de la couleur le renforce – le carmin central glacé de blanc de Jésus s’évaporant en grisaille vers la périphérie. La Crucifixion (1930) de Picasso est légitimement mise en parallèle en dépit de choix inverses : des tons vifs et chauds qui sont absorbés comme dans un trou noir par la grisaille centrale du crucifié.

(Tate Modern, London)
Dans les toiles cubistes, le sujet se détache moins du fond
que chez le Greco, mais sa quête d’épure retrouve la grâce souvent méditative des
poses du XVIe (Nu assis ou Femme assise dans un fauteuil,
1910).
Et comment ne pas imaginer que l’exigeante pureté du geste, la netteté
éloquente des mains peintes par le Crétois ne se prolongent pas dans celles
brutes et impératives omniprésentes chez Picasso ? de même, que les vastes
amandes des yeux implorants (comme chez cette Magdalène déjà citée) ne lui
inspirent ces grands yeux dont l’implantation sur le même profil renforce
l’abyssale détresse ou l’arrogance ?
Des caractéristiques bien présentes également dans le célébrissime Guernica
(1937, non présenté à Bâle) – il convient d’y ajouter les bouches hurlantes.
« Toute image est une maison hantée, toute maison est hantée par les images » comme l’écrit Jean-Christophe Bailly (L’imagement, 2020). Et El Greco est le bienheureux fantôme de la maison Picasso !

Property of the parish church of San Nicolás de Bari – Archdiocese de Toledo, Spain; on permanent loan to the Museo de Santa Cruz de Toledo
*Dans ce Christ prenant congé de sa Mère, l’envoûtant jeu de
mains n’est pas jeu de vilains, mais vecteur de narration.
La lumière du visage de Marie impose le récit (et la gueule d’ombre sur le cœur du Christ) : « même si tu montes au ciel, ton départ me mange le cœur ! » Si le velouté des ombres dissimule les stigmates du Ressuscité, le geste de la mère – à main gauche – ravive la douleur de la malemort.
Mains… et regards.
Des regards qui se voient… ailleurs !
Un temps infime entre deux Temps et, malgré la Résurrection, un Temps de douleur et de séparation. S’esquisse une chorégraphie de partage pour le Temps à venir où les regards ne se toucheront plus et les mains ne se verront plus.
Ce rectangle des mains à la fois scelle et circonscrit l’accordance et la proximité de la Mère et du Fils dans un autre espace, un autre Temps. À venir…
Luc Maechel
Commissariat : Carmen Giménez,
avec Gabriel Dette, Josef Helfenstein et Ana Mingot
Kunstmuseum Basel | Neubau / 11.06. – 25.09.2022
du mardi au dimanche de 10h à 18h (jusqu’à 20h le mercredi)
http:// https://kunstmuseumbasel.ch/fr/
catalogue 44 €
Image de l’entête : El Greco (atelier), Mater Dolorosa, ca. 1587–90, huile sur toile, 62 x 42 cm & Pablo Picasso, Tête de femme, 1908, aquarelle et crayon sur papier, 34 x 21 cm (Staatlische Museum zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz)