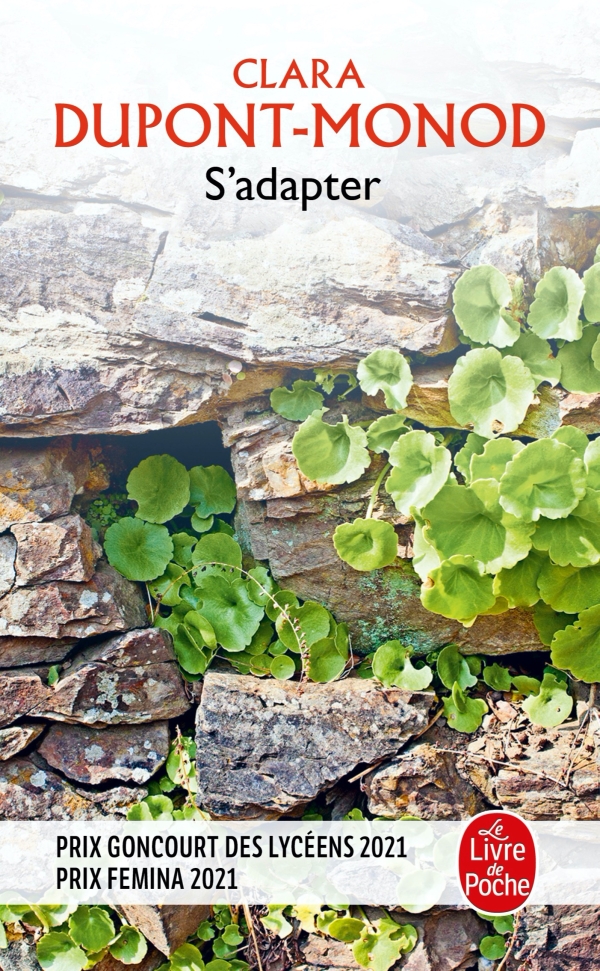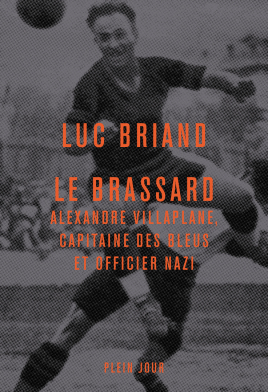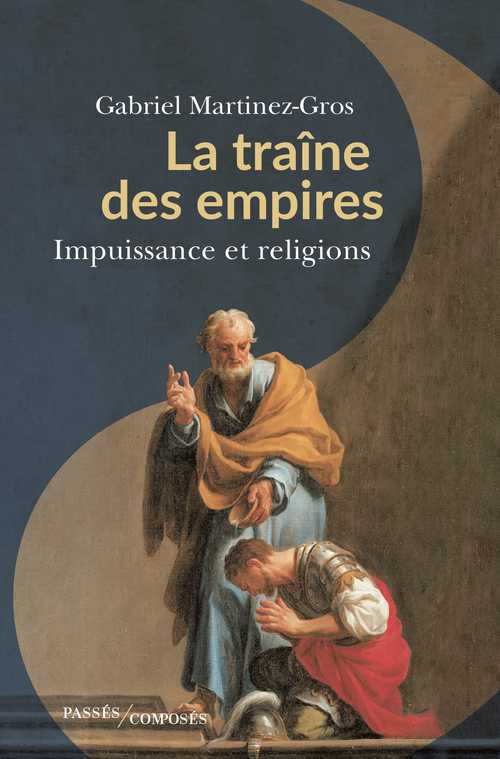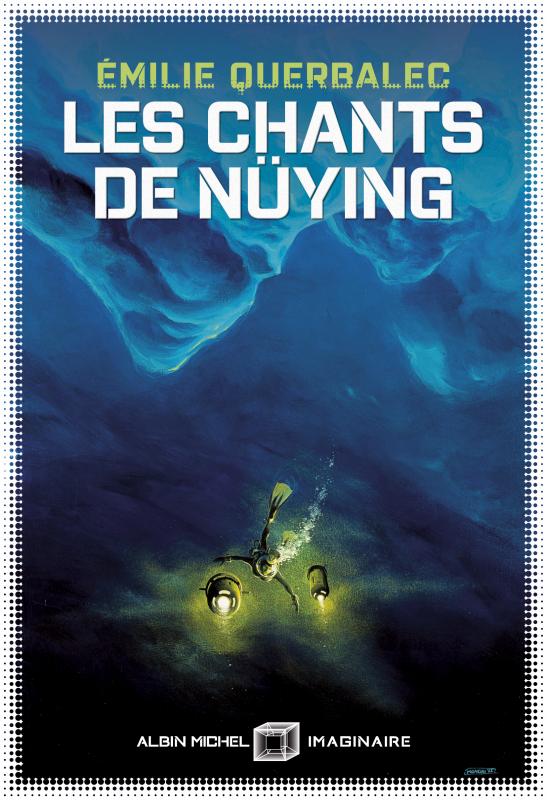La rentrée littéraire des poches permet également de découvrir certains ouvrages couronnés ou ayant marqué l’actualité et les lecteurs. Petite séance de rattrapage
Clara Dupont-Monod, S’adapter, Le Livre de poche, 144 p.
Prix Femina, Goncourt des lycéens, le roman de Clara Dupont-Monod explore l’arrivée d’un enfant handicapé, « inadapté » dans une famille. Tour à tour, les membres de cette famille vont voir leur vie changer à jamais : l’aîné et sa bonté princière dont il restera prisonnier ; la cadette dont le désarroi constituera le moteur son épanouissement futur ; le dernier portant le deuil du frère disparu.
S’adapter est un livre qui replace les sentiments humains au cœur de nos vies. Un livre magnifique sur la construction identitaire de chacun, polie comme un bronze par les épreuves. Un livre sur ces échafaudages complexes et fragiles que sont les fratries. Un livre sur la famille, ce corps vivant en perpétuelle évolution, capable à la fois de fragilité et de résilience. Un livre d’une beauté absolue. Un livre qui fait du bien.
Anne Berest, La carte postale, Le Livre de poche, 576 p.

Un jour de 2003, une carte postale anonyme arrive dans la boîte aux lettres de la mère de l’auteure. Elle montre une photo de l’opéra Garnier. A côté sont inscrits les prénoms de membres de sa famille morts à Auschwitz en 1942. Cette carte va passer dix-huit ans dans un tiroir avant de ressurgir avec son cortège d’ombres. S’emparant de cette incroyable histoire, Anne Berest, auteure des Patriarches (Grasset, 2012) se lance alors dans une folle enquête pour construire un récit palpitant qui suit la vie des Rabinovitch avant et pendant la seconde guerre mondiale, entre Palestine et Auschwitz.
Prix Renaudot des lycéens 2021, Grand Prix des lectrices Elle, Grand Prix des Blogueurs littéraires, La carte postale se lit comme un roman, celui de la destinée d’une famille durant cette première partie du 20e siècle, dans cette Europe qui plongea, à l’image des Rabinovitch, dans les ténèbres. Un livre impossible à lâcher avant la dernière page. Sauf qu’à la différence d’un roman, tout est vrai.
Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux, 10/18, 600 p.

En matière de littérature étrangère, il ne faudra pas passer à côté du dernier livre de Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux. Grand prix de littérature américaine 2021, cette saga familiale s’étalant sur près de cinquante ans suit le destin d’Eleanor, illustratrice de livres pour enfants et de sa famille. Dans cette maison du New Hampshire, à l’ombre du grand frêne, cette famille grandit, avec ses hauts et ses bas.
Comme dans tout grand roman américain, la violence, sourde ou explosive, n’est jamais loin. Et lorsqu’elle surgit, le monde familial idéalisé d’Eleanor vole en éclats. Il faudra du courage, de la résilience à Eleanor et aux siens pour recoller les morceaux.
Ce livre est magnifique car il nous offre un miroir, celui de nos vies familiales traversées par ses joies et ses drames. Le lecteur est là. Il est tantôt Alison, la fille, tantôt Cam, le mari. Un livre qui nous fait prendre conscience de la brièveté de la vie, de l’impérieuse nécessité de partager du temps avec les siens. Un livre à relire à chaque âge de la vie. Un bijou du « grand roman américain » par l’une des plus belles plumes anglo-saxonnes.
Par Laurent Pfaadt