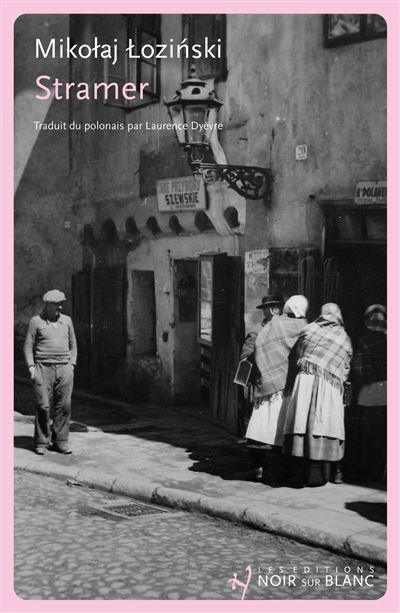Lors du récent concert de l’OPS les 13 et 14 octobre derniers, deux œuvres de Tchaïkovski, le grand poème symphonique de jeunesse Roméo et Juliette et la cinquième symphonie encadraient Schlomo, la symphonie hébraïque du compositeur suisse Ernest Bloch.

Outre la beauté de toutes ces œuvres, la venue du jeune Edgar Moreau pour la partie violoncelle de Schlomo et l’interprétation de Tchaïkovski par Aziz Shokhakimov, le directeur musical de l’orchestre, rendaient la soirée particulièrement attirante. Elle fut captivante d’un bout à l’autre. L’atmosphère tour à tour recueillie et poignante de Schlomo, partition écrite en pleine première guerre mondiale, fut restituée avec beaucoup de tact et de mesure, tant chez le soliste que du côté de l’orchestre. En harmonie avec la direction sobre et colorée du chef, le son du violoncelle s’est montré d’une grande plénitude, d’un archet fin, dense mais sans la moindre lourdeur ; la corde grave de l’instrument étant, il est vrai, très peu sollicitée dans cette partition. Offerte en bis le premier soir, la sarabande de la troisième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach sous les doigts d’Edgar Moreau sortait de l’ordinaire : habitée, concentrée en même temps que très pudique, avec un son ténu, proche de celui d’une viole de gambe. Magnifique.
De nombreux micros flottaient au-dessus de la scène pour capter les deux œuvres de Tchaïkovski, en vue d’une publication prochaine chez Warner. Bien qu’originaire d’une ancienne république soviétique (l’Ouzbékistan), Shokhakimov ne les inscrit pas vraiment dans la grande tradition russe, celle mélancolique et tempétueuse d’un Svetlanov, ou d’une noirceur hautaine comme chez Mravinsky. Dès Roméo et Juliette et plus encore dans la cinquième symphonie, on entendit un orchestre ménageant de beaux contrastes entre lumière et notes sombres, sans que celles-ci ne prennent jamais le dessus. Somme toute une interprétation aussi intéressante qu’inattendue, retrouvant, à sa manière, une école française de la clarté et de la mesure, comme jadis les chefs Pierre Monteux, Paul Paray ou Alain Lombard qui nous ont tous laissé de beaux témoignages dans ce répertoire. Avec Shokhakimov, l’allegro final sonne comme une victoire indiscutable sur les forces hostiles qui assombrissent les deux premiers mouvements. Le jeu d’orchestre, de grande allure, témoigne d’un bon travail en répétition et d’une belle entente entre chef et musiciens.
Michel Le Gris