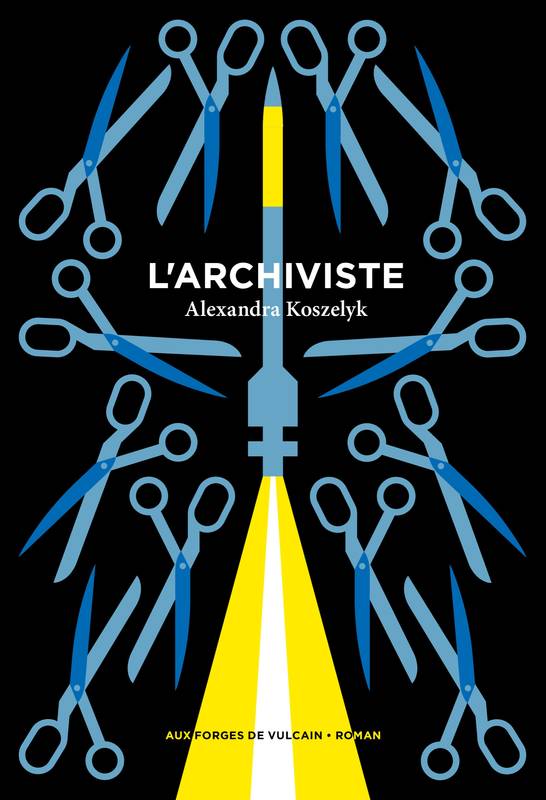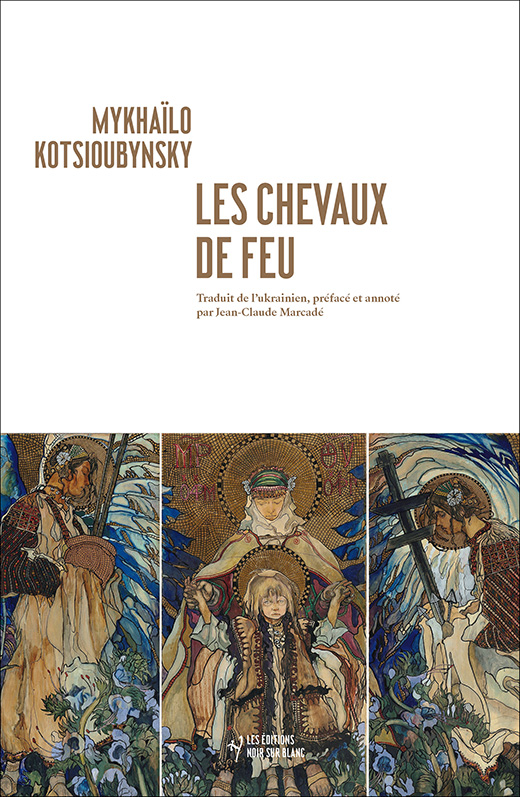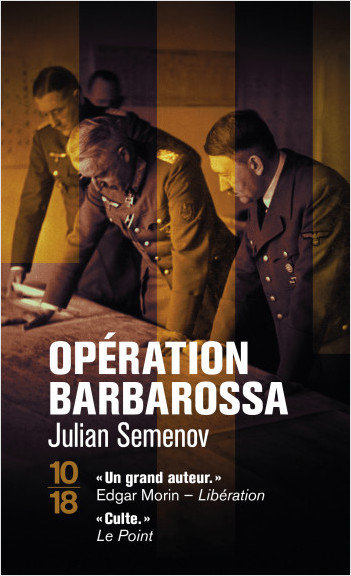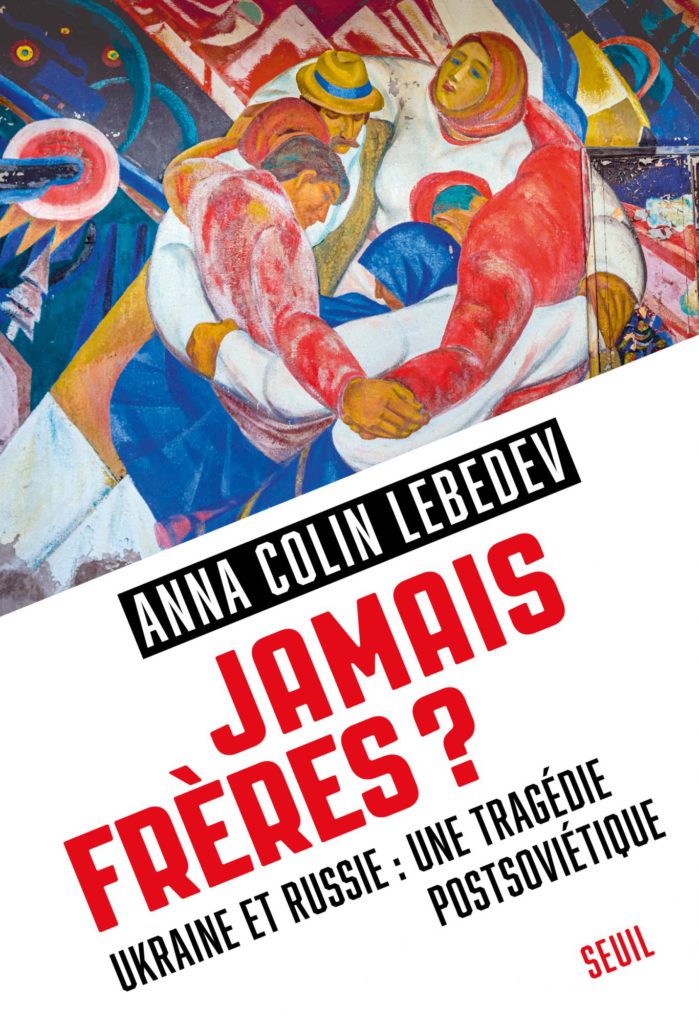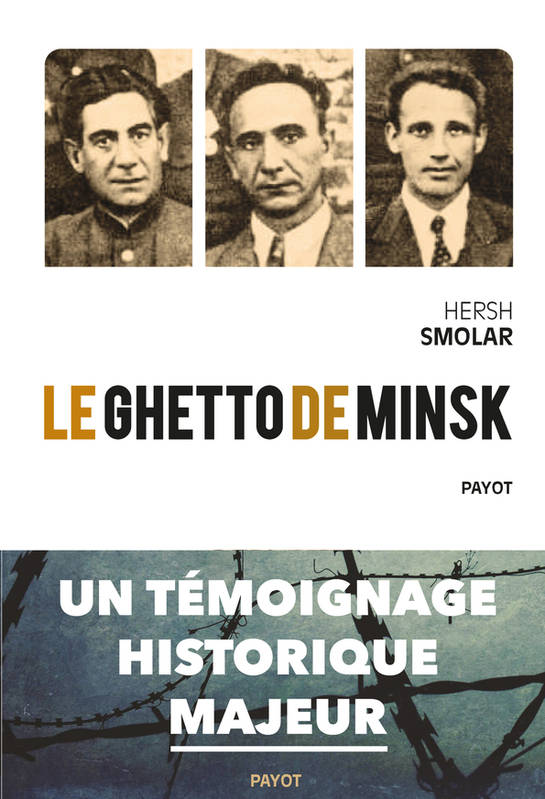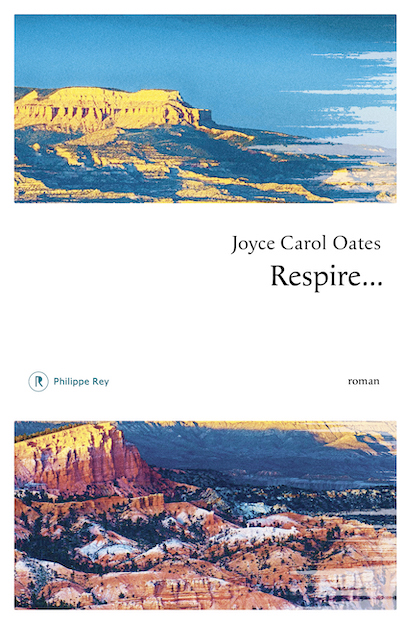Sonia Chambretto, à la demande de Stanislas Nordey, propose un texte bien dans l’air du temps sur les conséquences du dérèglement climatique, aux élèves des Groupes 46 et 47 de l’Ecole du TNS afin qu’ils en présentent quatre mises en scène différentes.
Il est, en effet, intéressant de voir comment chaque metteur en scène interprète un texte selon sa sensibilité et ses critères artistiques.
Le hasard dû à la distribution des billets selon la disponibilité des salles, nous a conduit à assister successivement à deux mises en scène conçues de manière bien différente.
Pour la première intitulée « Anti-atlas » elle est signée Ivan Marquez du groupe 47, assisté de Sarah Cohen avec à la dramaturgie Marion Stenton. lls proposent aux comédiens ,Yanis Boulerrache, Kadir Ersoy, Simon Jacquard, Lucie Rouxel un jeu assez complexe qui les met en demeure de manipuler nombre d’objets, tels, par exemple, que caméras vidéo, micros, rubans de scotch, seaux et tas de terre. Le plateau devient un chantier en perpétuel chamboulement (scénographie Sarah Barzic) à l’image de l’état catastrophique du monde, énoncé par les acteurs qui viennent, chacun à sa façon en apporter témoignage.
Et tout commence par ce constat « l’eau monte » répété à l’envi et presque comme un prélude à toutes ces catastrophes que le spectacle se chargera de mettre en évidence. Moment très pertinent, celui, au début de la représentation, où la jeune fille imagine les conséquences d’un éventuel mais probable ouragan sur son quotidien, elle qui aime dormir nue en raison de la chaleur et de l’humidité, elle ne pourra plus le faire car si l’ouragan survenait elle devrait fuir très vite et risquerait de se retrouver nue dans la rue, ce qui est inenvisageable. Petit exemple des conséquences des catastrophes qui vont survenir et impacter la vie des gens.
A l’évidence il y a plus grave et c’est l’interrogation du personnage du journaliste chargé d’enquêter sur les réfugiés climatiques, les déplacés. Sachant qu’ils sont des millions, il déplore sans cesse de ne pas les trouver et va de ci de là, micro tendu, sans se départir de sa quête.
Cependant, un assez long développement sur la Chine permet d’en concrétiser la réalité, même si, là encore, personne n’apporte à l’enquêteur les réponses attendues alors que sont évoqués les chantiers d’autoroute et de barrages qui ont chassé les habitants des petits villages, et ce, à grands renforts de bruitage d’explosion (son Léa Bonhomme) et de projections d’images (vidéo Charlotte Moussié).
Les comédiens en tenue de chantier (costumes Ninon Le Chevalier) interviennent à tout va pour parfaire cette démonstration de ce qui est et qu’on refuse de dire explicitement. On éclaire les visages avec des lampes de poche (Zoé Robert), on escalade les praticables, on s’y cache.
On dénonce les origines de la crise. En anoraks et bonnets, les comédiens annoncent la disparition des glaciers avant que l’un d’eux, à moitié dénudé ne se mette à ramper sur le sol pour jouer le léopard des neiges en voie de disparition et qu’un autre déguisé en ours polaire ne s’empare d’un micro pour, d’adressant à son auditoire, assis devant lui énumère les catastrophes déjà répertoriées ou à venir.
Une mise en scène riche de nombreuses propositions de jeu au caractère parfois trop illustratif mais incontestablement déterminée à ne rien omettre du texte proposé.
Représentation du 5 novembre
Ce même jour nous avons pu assister au spectacle « La Taïga court » intitulé « Bleu Béton » mis en scène par Thimotée Israël du groupe 46 de l’Ecole du TNS
Nous rencontrons ici une proposition, bien différente de la précédente, plutôt minimaliste avec une scénographie, très épurée, offrant au plateau une sorte d’estrade carrée surmontée d’un énorme cube qui semble symboliser la menace qui pèse sur la planète (scénographie Dimitri Lenin).
Les comédiens, Jade Emmanuel, Thomas Stachorsky, Manon Xardel, et Thimotée Israël surgissent, l’un après l’autre de derrière l’estrade et se plaçant en son centre viennent à jouer le texte de la pièce. Tout est dit, dans la pénombre (lumière Simon Anquetil) avec une certaine sobriété, si ce n’est ce cri qui soudain déchire l’air et exprime l’effroi devant la catastrophe (son Manon Poirier).
Chacun se fera donc porteur d’un récit témoignant de l’angoisse, de la peur, de la solitude face à ce dérèglement climatique qui engendre la fonte des glaciers, la montée des eaux, quand, par ailleurs, comme en Chine, les grands travaux d’urbanisation chassent les gens de leurs villages.
Chaque comédien par son attitude, le choix même de son costume (Loïse Beauseigneur) manifeste ce qu’il éprouve en mesurant l’ampleur des dégâts qui surviennent chaque jour de plus en plus nombreux.
Pièce courte mais suffisamment évocatrice pour qu’elle nous conduise à nous interroger sur notre façon de percevoir l’avenir apocalyptique qui guette l’humanité.
Troisième mise en scène de « La Taïga court », celle intitulée « première cérémonie » mise en scène d’Antoine Hespel du Groupe 46 avec comme assistant Tristan Schintz, dramaturge du Groupe 48.
Dès l’entrée dans le studio Jean-Pierre Vincent où va avoir lieu la représentation, c’est la surprise, nous sommes accueillis avec empressement par une hôtesse qui nous remet en bonne et due forme le programme de la soirée et nous donne le choix d’une boisson car nous sommes bel et bien des invités et on nous conduits derechef à prendre place dans un fauteuil ou sur un canapé, ambiance cosy avec petites tables et lumières douces. En face de nous un écran sur lequel, figure en pointillés lumineux le dessin d’un continent indéterminé (scénographie Valentine Lê, Lumière et son Thomas Cany ).
C’est là, dans ce cabaret de luxe que les comédiens des groupes 46 et47 de l’Ecole du TNS, Jonathan Bénéteau de La Prairie, Yann Del Puppo, Quentin Ehret, Felipe Fonseca Nobre, Charlotte Issaly, Vincent Pacaud, vont nous présenter les différents « numéros » inscrits au programme de la soirée. Une maîtresse de cérémonie bien maquillée, habillée « classe » (costumes Clara Hubert) se charge de les introduire, commençant sa prestation, en répétant, sur un fond de grand bruit et de plus en plus fort, les mots fatidiques « l’eau monte ».
Puis apparaît, installé dans une petite alcôve, un jeune homme qui parle de son problème d’aimer dormir nu ce qu’il ne peut plus envisager de faire en raison des risques d’ouragan qui l’obligeraient à se retrouver nu dans la rue, impensable évidemment.
Quand la jeune femme traverse l’espace scénique avec sa longue traîne en papier d’alu on comprend qu’on est au début d’une sorte de défilé de mode où les tenues originales contredisent le propos. Voici que quelqu’un passe dignement avec pour coiffure un palmier sur la tête, précédant une jeune fille qui a revêtu son gilet de sauvetage, un autre lui succède brandissant un panneau sur lequel se lit en grosses lettres le mot « TSUNAMI » Il est suivi d’un garçon en robe de mariée. Défilé au cours duquel on chantonne et on danse dans l’esprit de cette vieille chanson « tout va très bien Madame la marquise, on déplore un tout petit rien » Minimiser la catastrophe pour continuer à s’adonner au plaisir, un avertissement plein d’humour adressé à ceux que nous représentons les spectateurs conscients mais qui se contentent de regarder, sans rien faire, les calamités-spectacles.
La suite ne va pas démentir ce point de vue. La maitresse de cérémonie introduit l’enquêteur, celui qui s’inquiète de ne pas trouver alors qu’ils sont nombreux, les réfugiés climatiques, les déplacés. Toujours avec empressement, il va interviewer le chinois Lee qui, en tenue traditionnelle, pantalon court et veste rouge, l’air accablé, raconte sa vie, les années Mao, la longue marche, l’armée, les guerres. Le journaliste est dépassé, une voix off derrière l’écran parle de la sécheresse, des inondations. Lee s’en va alors que l’enquêteur se colle à l’écran pour écouter et finit par y pénétrer.
Pour la suite, dans l’ombre, derrière la cloison, avec une lampe de poche, il se met à la recherche de gens et on s’aperçoit que ce sont des SDF. L’explication, c’est qu’il est question de se rapprocher des villes car si l’on fait exploser les montagnes, si on construit des barrages, les gens doivent quitter les villages. Le « Grand Etat » commande à la police de faire partir les villageois et ceux-ci se retrouvent sans terre et sans ressource. Cette séquence est illustrée par des projections de paysages de la Chine.
Et puis soudain nous nous acheminons vers une séquence insolite. Pour nous signifier la fonte des glaciers et la probable disparition des espèces qui y vivent, voilà que nous sommes bousculés par les comédiens qui ont revêtus des costumes d’ours polaires et qui nous obligent à quitter nos sièges pendant que l’ensemble des installations est promptement déménagé et qu’on voit la paroi qui nous fait face se rapprocher de nous, diminuant notre espace vital. Puis elle devient transparente et nous avons la surprise d’apercevoir en face de nous le « cabaret » reconstitué où ce sont les comédiens qui jouent les spectateurs que nous avons été.
A bon entendeur salut. Fin de partie. Mais la leçon est bien envoyée et a des chances de porter.
Un spectacle intelligent et ludique, avec de jeunes acteurs très impliqués dans leurs rôles, pour en finir, peut-être, avec le confort de l’Occidental face au dérèglement climatique qui impacte dangereusement la nature et tous les êtres vivants.
Représentation du 6 novembre
Quatrième mise en scène de « La Taïga court », celle intitulée « Image(s) de Terre » signée Mathilde Waeber du Groupe 47 de L’Ecole du TNS., assistée d’Elsa Revcolevschi, metteure en scène du groupe 48, la dramaturgie est signée Alexandre Ben Mrad
Nous nous retrouvons de part et d’autre d’un long plateau en bois, surélevé par rapport à notre position de spectateurs et au- dessus duquel est installée une suspension métallique composée d’anneaux rivetés. Côté jardin sont disposés des tas de briques, côté cour, le tas a déjà l’air d’une petite construction (scénographie Constant Chassai-Polin).
Deux actrices et deux acteurs, Hameza El Omari, Naïsha Randrianasolo, Cindy Vincent et Sefa Yeboah, tous vêtus de blanc (costumes Jeanne Daniel Nguyen) déambulent autour du plateau avant, l’un après l’autre de l’escalader.
Commence alors un long travail de transport et de pose de briques, d’abord vers le centre du plateau, puis tout autour, des transports et des poses qui se pratiquent lentement, de façon précautionneuse et qui exigent une sorte de retenue, de délicatesse. Les comédiens se prêtent à cette forme d’expression corporelle qui s’apparente à une chorégraphie (préparation performance et corps Jean-Gabriel Manolis, danseur performeur intervenant extérieur). Le fond sonore est une sorte de brouhaha qui s’amplifie au fur et à mesure que la construction avance (son Arthur Màndo).
Au début le travail se fait sans que personne ne parle. Puis la parole se met à circuler. Alors que le brouillard se dissipe et que tout s’écroule dans un grand fracas, quelqu’un dit « ça manque de définition ». Puis chacun, chacune prend en charge le texte de la pièce que nous reconnaissons pour l’avoir entendu dans les mises en scène vues précédemment. La peur des ouragans qui empêche de dormir nue, l’évocation de ce qui s’est passé en Chine, des montagnes bouffées par le progrès qui exige des autoroutes et chasse les gens de leurs villages tenus d’abandonner leurs champs. Il est question des réfugiés climatique, des déplacés nombreux mais dont on nous dissimule l’existence, d’où cette question récurrente « où sont-ils ? » Pour évoquer tous ces problèmes les comédiens prennent des mines graves, certains, assis sur les briques écoutent celui ou celle qui raconte et mime la détresse de ceux qui subissent, impuissants les méfaits de ces grands travaux, que sont, entre autres, la construction des barrages, l’installation des chemins de fer. Simultanément, une jeune femme travaille avec patience et détermination à colmater avec de la terre glaise les brèches de la petite sculpture, située côté Cour de la scène pour réaliser ce que la metteure en scène appelle dans sa présentation une imitation des « Giant-s Causeway ,architecture naturelle présente en Irlande », une élaboration qui semble défier les destructions partout annoncées et dont l’imminence sera bientôt confirmée quand un des comédiens s’emparant du micro , s’adressant directement au public déclamera haut et fort, avec force gestes, en les énumérant, les catastrophes qui guettent le monde : Les eaux qui montent, les glaciers qui fondent et tout ce qui en est impacté, citant dans un inventaire à la Prévert la neige, les sources, les mousses, les chouettes, les lacs…
Un travail pertinent qui se veut avertissement avec des jeunes artistes bien déterminés à faire passer le message.
Marie-Françoise Grislin
Représentation du 8 novembre
En conclusion, ces quatre mises en scène constituent une expérience enrichissante autant pour les élèves de l’Ecole que pour nous spectateurs curieux de découvrir les différentes interprétations d’un même texte.