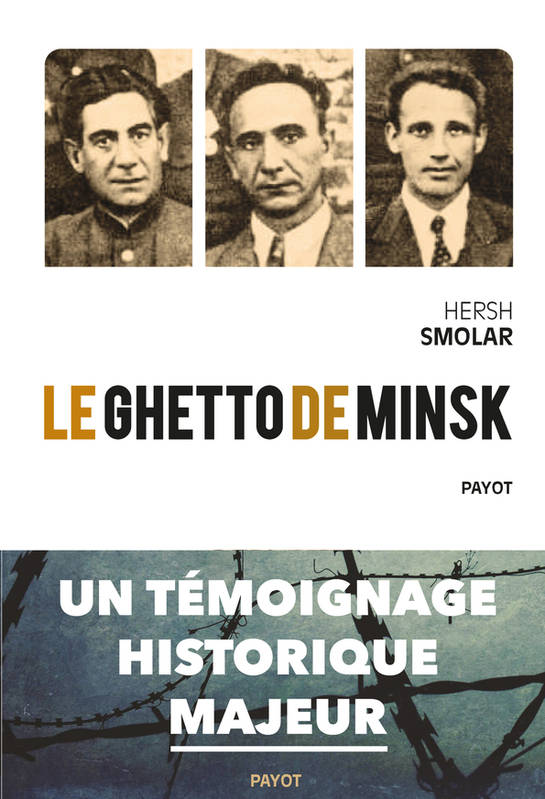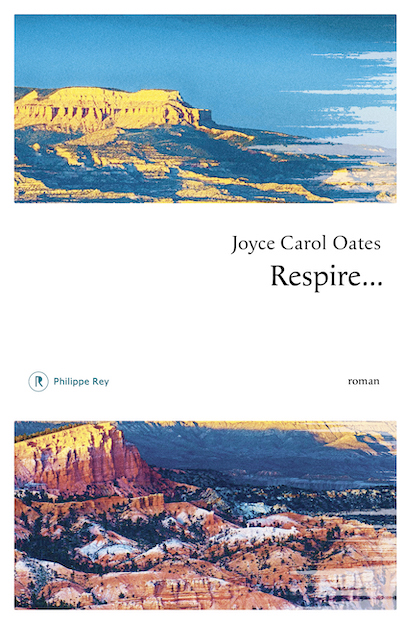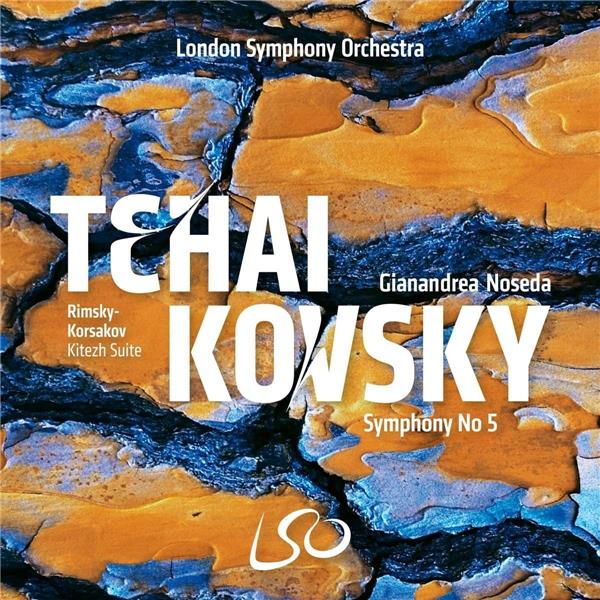L’épidémie de Covid 19 nous en avait privé mais cette fois-ci la pièce est bel et bien là, au TNS et nous nous en réjouissons.
C’est une pièce qui interpelle aussi bien par son contenu que par sa forme. De l’auteur, Marie Ndiaye, artiste associée au TNS nous avions pu voir « Hilda » en octobre 2021 et « Les Serpents » en avril 2022 qui, toutes deux nous avaient impressionnés par les situations humaines, bouleversantes qu’elles révélaient.
Il en est de même avec « Berlin mon garçon » qui
répond à une commande de Stanislas Nordey à propos du terrorisme et nous conte
l’histoire d’un adolescent qui quitte soudainement sa famille pour aller vivre
à Berlin mais ne donne aucune nouvelle de lui et reste injoignable.
C’est l’histoire de cette mère, Marina, qui n’y tenant plus
décide de se rendre à Berlin pour le retrouver et le ramener avec elle à Chinon
où, avec son mari, Lenny, elle tient une librairie.
Son arrivée à Berlin lui réserve quelques surprises, celle
de découvrir une ville surprenante, décevante, pour ainsi dire maléfique à ses yeux,
alors que nous voyons projetés sur l’écran en fond de scène un défilé de
magnifiques points de vue, en noir et blanc, sur l’architecture du Berlin
reconstruit après la guerre (scénographie Emmanuel Clolus)
Surprise aussi celle d’être attendue à son arrivée par son futur logeur, un certain Rüdiger, enfin d’apprendre, par celui-ci, que, d’après les nouvelles lois en vigueur, il sera présent dans le logement qu’elle a retenu chez lui dans le Corbusierhaus, ce grand ensemble d’immeubles, imitation de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille.
Elle est là, dans cet espace gris et vide, petite femme bien droite dans son manteau orange, (costumière Anaïs Romand) exposant son point de vue sur Berlin, ville de liberté, de plaisirs qui aurait attiré son fils et annonçant la quête qu’elle entend y mener. Lui, Rüdiger, se rapprochant d’elle, confie le tourment que lui cause cette cohabitation imposée par les récentes directives de location, sans oublier ces choucas, oiseaux noirs, nombreux et bruyants qui volent au-dessus de l’immeuble et risquent d’importuner son hôte. Mais, ces considérations sont formulées comme un discours intérieur qu’il destine à lui seul, de même pour son autoportrait où il se dit
« homme gentil et serviable ». Cette forme de discours indirect avec souvent l’emploi de l’imparfait est pour le moins originale et sera de mise à maintes reprises au cours des rencontres que cette aventure va susciter. Une cohabitation des discours, en quelque sorte, une forme de distanciation pertinente puisqu’elle correspond aux mondes parallèles dans lesquels vivent les protagonistes. Ainsi, présentement, elle, obsédée par la recherche de son fils ne parlant que de cela et lui, rompant avec la discrétion qu’il voulait s’imposer, décidant de l’aider.
Bientôt, nous serons dans un autre lieu mais auparavant, c’est le noir sur le plateau et la projection d’ un dessin animé représentant Pinocchio avec des oreilles d’âne, allusion évidente à la désobéissance des enfants qui se laissent facilement séduire par de fallacieuses promesses (vidéo Jérémie Bernaert).
Nous sommes maintenant à Chinon. Autour du plateau, des
livres ont été disposés C’est la librairie tenue par Marina et Lenny un lieu de
culture dont Lenny est fier et non une « boutique » comme sa mère, Esther
se complaît à le dire, il le lui signale violemment lors de sa visite. Leur
rencontre est houleuse. Elle est venue le voir pour parler de son petit-fils
dont l’absence l’inquiète et de ce silence que son fils maintient à ce propos,
silence qu’elle juge dommageable car elle craint le pire concernant le jeune
homme. Elle le met en demeure de prendre ses responsabilités et d’aller lui
aussi le chercher. Femme autoritaire, elle prétend pénétrer dans les pensées de
son fils et lui-même avouera « ma mère parle en moi ».
Après un nouvel intermède où l’on revoit un Pinocchio aux
oreilles d’âne encore plus longues, on retrouve dans son appartement Marina qui
reçoit Charlotte, la dernière compagne du fils dont elle est sans nouvelle. Rudiger
assiste à leur entretien, chargé de traduire les propos de Charlotte et coup de
théâtre, voilà qu’il prend en charge la situation et donne à entendre ce qu’il
pense rassurant pour Marina et qui est l’inverse de ce que raconte la jeune fille
dont le visage apparaît en gros plan sur l’écran et témoigne de son angoisse,
des craintes qui l’habitent concernant les projets du garçon, capable, si ce
n’est déjà fait, d’accomplir l’irréparable. Elle évoque cela, mais Rüdiger
traduit à Marina que le garçon va bien et qu’il est parti à Munich. Elle fait
semblant de l’admettre malgré les doutes qui subsistent en elle en voyant le visage
affligé de Charlotte.
Quand nous retournerons dans la libraire ce sera pour
entendre Esther adjurer Lenny de partir à Berlin avec ce viatique qu’elle
répète tournée vers le public « va mon enfant et ne commets pas de
faute ». C’est sa morale, celle, pense-t-elle, que les parents n’ont pas
inculquée à leur fils.
Lenny ira à Berlin, prêt à fouiller la ville, affirme-t-il
pour le retrouver et changer ses tristes habits contre « la chemise à
fleurs » qu’il lui destine. Mais Marina qui se souvient que Lenny a été
« glacé » pense-t-elle, avec
son fils et lui a souvent parlé durement, lui demande de rentrer à Chinon,
puisque, d’après ce qu’on lui a dit, le garçon
est parti vivre sa vie à Munich.
Quant à elle, elle renonce à aller à Munich et réconciliée avec
Berlin, de s’y installer, délivrée de sa culpabilité.
Le texte de et Marie Ndiaye aborde la grande question de
l’éducation des enfants, de la façon dont on les aime et de la culpabilité que
l’on peut éprouver lorsque ceux-ci prennent un chemin qui les amène au bord du
gouffre. Comme elle le fait dire par le personnage de
Charlotte ; « demandez-lui ce qu’il a vécu d’effroyable à Chinon
pour transporter jusqu’à Berlin un cœur si haineux ». Il met aussi en
exergue le mystère de chaque être, la liberté individuelle, l’émancipation dont
Marina donne l’exemple et la solidarité dont fait preuve Rüdiger à son égard.
Tout cela exprimé dans une langue superbement travaillée et
dans un style qui privilégie le discours intérieur, les adresses imaginées à
l’interlocuteur présent ou non, la parole qui devient narrative, formes dont
nous sommes amenés à faire usage dans certaines circonstances.
La mise en scène pertinente de Stanislas Nordey donne toute
sa place au texte et au jeu des comédiens particulièrement bien choisis pour
cette délicate interprétation.
Hélène Alexandridis campe une Marina, femme à la fois fragile et
forte, angoissée par le départ inopiné de son fils, mais déterminée, volontaire, capable de se
métamorphoser pour s’en sortir, toujours debout, la comédienne assume la partition complexe
que son rôle lui réserve à côté de Claude Duparfait qui, lui, est le logeur un
peu complexé mais attentif, sachant dépasser sa maladresse pour se faire
menteur, sauveur.
Laurent Sauvage se présente, à l’opposé, comme un Lenny , volontiers fier et hâbleur,
parlant fort et facilement accusateur, révélant une certaine dépendance
vis-à-vis d’Esther, sa mère, dont le rôle tenu par Annie Mercier impressionne
car la comédienne à la voix rauque
sait se montrer envahissante et
péremptoire, captant l’attention du public pour donner ses conseils de bonne
éducatrice.
Dea Liane fait une Charlotte désemparée, avertisseuse de la
catastrophe qui guette le garçon, son ex- petit ami et qui, sans hésitation,
remet en cause sa vie d’avant à Chinon où une cliente de la librairie jouée par
Sophie Mihran dit avoir vu changer le garçon au cours de son adolescence.
Une pièce qui ne manque pas de questionner notre sens de la
responsabilité soumis aux aléas du mystère de l’être humain.
Marie-Françoise Grislin
Représentation du 9 novembre
A l’affiche jusqu’au 19 novembre au TNS