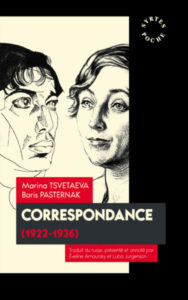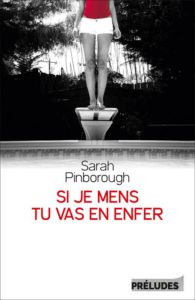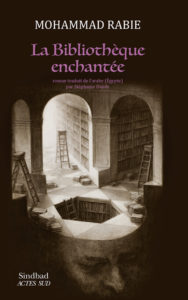D’un côté on ne savait pas trop à quoi s’attendre, on avait évoqué » un festin sur scène « … et on se disait » Pourquoi pas ? » cela, bien sûr nous intriguait. D’un autre côté, on parlait de chorégraphie, de musique. Alors, oui pourquoi pas ?
On a retenu nos places.
On n’a pas été déçu et on a tout eu… depuis une préparation de repas sous la houlette d’une cuisinière, matrone, évidemment la seule femme de cette entreprise qui se révèle être la mère du chorégraphe Omar Rajeh qui a concocté ce spectacle pour le moins original, l’a mis en scène et y participe avec toute la virtuosité du danseur qu’il est jusqu’à la musique et la danse.
Autour de la très grande table s’affairent au découpage des légumes de saison, poireaux, carottes, céleri et choux, les » petites mains » qui jouent avec un enthousiasme non feint avec les couteaux affûtés et jettent avec précision les morceaux de légumes dans l’immense saladier prévu à cet effet. Quelques notes accompagnent cette activité à laquelle tous s’appliquent très consciencieusement. Le percussionniste placé en bout de table impulse le rythme et donne du coeur à l’ouvrage.
Soudain, l’un des commis se détache de la table pour entamer une danse frénétique.
La cuisine, c’est bien parti, le spectacle aussi avec des séquences, où, la table repoussée pour dégager l’espace, des danseurs de haut niveau tels des athlètes qualifiés de même, viennent nous éblouir par leurs prestations où l’énergie le dispute à la souplesse, à la virtuosité, à la grâce. Ils multiplient les effets, l’inventivité des figures. C’est stupéfiante, magnifique.
Parfois c’est un solo qui nous captive, parfois ils sont ensemble, par deux, par trois ou quatre, se défiant, s’approchant l’un de l’autre jusqu’au contact, en complicité, en rivalité. Il y a là, le togolais Anani Dodji Sanouvi, le coréen Moonsuk Choi, Koen Augustijnen de Belgique tous et bien sûr, Omar Rajeh avec leur particularité culturelle. Les musiciens, Ziad Ahmadie, Samir Nasr Eddine, Ziyad Sahhab scandent leur gestuelle au rythme de l’oud appuyés par le percussionniste Youssef Hbeisch les soutiennent dans leur performance, les propulsent semble-t-il jusqu’au paroxysme de ce que leur corps réussit à effectuer.
On les attend encore quand ils s’arrêtent pour reprendre, derrière la table leur travail de cuisinier. On les voudrait encore, danseurs et musiciens quand ils nous invitent à partager le repas nous offrant les premières assiettes pleines de cette salade aux légumes variés, aux multiples couleurs et saveurs.
Puis les spectateurs sont invités à venir se servir. Alors on y va et on déguste salade fraîche, plat chaud de lentilles et haricots et on peut même boire un petit raki !
C’est vivant, joyeux, abondant, convivial. Le public a du mal à quitter le plateau, du coup, ceux qui se sont rassis ne voient pas trop » l’invitée surprise » qui exécute d’habiles figures et de parfaites voltiges. Finalement, danseurs et musiciens reprennent leurs danses, leurs joutes. On a l’impression d’être sur la place d’un village en fête.
Un spectacle étonnant, ludique qui apporte lumière, soleil et chaleur humaine, dans ces nuits de grisaille et de froidure.
Par Marie-Françoise Grislin
 L’immense pianiste et compositeur
L’immense pianiste et compositeur