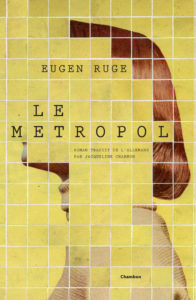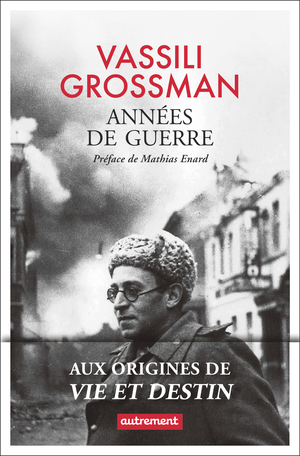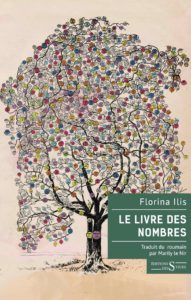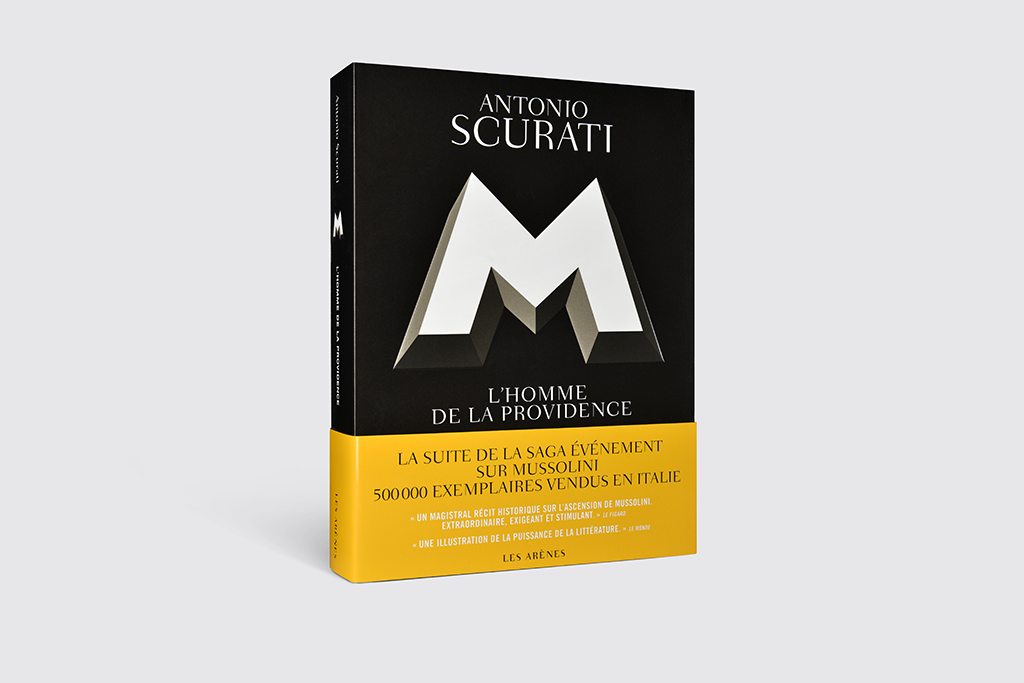C’est un peu le dessous des cartes historiques, celles qui traduisent
les mouvements de fonds, les grands bouleversements mais
également celles qui dévoilent les ambitions des uns et des autres.
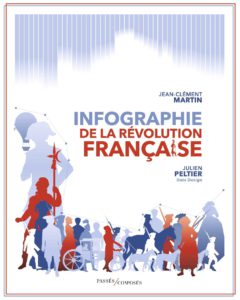
Même les plus avertis se passionneront pour ce livre. Elaboré par
Jean-Clément Martin, éminent spécialiste de la Révolution française
– on lui doit une biographie de référence de Robespierre (Perrin,
2015) – et aidé du data designer Julien Peltier, ce livre fort
didactique permet d’embrasser la totalité de la Révolution française
d’un seul coup d’œil, de la replacer sur le temps long et non plus sur
quelques évènements isolés comme la mort du roi ou la Terreur.
Diagrammes, schémas, courtes biographies à l’appui, l’auteur nous
explique ainsi l’émergence du phénomène révolutionnaire, l’un des
éléments majeurs des siècles passés des histoires de France, de
l’Europe et du monde ainsi que ses développements. On y trouve
une foule de données – comme ces 17 000 guillotinés – mais
également les portraits des principaux acteurs, des plus connus
(Danton, Robespierre) à quelques figures singulières telles Jean-
Baptiste Carrier, actif à Nantes pendant la Terreur ou Stanislas-
Marie Maillard, le « grand juge de l’Abbaye ». L’ouvrage passe
aisément des colonies et de l’esclavage à la disparition des femmes
de la sphère politique que la Révolution française ambitionnait
pourtant d’émanciper et à la guerre intérieure et extérieure, et
permet ainsi de comprendre les enjeux complexes et multidimensionnels de cette révolution.
Tous les enfants de la République pensent que la Révolution
française s’est achevée avec la mort de Robespierre sur l’échafaud le 9 Thermidor 1794. Or, l’ouvrage montre qu’il n’en fut rien et
décrypte brillamment la contre-révolution, phénomène marginalisé
dans l’historiographie française qui conduisit pourtant à la réaction
autoritaire du Directoire, du Consulat et finalement à l’Empire. C’est
véritablement l’une des grandes réussites de ce type d’ouvrage, celle
d’éclairer ces périodes charnières, ici en l’occurrence les années
1795-1799. Jean-Clément Martin explique ainsi parfaitement
l’évolution du terme de contre-révolutionnaire. D’opposant à la
Révolution au début de cette dernière, il est ensuite devenu un
terme générique pour qualifier tous les ennemis de la Révolution
avant de désigner les tenants d’un retour à une monarchie
inégalitaire. Grâce à lui, nous comprenons un peu mieux ces cartes
que jouèrent avec maestria les Talleyrand, Fouché et bien
évidemment Bonaparte.
Par Laurent Pfaadt
Jean-Clément Martin, Julien Peltier, Infographie de la Révolution française,
Aux éditions Passés composés, 128 p.