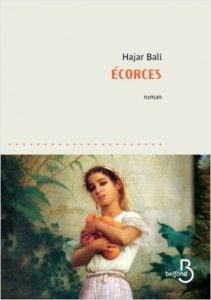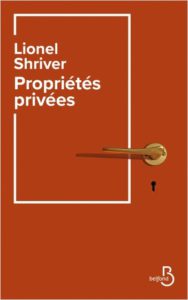Plusieurs ouvrages reviennent sur l’antisémitisme en Russie et
en Pologne au 20e siècle
Tout part de l’affaire d’un officier accusé à tort d’espionnage et
devenue le prétexte d’une vague antisémite. Dreyfus bien
évidemment. Non, Serguei Miassoïedov dont l’histoire est narrée
dans cette fresque passionnante de bout en bout et digne des plus
grands romans russes avec ses énigmes à tiroirs et ses
personnages par centaines. Son auteur, Jozef Mackiewicz (1902-
1985), admiré par le prix Nobel Czeslaw Milosz, emmène ainsi son
lecteur des bordels de Vilnius au salon du tsar, et déroule
lentement la formidable et complexe machination politico-
amoureuse qui allait emporter Serguei Miassoïedov, être imbu de
sa personne et détestable. Dans cette histoire trop grande pour
lui, ce colonel de gendarmerie n’est finalement que le bouc-
émissaire de la lutte d’influence que se livrent autour du tsar
Nicolas II, partisans de la monarchie libérale, ces octobristes, et
tenants de l’absolutisme. L’antisémitisme est la toile de fond, le
décor naturel du livre et de cette époque rythmée par divers
pogroms dont celui de Kiev en 1905. « On bat les Juifs. Très bien. Les
Juifs, naturellement, sont un grand fléau. Je ne sais pas comment
l’ancienne Pologne pouvait en élever autant, c’est peut-être là la raison
de son effondrement » assure ainsi un officier russe durant ce
terrible moment. Le terreau fertile des tragédies à venir est là,
prêt à engloutir définitivement les juifs.
La guerre va balayer « les barrières qui séparent l’héroïsme de la
lâcheté, la grandeur d’âme de la bassesse, une cause juste d’une cause
injuste, pour les jeter tous la même fosse » et précipiter le sort du
colonel Miassoïedov, condamné à mort et exécuté. Les pages sur la
défaite russe à la bataille de Tannenberg (fin août 1914)
rappellent parfois le grand Tolstoï. Miassoïedov est ainsi sacrifié
sur l’autel de l’incurie de ces chefs militaires issus de la famille
impériale. L’antisémitisme quant à lui, de maladie chronique
devient le cancer d’une nation qui allait également s’abattre sur la
veuve du colonel, Klara, dans cette seconde affaire du livre. « Tout
est la faute des Juifs (…) Les sphères dites patriotiques de la Douma
évoquaient « huit millions d’ennemis intérieurs » écrit ainsi
Mackiewicz. Le chiffre fait froid dans le dos surtout lorsqu’on
connait la suite de l’histoire.
La guerre et le traité de Versailles ont abattu l’Empire tsariste et
consacré la renaissance de l’Etat polonais mais l’antisémitisme,
son macabre héritage a, quant à lui, revêtu de nouveaux oripeaux.
Ainsi, durant l’entre-deux-guerres, les pogroms se multiplient en
Pologne notamment celui de Przytyk en 1936. L’antisémitisme est
assumé. « Quand le petit Polonais grandissait, cet état d’esprit
s’ancrait en lui et tous les adultes, pour ainsi dire, pratiquaient un
antisémitisme vulgaire qui ne leur posait pas le moindre problème, tant
il avait fini par devenir naturel, une composante de leur être » relate
ainsi dans son récit Armand Bulwa, enfant à Piotrkow, non loin de
Lodz.
Et tout naturellement, l’invasion allemande de 1939 va libérer,
légitimer cette haine des juifs jusqu’à prendre les proportions que
l’on sait. « L’arrivée des Allemands a complètement désinhibé les
Polonais qui, du jour au lendemain, se sont autorisés à se venger
ouvertement du mal imaginaire que les juifs leur avaient fait »
poursuit ainsi Armand Bulwa. La Shoah est en marche, elle fera six
millions de morts dont trois rien qu’en Pologne. Piotrkow devient
le premier ghetto polonais. Ses habitants sont exterminés en
octobre 1942 dont la mère, le frère et la grand-mère d’Armand
Bulwa, envoyés à Treblinka. Suivent son autre grand-mère puis
son père. Lui doit la vie sauve à son exploitation dans une usine
toute proche avant d’être envoyé au camp de Częstochowa puis à
Buchenwald, ce « bois de hêtres » qui donne son titre à l’ouvrage. Il
y fait l’une des plus belles rencontres de sa vie, celle de Lolek, alias
Elie Buzyn. Son récit à la fois sec et poignant – notamment dans ce
prologue qui le voit revenir sur les lieux de son enfance – avec
toujours cette pudeur qui lui impose de taire certaines
souffrances par respect pour les morts est le témoignage d’un
enfant devenu au milieu de la Shoah dont il creusa les fosses
communes, non pas un adolescent, pas seulement un homme, un «
Mensch », mais déjà, à dix-sept ans, un « survivant ».
Passée la libération des camps, on pourrait croire que la Pologne
fut purgée de son antisémitisme. A la lecture du livre glaçant
d’Agata Tuzynska sur cette vague méconnue d’antisémitisme que
connut le pays en 1968, il n’en fut rien. Car dès juillet 1946, une
nouvelle vague de violences antisémites se répandit dans le pays,
notamment à Kielce. La plume de Tuzynska rappelle celle de la
grande Alexievitch dans sa manière d’agencer ces témoignages
dans un immense puzzle qui, au-delà de la Pologne, dessine celui
de l’humanité tout entière. Cette galerie de portraits de
survivants de la Shoah devenus les pionniers d’une Pologne
passée sous le joug soviétique montre surtout des juifs soucieux
souvent par idéologie, parfois par crainte d’un retour du passé, de
gommer leur judéité : « Mon père voulait que ses enfants grandissent
dans un pays où être juif ne serait pas une différence, où ils ne se
feraient pas remarquer ». Ils appartiennent aux élites politiques et
culturelles de ce nouveau pays, habitent des appartements dans
les plus belles rues et ne connaissent pas la faim à la différence de
leurs parents morts dans les ghettos ou les camps. Cela vaut donc
tous les sacrifices et notamment celui de son identité religieuse
surtout lorsqu’en bons communistes, vous vous persuadez que la
religion n’est que l’opium du peuple.
Ils auraient donc pu être de brillants membres de la nomenklatura. Sauf qu’ils étaient juifs et qu’en Pologne, après la guerre, « sans
cesse, on nous rappelait qu’on était juifs. » Malgré tous leurs efforts
de renoncement, de mutation comme pour ces enfants dont on
refait le nez pour apparaître moins juifs, leurs efforts s’avèreront
vains. Car en mars 1968, la vague antisémite orchestrée par le
pouvoir renverra ces anciens des brigades internationales et de
l’Armée rouge à leur condition de juifs et les contraindra à l’exil.
La lecture du livre d’Agata Tuzynska terrifie car elle révèle
l’amputation identitaire de ces enfants privés de cette judéité qui
a traversé le feu de la Shoah et que les survivants ont souvent
enfoui dans l’oubli. L’effroi ressenti tient aussi à cette fatalité de la
haine qui ne disparaît jamais malgré les tragédies et tous ces
efforts consentis, notamment celui de se couper de ses racines et, en fin de compte, de ne plus savoir qui on est.
Dans un rapport intitulé « Combattre l’antisémitisme en Europe »
et daté de 2007, soit près d’un siècle après l’exécution du colonel
Miassoïedov, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
affirmait qu’en « Pologne par exemple où la communauté juive est
extrêmement peu nombreuse, entre 5 000 et 10 000 membres,
l’antisémitisme peut être observé. On parle alors « d’un antisémitisme
sans juifs » ou « virtuel ». En 1993, de retour dans sa Pologne natale
en compagnie d’Elie Buzyn, Armand Bulwa, découvrit dans une
petite ville, sur le mur d’une maison, un graffiti proclamant : « Les
Juifs au four. » S’émouvant auprès d’une religieuse qui passait par
là, celle-ci lui répondit d’un « Pour si peu de chose… » désintéressé.
Preuve que le poison demeure encore vivace.
Par Laurent Pfaadt
Jozef Mackiewicz, L’Affaire du colonel Miassoïedov,
éditions Noir sur Blanc, 656 p.
Armand Bulwa, Après le bois de hêtres,
L’Archipel, 180 p.
Agata Tuszynska, Affaires personnelles,
L’Antilope, 384 p.
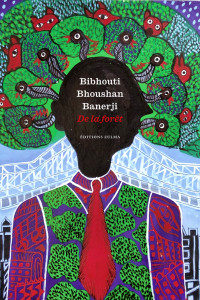 Dans ce roman écologique
Dans ce roman écologique