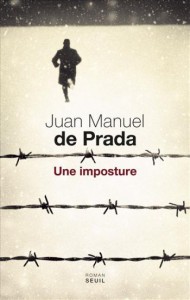Deuxième opus
des aventures de
Lorenzo Falco, le
nouveau héros
d’Arturo Perez-
Reverte, le maître
espagnol du
roman
d’aventures.
Après Alicante,
Tanger. Après avoir bien malgré lui, contribué à l’exécution du chef
de la Phalange et à la consolidation du pouvoir du général Franco,
Lorenzo Falco, espion nationaliste est envoyé dans le port
marocain de Tanger, véritable nid d’espion, pour s’emparer du
chargement d’un navire républicain, le Mount Castle. Trente
tonnes d’or nécessaires aux franquistes pour financer leur guerre
contre une République qui ne tient plus qu’à un fil. Envoyé là-bas
pour une mission de routine, Falco reste cependant lucide,
sachant pertinemment qu’il n’est que l’un de ces « pions
substituables sur un échiquier » d’une partie « jouée par d’autres ».
D’autant plus qu’il conserve de solides inimitiés au sein de son
propre camp.
Très vite plane sur cette mission, l’ombre d’Eva, la belle espionne
soviétique que Falco a sauvée des griffes des nationalistes et qui
hante toujours son esprit. On avait laissé cette dernière
agonisante dans une cave et seul l’amour de Falco, en dépit de
toutes les règles du métier et de toute cohérence idéologique, lui
avait sauvé la vie. Et la voilà en responsable de l’opération,
compliquant ainsi le dilemme à venir de notre pauvre Falco.
Dans ce second opus qui peut aisément se lire indépendamment
du premier, Arturo Perez-Reverte nous livre un roman impossible
à lâcher. Une fois de plus, en vieux loup non pas de mer mais littéraire, il distille avec maestria tel ce gin-fizz que boit Falco au
bar de l’hôtel Continental, les ingrédients nécessaires à tout
roman d’espionnage : une dose de violence, deux doses de sexe,
une grosse cuillère de géopolitique et des personnages tantôt
sulfureux tantôt ubuesques comme cette ancienne maîtresse
grecque ou ce tueur dandy venu seconder notre héros. Le tout
dans le shaker d’une intrigue rondement menée et parfaitement
scandée par ces dialogues qui, pareils à des glaçons, rafraîchissent
la lecture. Dans cette course contre la montre avant le départ du
Mount Castle, Arturo Perez-Reverte, expert en navigation, nous
mène allègrement en bateau sans jamais risquer le naufrage.
Dans cette guerre qui en annonce une autre, les espions d’Eva
semblent déjà désabusés. Ou peut-être, en fait, ne sont-ils que
plus amoureux. Mais en bon agent secret qu’il est, Falco ne se
hasarderait pas à reconnaître son talon d’Achille. Il faudra peut-
être attendre pour cela le dernier opus de la saga…
Par Laurent Pfaadt
Arturo Perez-Reverte, Eva,
Chez Seuil, 416 p.