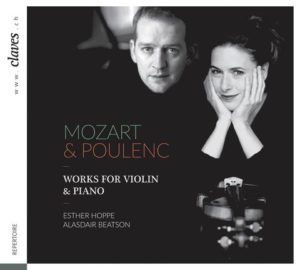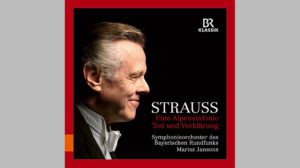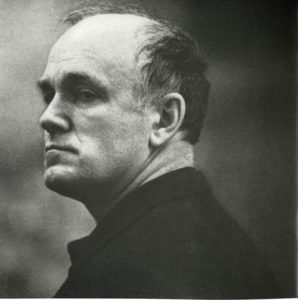Mstislav
Rostropovitch
aurait eu 90 ans,
le 27 mars dernier.
Un somptueux
coffret célèbre cet
anniversaire
Ils sont rares les
musiciens à avoir
personnifié leur
instrument ou leur don. Maria Callas à l’opéra, Yehudi Menuhin au
violon. Personne au piano. Et Rostropovitch au violoncelle.
Créateur et dédicataire d’un nombre incalculable d’œuvres dont
les plus grands concertos du 20e siècle, Rostropovitch ne
ménagea pas sa peine pour transcender les œuvres du répertoire
mais également pour s’aventurer dans la création contemporaine.
Le coffret Warner Classics reflète tout cela, des concertos
d’Haydn aux oeuvres de Dutilleux ou de Lutoslawski à qui il lança :
« ne pensez pas au violoncelle, c’est moi le violoncelle ! » Ce coffret
propose astucieusement plusieurs versions de la même œuvre
afin de permettre à l’auditeur de comparer le jeu de
Rostropovitch au contact d’un Carlo Maria Giulini ou d’un
Malcolm Sargent dans ce premier concerto de Saint-Saens qu’il
joua dès l’âge de treize ans. Warner Classics a ainsi puisé dans son
incroyable fond Erato pour ressortir quelques enregistrements
cultes où chaque disque mériterait une critique.
Et puis, il y a ces incroyables merveilles tirées de la période
soviétique de Rostropovitch. Celui qui se rêvait compositeur
transcenda les oeuvres de ses contemporains comme ces
concertos incroyables d’un Myaskovsky dont il fut l’ami ou d’un
Boris Tchaïkovski. Il y a une proximité telle qu’on entend presque
Rostropovitch respirer durant ces interprétations. Et puis cette
musique de Chostakovitch qu’il comprit si bien, seul ou en
compagnie de ces chefs incroyables comme Guennadi
Rojdestvenski dans cet incroyable premier concerto enregistré
dans la grande salle du conservatoire Tchaïkovski de Moscou que
Rostropovitch apprit par coeur en trois jours avant de le jouer
devant le compositeur le quatrième. Les deux hommes y
traduisent comme jamais l’angoisse et la peur inhérentes à la
musique du compositeur. L’orchestre se mue en force oppressante
et indestructible tandis que le soliste reste là, seul au milieu de ce
monde hostile, condamné à pousser son cri tantôt de détresse,
tantôt de résistance. Ou cette symphonie concertante pour
violoncelle et orchestre d’un Britten dont il fut si proche, venu
pour l’occasion diriger l’orchestre philharmonique de Moscou et
où Rostropovitch excelle à déployer toute la profondeur de
l’oeuve. Et puis, Prokofiev, ce professeur aimé dont il créa la
symphonie concertante le 18 février 1952, après l’avoir coécrit
avec le compositeur qui lui aurait lancé : « je vous plains, vous me
ressemblez physiquement ». Cette oeuvre qui n’admet aucune
erreur d’interprétation et devait électriser bien plus tard un Yo-
Yo Ma qui signe l’introduction de ce coffret, traduit ce rêve
indirectement exaucé de devenir compositeur.
Le coffret va également bien au-delà de la simple compilation de
disques. C’est une sorte de panthéon musical à la gloire du
violoncelliste. Il contient plusieurs enregistrements sonores où le
maestro y explique son art ou ses rapports avec Dimitri
Chostakovitch par exemple. Deux DVD permettent également
d’apprécier le jeu du génie, notamment cette suite de Bach en
1991 dont l’interprétation devant le mur de Berlin en novembre
1989, allait définitivement le faire passer de la musique à
l’Histoire. Mais n’y est-il pas déjà entré ? Assurément, comme le
prouve cet incroyable coffret.
Rostropovitch, le violoncelle du siècle,
The Complete Warner Reocrdings,
40Cds, 3 DVD, 200 page-book, Warner Classics, 2017
Laurent Pfaadt