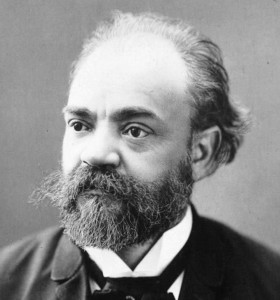Intégrale des symphonies de Sibelius par le Berliner Philharmoniker

Avant de refermer le panthéon musical finlandais consacré à Jean Sibelius en cette année 2015, il fallait bien un monument. Ainsi après Lorin Maazel, Leonard Bernstein, Sir Colin Davis ou Paavo Berglund, Sir Simon Rattle signe une intégrale fort intéressante des symphonies de Sibelius à la tête de « son » orchestre, le Berliner Philharmoniker qu’il s’apprête à laisser au chef d’orchestre russe, Kirill Petrenko. Après Schuman et Schubert (avec Harnoncourt), l’orchestre de Furtwängler et de Karajan s’aventure sur les terres glacées et sauvages de cette musique qui ne ressemble à aucune autre.
Le sentiment qui domine à l’écoute de ces symphonies est celui d’une force inextinguible qui puise ses racines dans cette énergie tellurique. Si les deux premières symphonies se rattachent encore à la tradition romantique, les suivantes appartiennent à l’univers musical si particulier de Sibelius. Ainsi, le lyrisme et l’optimisme de la 6e symphonie, moins jouée, sont ici extrêmement touchants.
Grâce à cette interprétation tout en nuances qui doit beaucoup à la direction de Simon Rattle (qu’il est d’ailleurs possible d’observer grâce aux DVDs présents dans ce magnifique coffret), la musique de Sibelius irradie. Il faut dire que le chef britannique ne s’aventure pas en terrain inconnu puisqu’il a déjà gravé par le passé une intégrale à la tête de l’orchestre de Birmingham. Durant son passage à la tête des Berliner, Rattle qui connaît Sibelius depuis sa jeunesse s’est ainsi attaché à emmener l’orchestre vers la musique de Sibelius qui avait été à peine abordée par Karajan.
La rencontre est ainsi explosive. Il se dégage une profondeur de ton et le sostenuto n’est jamais exagéré. L’interprétation de la seconde symphonie est à ce titre emblématique.
La musique ainsi délivrée devient solaire dans cette 7e symphonie, chef d’œuvre inclassable qui ressemble à un navire brise-glace avançant vers une terre inconnue.
Présenté dans un coffret très soigné qui comporte documents sonores, vidéos et textes, cette intégrale des symphonies de Sibelius éditée sous le label de l’orchestre offre en guise de conclusion de cette riche année Sibelius un formidable témoignage de la contribution de ce grand compositeur au patrimoine de l’humanité.
Jean Sibelius, Symphonies 1-7, Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle, Berliner Philharmoniker label
Laurent Pfaadt