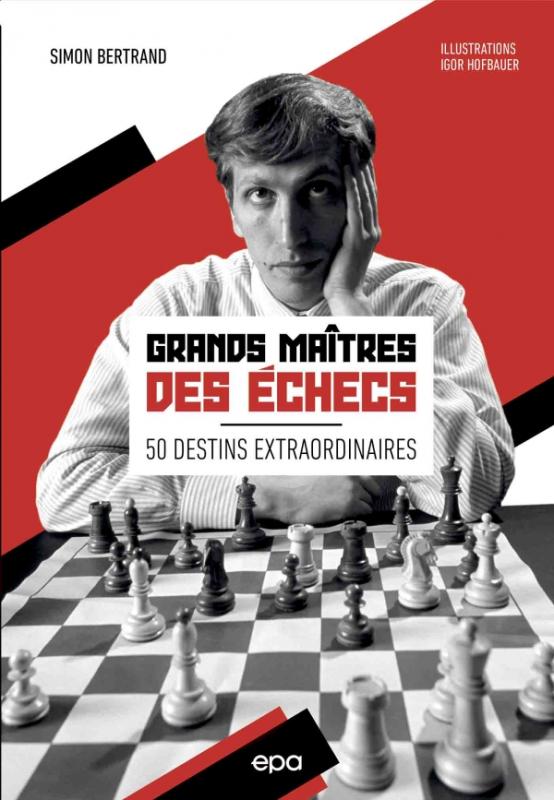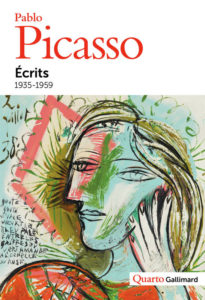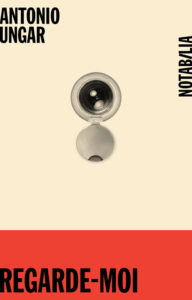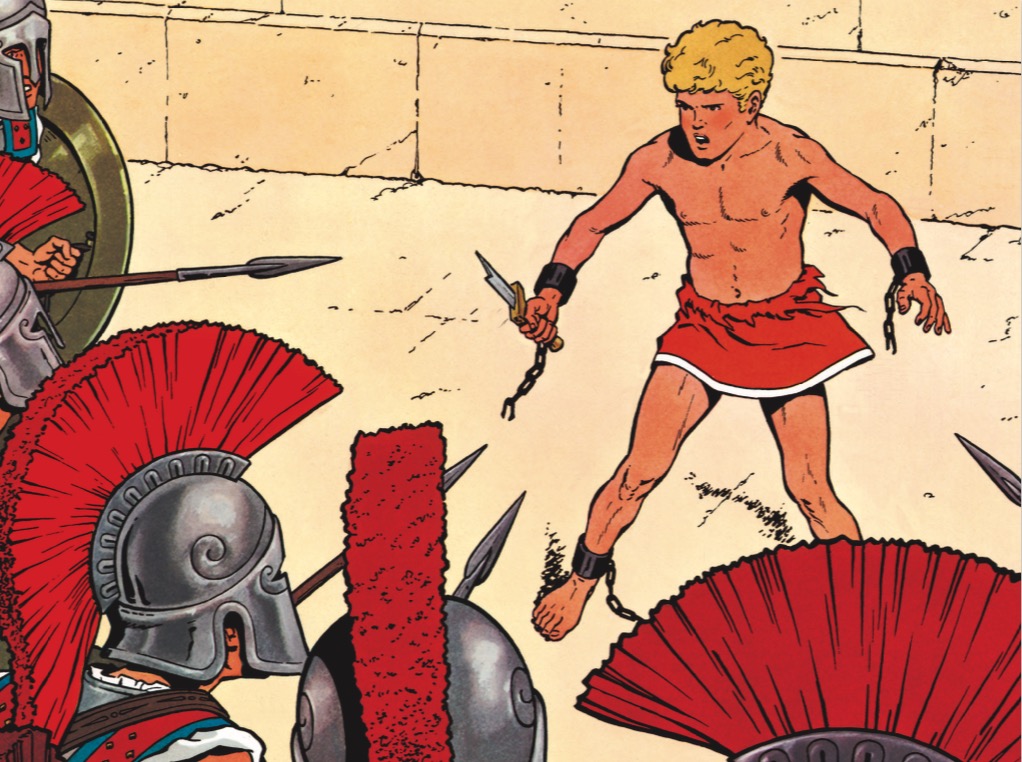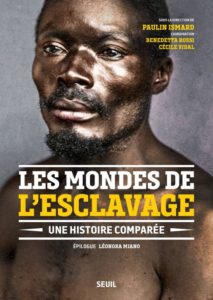Il y a trente ans, le 26 décembre 1991, les présidents de la fédération de
Russie, de l’Ukraine et de Biélorussie actaient, non loin de Minsk, la
dissolution de l’URSS. Au même moment, Mikhail Gorbatchev, dernier
secrétaire général devenu président de l’URSS démissionnait. Pour
beaucoup, ces actes marquèrent la fin d’un engagement, d’une utopie, le
communisme. Pour d’autres vint le temps de l’introspection sur ce que
François Furet appela dans un essai demeuré célèbre paru en 1995, le
passé d’une illusion. S’ouvrit alors une période de changements, de
bouleversements que nous vivons encore. Quelques conseils de lecture
pour commémorer cet anniversaire.
John Lewis Gaddis, La Guerre froide
traduit de l’anglais par John Edwin Jackson,
éditions Les Belles Lettres, 368 p.
« Une seule planète partagée par des superpuissances qui ont en commun
le pouvoir de s’éliminer réciproquement mais qui, désormais, partagent
un intérêt dans la survie l’un de l’autre ». Cette phrase tirée de l’ouvrage
de référence de John Lewis Gaddis, professeur d’histoire militaire et
navale à l’université de Yale, résume bien cette période de l’histoire
contemporaine qui s’acheva ce 26 décembre 1991. A travers un livre
où la petite histoire côtoie magnifiquement la grande, John Gaddis
fait ainsi revivre cette époque où deux superpuissances faillirent
plonger le monde dans un nouveau conflit. Puisant dans un certain
nombre d’archives inédites, son style très factuel mais très vivant
permet de démystifier les grands évènements de la guerre froide, de
la construction du mur de Berlin à sa chute en passant par le voyage
de Nixon en Chine et l’élection du pape Jean-Paul II tout en
proposant une réflexion de fond sur les grands enjeux dont nous
subissons encore les conséquences.
Witold Szabłowski, Les ours dansants, de la Mer Noire à la Havane, les déboires de la liberté
Editions Noir sur Blanc, 2021, 240 p.
De Sofia à Tirana et de Belgrade jusqu’à Gori, la ville natale de
Staline, en passant par Athènes, Londres et Cuba, l’auteur,
journaliste polonais maintes fois récompensé, notamment par le prix
du journalisme du Parlement européen, Witold Szabłowski,
interroge des femmes et des hommes sur la difficile transition de
leur pays vers la démocratie et l’économie de marché. Il nous montre
parfois que loin de tendre vers la liberté et la démocratie, ce chemin
périlleux peut également mener à l’autoritarisme et à la dictature.
Comme un ours élevé en captivité qui, en retrouvant la liberté, se
retrouve assailli par un certain nombre de dangers.
Sergueï Lebedev, Les hommes d’août
traduit du russe par Luba Jurgenson
Editions Verdier, 2019, 320 p.
L’histoire de roman hybride entre polar, chronique et fantastique
débute après la tentative de putsch menée par la frange
conservatrice du PCUS autour du chef du KGB, Vladimir
Krioutchkov en août 1991 et s’achève avec l’arrivée de Vladimir
Poutine en 1999. Le héros du roman arpente les terres de l’URSS
pour retrouver les traces de disparus mais également celles de ses
racines. Ce voyage dans le temps et l’espace décrit par l’un des
écrivains russes les plus prometteurs montre combien il est difficile
de faire table rase du passé et surtout qu’il ne suffit pas de
descendre un drapeau dans une tombe et d’en hisser un autre. Car
avec lui remonte invariablement les morts, les fantômes d’un passé
que l’on croyait révolu. Ces hommes d’août qui, finalement, ne
disparaissent jamais.
Olivier Rogez, Les hommes incertains
Editions Le Passage, 2019, 380 p.
Krioutchov possédait ses sbires et notamment Iouri Nesterov,
colonel du KGB et héros fictif du palpitant roman d’Olivier Rogez,
ancien correspondant à Moscou. Mais Nesterov est fatigué,
désabusé. Comme ce régime qu’il sert et se délite. En compagnie de
son neveu, Anton, venu pour l’occasion à Moscou, ils assistent tous
deux à la lutte que se livre Gorbatchev et Eltsine sur les décombres
de cet empire devenu un astre mort. Avec une plume pleine d’action
et de rythme, le lecteur s’assoit alors dans cette loge de l’histoire et
contemple ces hommes incertains jouer l’URSS à la roulette russe.
Nos héros arpentent chacun à leur manière, dans les vapeurs
d’alcool pour Iouri, dans les brumes de visions mystiques pour
Anton, les couloirs obscurs d’une comédie du pouvoir en compagnie
d’une galerie de personnages absolument fascinants qui animent
cette saga passionnante.
Irina Flige, Sandormokh : Le livre noir d’un lieu de mémoire
traduit du russe par Nicolas Werth
Les Belles Lettres, 2021, 168 p.
Ce livre magistral retrace l’enquête et les travaux de l’historienne
Irina Flige, de son mari ainsi que de Iouri Dmitriev, historien des
goulags aujourd’hui en prison sur un charnier de la Grande Terreur
stalinienne à Sandormokh en Carélie (nord-ouest de la Russie). Mais
celui-ci est devenu un tombeau qui s’est refermé sur l’histoire et sur
ceux qui tentèrent d’en révéler l’existence. Sandormokh montre ainsi
combien il est difficile de faire la lumière, aujourd’hui, sur la vérité
historique d’un passé ressuscité. Véritable manifeste sur le travail de
mémoire nécessaire à toute société pour avancer et aux familles des
victimes pour faire leur deuil, ce livre est aussi un cri lancé contre les
mensonges historiques, le travestissement de l’histoire et cet oubli
dans lequel on tente de précipiter l’association Memorial ainsi que
ses responsables, présents et passés, lorsqu’ils s’approchent trop
près de la vérité.
Svetlana Alexievitch, La fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement
traduit du russe par Sophie Benech
Chez Actes Sud, 2013, 544 p.
Comment ne pas évoquer le livre de la prix Nobel de littérature
2015, prix Médicis essai 2013 et meilleur livre de l’année pour le
magazine Lire. Dans ce brillant essai à tous points de vue, l’auteur
est allé à la rencontre de ces Russes qui, en un clin d’œil, ont changé
de monde, d’époque, de paradigme. Comme à son habitude, Svetlana
Alexevitch a agrégé des morceaux de vie pour composer une
nouvelle symphonie magistrale après Les Cercueils de zinc et La
Supplication. A la manière de celles de Chostakovitch, avec ses
mouvements tantôt lents, tantôts rapides, son œuvre est à la fois
grandiose, tragique, brutale et attachante. Et celle de l’homme
rouge, avec sa dimension crépusculaire confine au génie.
Alexeï Ivanov, Le dernier afghan
traduit du russe par Raphaëlle Pache
Editions Rivages noir, 2021, 640 p.
Enfin le roman noir offre souvent la possibilité de comprendre, à
travers le destin d’un personnage, les mutations à l’œuvre dans une
société et surtout la tragédie de l’histoire. Celui de Guerman,
« l’Allemand », ancien soldat de la guerre d’Afghanistan, vétéran
d’une armée qui n’existe plus devenu mercenaire du crime organisé
est assez emblématique. A travers le braquage qu’il organise à son
profit se lit celui d’une URSS par des hommes sans foi ni loi. Son
destin est à l’image de cette désillusion : celle d’un avenir porteur
d’espoir qui ne profite qu’à quelques-uns. Celle où la fin de l’histoire
a signifié avant tout la fin de sa propre histoire.
Par Laurent Pfaadt