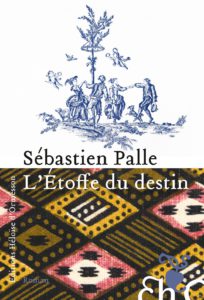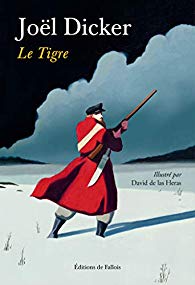Un essai percutant,
lauréat du prix
Pulitzer 2018,
permet de
comprendre les
mutations à l’œuvre
dans la diplomatie
américaine.
Tout le monde se souvient de cette photo de Richard Holbrooke,
envoyé spécial du président Clinton, sur le tarmac de la base
aérienne de Dayton en compagnie de diplomates et de militaires
venus négocier les accords qui devaient aboutir à la fin de la guerre
en ex-Yougoslavie.
A la lecture du brillant essai de Ronan Farrow, journaliste au New
Yorker, il est légitime de se demander si cette image n’appartient pas
désormais aux livres d’histoire, si des figures comme celles de
Richard Holbrooke, ce « type odieux que l’on adorait détester » selon
Farrow ou de ces diplomates américains « à l’ancienne » qui
traversent ce livre, ne sont pas des espèces en voie de disparition
tant la situation semble avoir pris une direction irréversible depuis la
fin de la guerre froide.
Fourmillant de détails incroyables et savoureux – on a parfois
l’impression de nager en pleine série façon A la Maison Blanche ou
House of Cards – et d’interviews des principaux acteurs de la
diplomatie américaine de ces trente dernières années, Ronan
Farrow démontre la lente mainmise des services de renseignement
et du Pentagone sur la diplomatie et la marginalisation progressive
de cette dernière. Non seulement les militaires ont acquis de plus en
plus de poids auprès du locataire du bureau oval mais surtout la
diplomatie elle-même s’est militarisée. Cette évolution peut ainsi se
résumer à cette remarque de Richard Holbrooke évoquant ses
relations avec David Petraeus, commandant en chef de l’armée
américaine en Afghanistan : « Il a plus d’avions que moi de téléphones. »
S’attardant longuement sur les cas d’école que sont les relations des
Etats-Unis avec le Pakistan et l’Afghanistan que l’auteur connaît bien
pour avoir collaboré avec Holbrooke lorsque celui-ci fut le
représentant spécial pour ces deux pays, Ronan Farrow permet de
rendre compréhensible les multiples jeux intérieurs et extérieurs de
tous ces acteurs. En nous emmenant des réceptions des
ambassadrices d’Islamabad aux charniers du nord de l’Afghanistan,
l’auteur expose ainsi avec pédagogie les enjeux complexes qui
illustrent les mutations à l’œuvre dans l’administration américaine.
Evidemment la présidence Trump ne pouvait échapper à son
analyse. Mais si cette dernière a encore accentué cette
militarisation notamment dans la lutte contre l’Etat islamique avec
la nomination de généraux aux postes-clés du gouvernement, Ronan
Farrow n’exonère pas Barack Obama de responsabilités notamment
dans sa propension à vouloir sous-traiter la lutte contre le
terrorisme et les opérations extérieures. Si cette stratégie a permis
d’économiser des vies américaines, elle a été désastreuse
stratégiquement et en terme d’image, les sous-traitants se souciant
peu des droits de l’homme par exemple.
Au final, on ressort assommé par un un tel livre, non pas tant à cause
de la masse d’informations délivrées mais bel et bien parce que ce
phénomène à l’œuvre traduit quelque chose de notre monde et de
nos sociétés. Et ce qu’il dit n’incite pas à l’optimisme.
Par Laurent Pfaadt
Ronan Farrow, Paix en guerre,
la fin de la diplomatie et le déclin de l’influence américaine
Chez Calmann-Lévy, 576 p.