Hebdoscope vous propose une sélection des meilleurs romans étrangers de cette rentrée littéraire
Joyce Carol Oates, Boucher, traduit de l’anglais (américain) par Claude Seban, éditions Philippe Rey, 400 p.
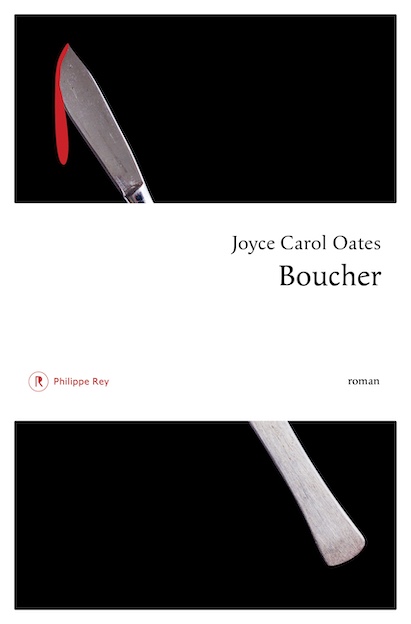
Elle revient avec le couteau entre le dents. Ou plutôt dans la main de Silas Aloysius Weir, médecin demeuré célèbre pour avoir été le chantre de la gyno-psychiatrie qui a contribué à mutiler de nombreuses femmes au nom de la soi-disante science. Elle suit ainsi cet avatar du docteur Frankenstein, dans cet asile de Trenton dans le New Jersey en compagnie de son directeur, Henry Cotton qui pensait guérir ses patientes en leur retirant certains organes, rien que cela !
A travers ce nouveau roman qui plonge ses racines qui ce gothique mystérieux qu’elle a transcendé notamment dans Bellefleur et La Légende de Bloodsmoor, Joyce Carol Oates offre une nouvelle réflexion sur l’utilisation du corps des femmes par les hommes notamment via leur sexe, réflexion abordée notamment dans son roman sur l’avortement (Un livre de martyrs américains, Philippe Rey, 2019) en même temps qu’une nouvelle plongée dans la psyché humaine pour nous montrer toutes les atrocités dont l’être humain peut se rendre coupable.
Dans Boucher, l’écrivaine manie une nouvelle fois avec le génie littéraire qui le sien, ce scalpel qui lui sert, depuis tant d’année à disséquer l’âme américaine. Le décor gothique de son intrigue dans ce 19e siècle lui permet ainsi de revenir, une fois de plus, sur les rapports de domination entre les femmes et les hommes notamment dans la sphère privée, entre les puissants et les autres au nom d’une morale factice.
Un livre que Stephen King, maître de l’horreur et d’armes tranchantes par excellence a qualifié « de féroce, éprouvant, inspiré de faits réels, que vous dévorerez d’une traite ». Joyce Carol Oates, la magicienne des lettres américaines, capable de transformer un fait divers en livre inoubliable a, une nouvelle fois, frappé.
Alaa El Aswany, Au soir d’Alexandrie, traduit de l’arabe (Egypte) par Gilles Gauthier, Actes Sud, 374 p.
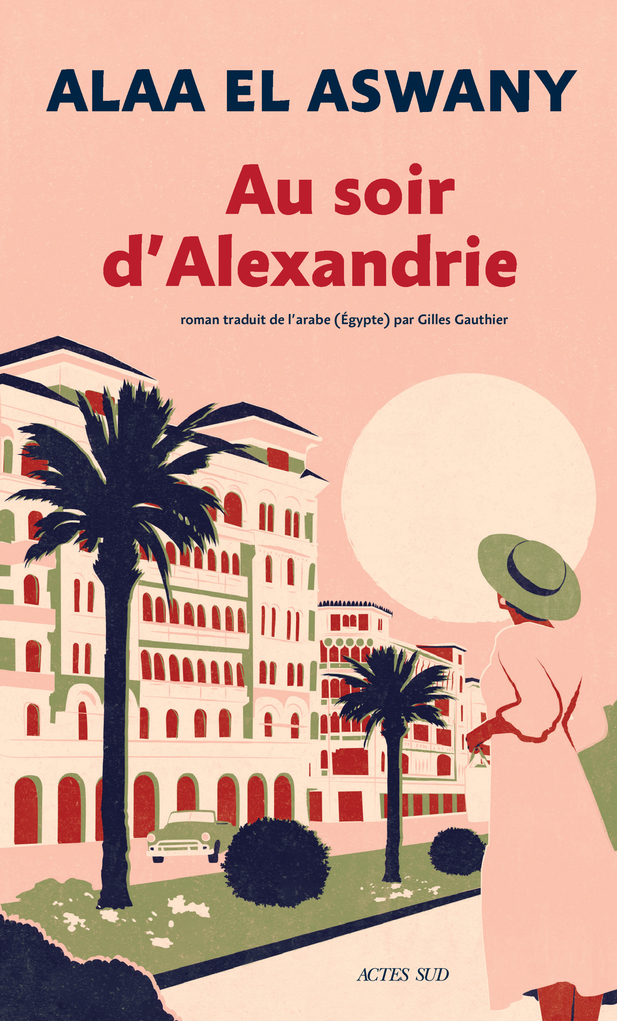
On avait quitté Alaa El Aswany en train de courir, avec ses personnages, vers le Nil pour fuir la répression du printemps arabe. On le retrouve dans cette Alexandrie du début des années 1960 en plein nassérisme triomphant. Un bande d’amis se retrouve chaque soir au bar du restaurant Artinos pour refaire le monde et surtout discuter de l’actualité et de la politique égyptienne. Ils viennent d’horizons divers et certains sont des étrangers mais tous le constatent : le Raïs a trahi leurs espoirs. Pire, il réprime ses opposants et certains personnages en feront les frais.
Avec sa magnifique plume qui l’a vu triompher dans le monde entier, Alaa El Aswany dépeint ainsi le crépuscule d’une Egypte contemporaine entamé avec Nasser à la fin des années 1950. Emprunt d’une profonde nostalgie, le roman montre la trahison des idéaux et de promesses. A la fois thriller et roman social, Au soir d’Alexandrie est une lumière littéraire dans cette nuit égyptienne qui n’en finit pas de durer.
Elena Tchijova, le Grand Jeu, traduit du russe par Marianne Gourg-Antuszewicz, éditions Noir sur Blanc, 320 p.
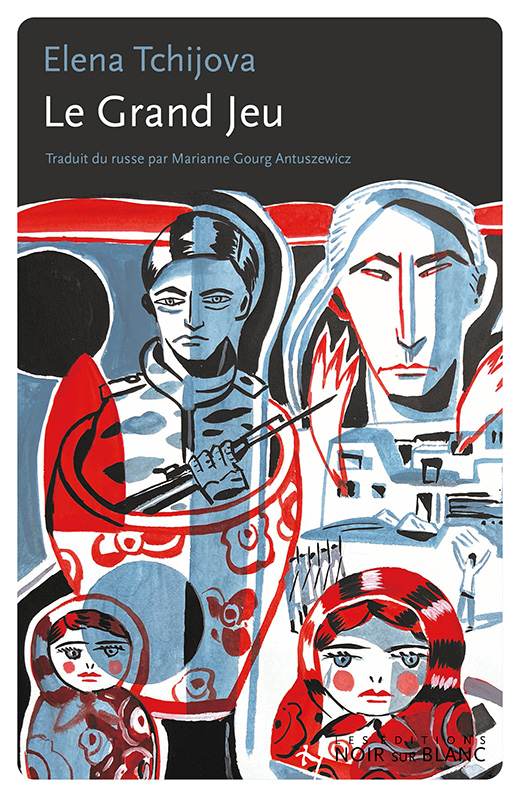
Elena Tchijova, autrice du roman Le temps des femmes (Noir sur Blanc, 2014), lauréat du Booker Prize russe revient avec Le Grand Jeu, un roman absolument passionnant, une chronique familiale qui coure tout au long du 20e siècle grâce à un procédé narratif tout à fait original centré autour de trois personnages
Nous sommes en 2014 et la Russie vient d’envahir la Crimée. Dans un appartement de St Petersbourg, cette guerre qui ne dit pas encore son nom ranime de vieux souvenirs de la seconde guerre mondiale et du siège de Leningrad chez la grand-mère de Pavel, sorte de Tatie Danielle acariâtre qui en fait voir de toutes les couleurs à sa fille, Anne, ex-instit devenue femme de ménage. Entre ces deux femmes, Pavel, geek de 25 ans qui pense avoir trouvé l’idée du siècle avec son jeu vidéo, commence alors à mettre en ligne les souvenirs de la grand-mère combinés à des chroniques sur les évènements en cours. Mais cette joyeuse compagnie et notamment les activités de Pavel ne sont pas du tout du goût du pouvoir.
Dans ce livre qui a reçu le prix Transfuge du meilleur roman russe les échos du passé percutent les évènements présents pour nous donner le désagréable sentiment d’une énième répétition de l’histoire y compris dans le contrôle de l’information et de la réécriture de l’histoire.
Tamás Gyurkovics, Migraine, traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, éditions Viviane Hamy,
416 p.
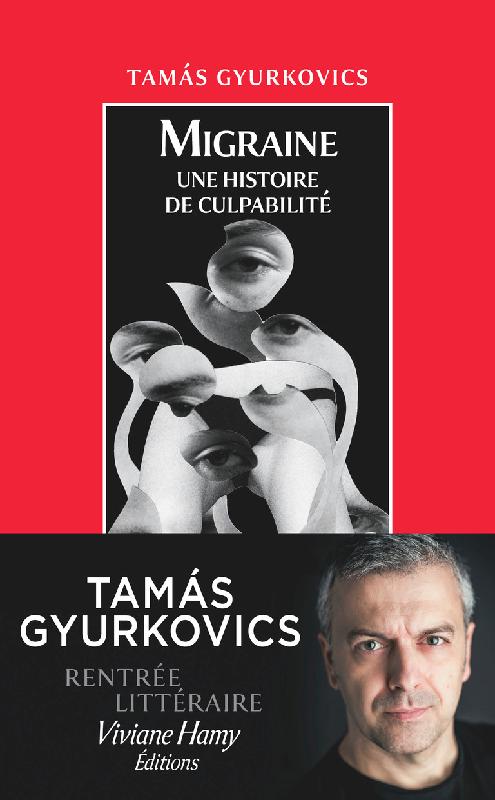
« Le diable est optimiste s’il pense pouvoir rendre les hommes pires qu’ils ne sont » écrivit l’écrivain autrichien Karl Kraus. C’est ce qu’a dû se dire Zvi Spielmann, le héros du passionnant roman du journaliste hongrois Tamás Gyurkovics. Zvi Spielmann est l’un de ces centaines de jeunes hongrois déportés, au printemps 1944, au camp d’extermination d’Auschwitz. Mais Spielmann est également un jumeau et à ce titre il intéresse plus particulièrement le sinistre docteur Josef Mengele. Non pas pour y subir ses terribles expériences mais plutôt pour être le « Zwillingsvater », le père des jumeaux, celui qui est en charge de la garde de ces derniers en attendant leur mort programmée souvent dans d’atroces souffrances.
Ayant survécut à la Shoah après avoir sauvé un certain nombre de jumeaux lors de marches de la mort, Zvi Spielmann, devenu citoyen du nouvel Etat d’Israël, souffre de terribles migraines lorsque reviennent ces douloureux souvenirs à l’occasion d’une rencontre fortuite ou du procès Eichmann.
Migraine pose avec beaucoup de talent et de gravité le problème de la culpabilité, celui d’avoir « pactisé » selon notre héros – même si en vérité il est le seul à le penser – avec le diable, de s’être compromis avec le Mal pour survivre et que toutes ses actions ultérieures ne parviendront pas à effacer cette faute originelle. « Celui qui a survécut ne peut pas être innocent » rappelle d’ailleurs l’un des témoins du procès Eichmann
Grâce à une magnifique traduction signée Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba – également traducteurs d’Imre Kertesz – le livre parvient à errer avec force dans la psyché de Zvi Spielmann qui s’inspire d’ailleurs de la vie de Zvi Spiegel où l’on se rend compte que la Shoah ne s’arrêta pas à la libération des camps. Une psyché en forme de miroir brisé où la culpabilité prend le pas sur le réel, où les distinctions entre le bien et le mal, entre le juste et l’injuste se trouvent noyées dans un inconscient fracturé.
Joan-Lluís Lluís, Junil, traduit du catalan par Juliette Lemerle, Les Argonautes, 272 p.
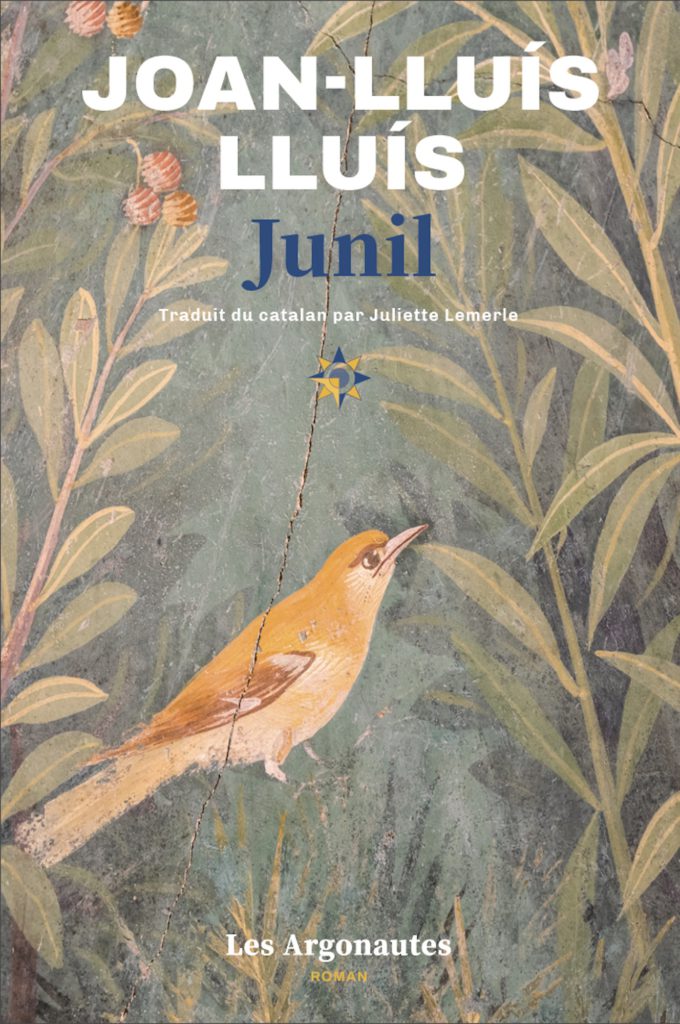
Auteur français d’expression catalane, Joan-Lluís Lluís est l’un des écrivains catalans les plus reconnus mais demeure relativement méconnu en France. Son dernier roman, Junil devrait aisément remédier à cette injustice tant ce dernier, récipiendaire de nombreux prix dont le célèbre prix Òmnium, est une merveille.
Junil est le prénom d’une jeune fille vivant en Terre Sainte à l’époque romaine. Privé de mère et de frères, morts dans l’incendie de leur village, Junil est obligée de vivre auprès d’un père tyrannique qui n’a que peu de considération pour elle. Mais dans tout malheur, il y a une lumière car ce père est écrivain public. Et dans la librairie de ce dernier, Junil va découvrir la lecture auprès de ces esclaves qui l’aident à fabriquer des papyrus ainsi que la beauté des mots et notamment ceux du poète Ovide. Cette initiation ne sera pas sans conséquences car elle va l’obliger à fuir le carcan familial.
Junil est un grand livre sur la beauté des mots et sur leur pouvoir d’élévation mais également de destruction. A travers eux, le roman glorifie la puissance du langage capable d’unir les êtres. L’enthousiasme autour de Junil a été tel que l’auteur a même reçu des faire-parts annonçant la naissance de deux petites filles nommées d’après son héroïne !
Michael Magee, Retour à Belfast, traduit de l’anglais par Paul Mathieu, Albin Michel, 432 p.
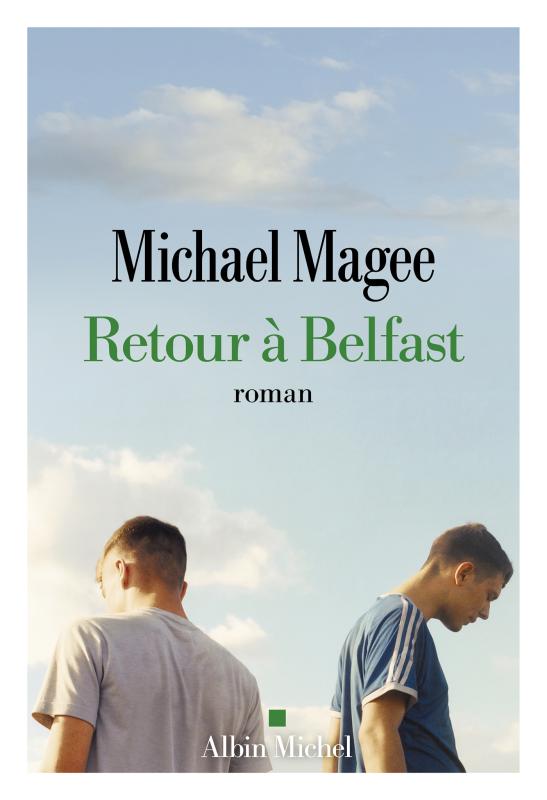
Nous sommes en 2013 après le crack financier qui a laminé la classe ouvrière irlandaise. Sean McGuire a quitté l’Irlande du Nord et ses démons pour aller étudier les lettres à Liverpool. Il a crû qu’un autre avenir était possible. Comme ses milliers d’Irlandais du Nord catholiques avec les accords du vendredi saint. Pour autant, il est contraint de revenir et bientôt les démons de la violence, de la drogue refont surface et vont le contraindre à commettre l’irréparable.
Condamné à des travaux d’intérêts généraux, Sean se retrouve à nouveau assigné à cette condition ouvrière d’une communauté catholique méprisée dont il n’était jamais parvenu à s’extraire. Ce cahier de retour au pays natal à la sauce irlandaise avec son lot de violences et d’injustices frappe d’emblée par la chape de plomb de ce déterminisme historique qui ne laisse aucun répit à ces êtres. Cela tombe bien car Michael Magee a construit des personnages à partir d’éléments biographiques que vous n’oublierez pas de sitôt qu’il s’agisse de Sean, archétype de la génération de l’auteur mais également la mère de Sean qui, de l’aveu même de l’auteur, a été modelé à partir de la figure de sa propre mère afin « qu’elle ait un espace dans cette histoire ».
Le livre a obtenu le prix John MacGahern décerné à un écrivain irlandais par l’université de Liverpool. L’un de ses jurés, le grand écrivain Colm Toibin a ainsi souligné « un portrait nouveau et mémorable d’un jeune protagoniste, pris entre l’innocence et l’expérience, tel qu’imaginé par un écrivain extrêmement talentueux. »
« Ecrire c’est honorer nos morts. Une sorte de vengeance » nous a-t-il confié. Une vengeance douce mais une vengeance tout de même. Retour à Belfast est assurément un roman qui restera longtemps en vous.
Ayana Mathis, Les Egarés, traduit de l’anglais (américain) par François Happe, Gallmeister, 528 p.

Ayana Mathis que nous avions découvert avec Les Douze Tribus d’Hattie (Gallmeister) revient avec ce nouveau roman bouleversant qui raconte la vie d’Ava Carson, une femme afro-américaine et celle de son fils Toussaint, deux êtres chassés par le mari d’Ava et qui se retrouvent dans un centre d’hébergement de Philadelphie. Le lecteur qui assiste à l’humiliation d’Ava, à son désespoir et à sa déshumanisation qui l’amènent à abandonner son propre fils comprend très vite que cette dernière va devoir se relever et se battre pour défendre la dernière chose qui lui reste : sa dignité.
Un livre en forme de cri face à la fatalité, à toutes les formes d’emprise. Une épopée contemporaine. Un livre plein d’espoir et de résilience. Voilà ce que l’on ressent à la lecture des Egarés de Ayana Mathis portée par une écriture à la fois poétique et puissante façonnant des personnages ambigus et fatalement inoubliables. Mais surtout Les Egarés est un livre sur la dignité, sur l’inépuisable quête d’émancipation auquel aspire chaque être humain. Il y a quelque chose de profondément universel dans les mots d’Ayana Mathis qui rappellent la grande Toni Morrison. Pas étonnant que le New York Times et le Washington Post en ont fait l’un de leurs livres de l’année.
Par Laurent Pfaadt