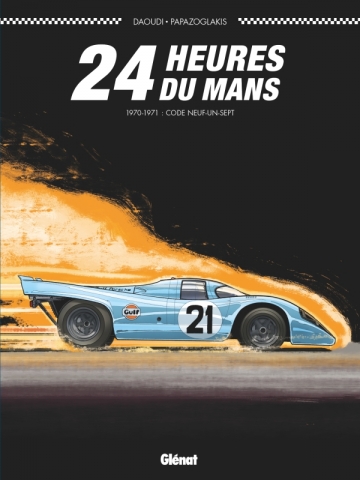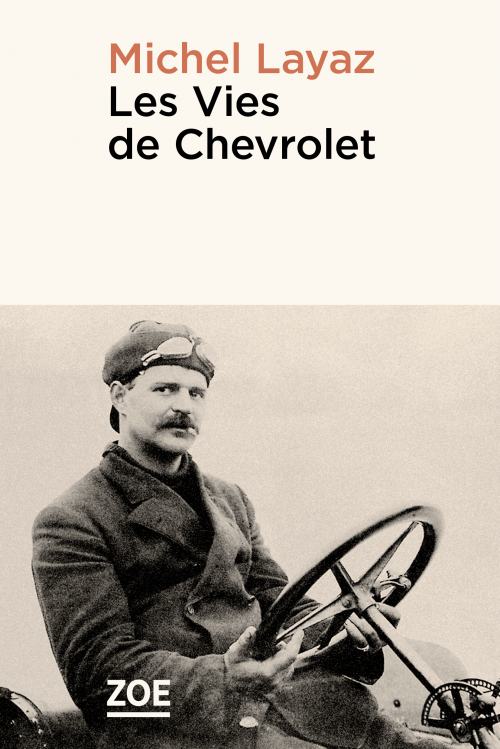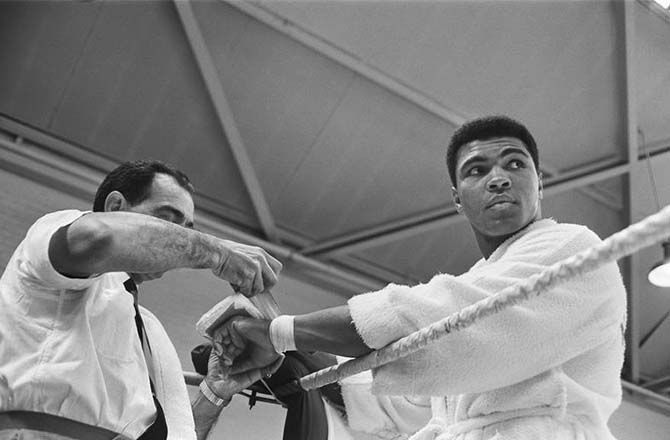Un livre magnifique revient sur la carrière de Steven Spielberg
En novembre dernier, les élèves de 4e du collège Wolf de Mulhouse ayant réalisé un film sur Steven Spielberg ont eu la surprise de voir leur idole les féliciter et les inviter à se rendre à Hollywood. Un cinéaste qui sait et qui a montré dans ses innombrables films que puiser dans son enfance pouvait à jamais changer votre vie. Et tandis que le 6 juin prochain, le 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie sera l’occasion d’une nouvelle vague éditoriale dont rendra compte Hebdoscope, il devenait nécessaire de se plonger cinématographiquement dans l’œuvre de celui qui mythifia au plus haut point l’action des Etats-Unis durant la seconde guerre mondiale comme en témoigne sa nouvelle série Masters of the air, diffusée en début d’année sur la plateforme Apple TV.

Steven Spielberg sait combien ces rencontres construisent les rêves, les vocations. Un jour peut-être l’un de ces collégiens deviendra lui-aussi un réalisateur culte après avoir découvert le cinéma de Spielberg comme ce dernier découvrit celui de Cecil B. de Mille, ou après avoir imité dans son cinéma de quartier telle scène ou reproduit tel procédé à l’image de ce que fit le futur réalisateur de Jurassic Park (1993) lorsqu’il expérimenta une mixture ressemblant à du vomi qu’il déversa depuis les balcons du cinéma de Phoenix à l’été 1960.
Un cinéma que nous invitent à découvrir Olivier Bousquet, Arnaud Devillard et Nicolas Schaller dans ce très beau livre. Car voilà plus d’un demi-siècle que Spielberg nous accompagne, nous fait rêver, pleurer, tressaillir. Nous, nos parents et nos enfants dans ce formidable lien entre les générations qu’il a su tisser, avec cette magie qu’il a fabriqué derrière sa caméra, cet héritage qu’il nous a transmis et que nous transmettons à notre tour en regardant à travers les yeux de nos enfants, ces premières découvertes d’E.T (1982), d’Indiana Jones ou des Dents de la mer (1975).
Le livre raconte ces épopées cinématographiques avec leurs acteurs (Richard Dreyfuss, l’alter-ego, Tom Cruise, les enfants acteurs promis à un brillant avenir), ses fidèles comme son incroyable directeur de la photographie, Janusz Kaminski, ou John Williams qui mit en musique ses légendes, et ces anecdotes savoureuses comme celle où l’on apprend qu’il renonça à réaliser Rain Man car déjà engagé sur le troisième opus des aventures du célèbre archéologue.
Le lecteur se promène ainsi dans cette filmographie incroyable où la comédie côtoie la science-fiction, le film d’aventures, la fresque historique ou le thriller politique. Avec une empathie communicative pour leur sujet, les auteurs parviennent même à séduire les plus avertis avec ces films moins connus comme Always (1989) et ces innombrables détails passionnants. Tout en entrant dans la fabrication des ses chefs d’œuvre avec ses analyses techniques et les évolutions technologiques que Spielberg a inventés, ses arrêts sur image passionnants, le livre évoque aussi la difficile gestation de certains films comme La Liste de Schindler (1993) qui mit près de dix ans à voir le jour et les projets avortés comme ceux des biopics de Lindbergh et de Gershwin. Mais surtout, ces démonstrations permettent de révéler le cœur de l’ouvrage, celui de la compréhension du cinéma de Spielberg qui renvoie en permanence à l’enfance, et qui rend hommage à la famille, à sa mère (La Liste de Schindler) et à son père avec Il faut sauver le soldat Ryan (1998).
En faisant quelques pas de côté en explorant l’homme d’affaires via ses sociétés de production Dreamworks ou Amblin ou sa passion pour la peinture et notamment pour Norman Rockwell dont il possède plusieurs dizaines de toiles, le livre aborde également l’homme derrière la caméra. Un livre passionnant de bout en bout donc qui constituera une inépuisable source d’inspiration pour nos cinéastes alsaciens en herbe.
Par Laurent Pfaadt
Olivier Bousquet, Arnaud Devillard, Nicolas Schaller, Spielberg, la totale, les 48 films, téléfilms et épisodes tv expliqués, EPA, 540 p.