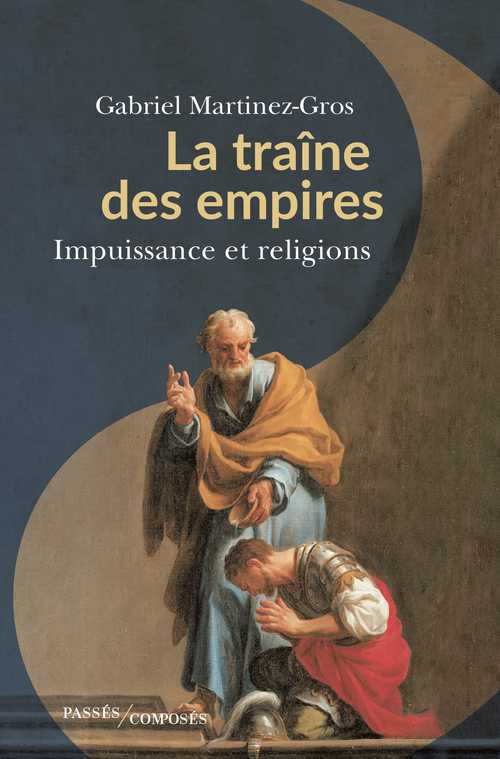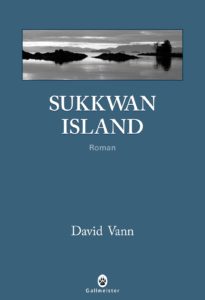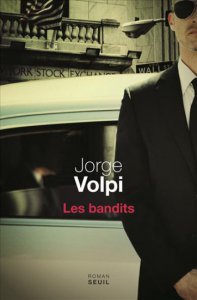Echevelé, disjoncté, tonitruant, brillant, original, ce Caligula de Jonathan Capdevielle veut nous rappeler, mais peut-on l’oublier au regard de l’actualité, jusqu’où les excès du pouvoir peuvent mener. La mégalomanie, voire la folie en étant les séquelles les plus courantes.

Ici une démonstration concluante mais un peu longue qui ne ménage pas les effets spectaculaires en commençant par cette scénographie imposante signée Nadia Lauro, représentant une falaise abrupte permettant aux comédiens des jeux d’escalade et des rencontres fortuites, appropriées aux possibles complots qui ne peuvent manquer d’être fomentés contre un despote. Celui qui nous est décrit à partir du texte « Caligula » d’Albert Camus se montre d’abord comme un vieil enfant qui veut décrocher la lune parce que rien ici-bas ne peut le satisfaire. N’ira-t-il pas jusqu’à révéler qu’un soir il l’a vu se lever, aller jusqu’à son lit et qu’il a fait l’amour avec elle. Déçu par tout et par tous il tient la vie pour peu de chose et la supprime sans état d’âme, semant autour de lui la peur et l’allégeance. Ainsi va-t-il faire part de ses états d’âme à son fidèle Hélicon (Jonathan Drillet), l’esclave qu’il a libéré et qui lui est tellement reconnaissant qu’il ne peut porter aucune critique contre lui, ce qui n’est pas le cas des sénateurs affligés par ses sautes d’humeur et ses décisions arbitraires qui font dire à sa vieille maitresse Caesonia ( Michèle Gurtner) qu’il n’est qu’un enfant.
En l’occurrence quand débute la pièce il a disparu depuis trois jours en raison de la mort de son amante et sœur Drusilla. Les sénateurs en profitent pour se livrer à leurs commentaires sur les chagrins d’amour et les problèmes de gouvernance. Sur scène on les voit se prélasser sur les rochers en costume de bain, le ton de cette mise en scène est ainsi donné et on va vers le loufoque, la dérision.
On y verra les différents protagonistes à moitié nus ou superbement costumés et jusque parfois déguisés en romains (conception costumes Colombe Lauriot Prévost) comme le personnage de Caligula interprété avec fougue par Jonathan Capdevielle lui-même. Sa prestation est remarquable et le place comme il se doit au premier rang des interprètes, il n’arrête pas de déclamer, provoquer, commander l’impossible comme de faire composer des poèmes en un temps record aux sénateurs plutôt embarrassés ou les obliger à jouer ensemble du pipeau ! C’est qu’il se prétend esthète et ami des arts. Lui-même se plaît à se travestir et parader en Vénus et fait grand cas du jeune poète Scipion (Dimitri Doré) qui, fier de cette reconnaissance, lui voue un culte qui lui fait presque oublier qu’il a tué son père.
Il est excentrique et souvent grotesque, parfois sensible mais le plus souvent cruel, n’ayant pas de scrupules à tuer, allant même jusqu’à étrangler sa vieille maitresse.
Le jeu décomplexé de Jonathan Capdevielle insiste sur cet aspect extravagant et tyrannique du personnage, rendant certaines réparties, certaines situations presque comiques sans toutefois faire oublier la pertinence du propos sur la nuisance du pouvoir absolu. Rappelons que cette pièce fut écrite par Albert Camus en 1941 puis remanié en 1958, ces deux versions ont servi de base à cette mise en scène.
Marie-Françoise Grislin pour Hebdoscope
Représentation du 7 décembre au Maillon