A l’occasion de la publication de leurs nouveaux ouvrages sur la Troisième République, portrait croisé des historiens Michel Winock et Jean-Noël Jeanneney
Devenus octogénaires, les voilà désormais plus vieux que celle dont ils sont tombés amoureux il y a bien longtemps. S’ils en ont raconté l’histoire, ce fut d’abord une histoire d’amour ou un amour d’histoire. Mais seul Jean-Nöel Jeanneney a franchi le Rubicon républicain pour tenter de la faire. Peut-être par atavisme. Michel Winock a préféré les intellectuels au milieu de ces voix de la liberté qu’il magnifié dans son ouvrage qui lui valut le Prix Roland de Jouvenel de l’Académie française en 2001. Un prix venant s’ajouter aux honneurs de la République des lettres : Prix Medicis essai pour Le Siècle des Intellectuels (1997) et finalement Prix Goncourt de la biographie pour sa Madame de Staël (Fayard, 2010). Intellectuel, il l’est resté jusqu’au bout en refusant la légion d’honneur à l’inverse de Jean-Noël Jeanneney devenu président de la Bibliothèque Nationale de France où des milliers d’étudiants viennent se pencher sur les livres de Michel Winock. Noblesse républicaine oblige mais qui a dû faire le deuil de cette présidence d’une République des lettres qui lui a refusé l’immortalité. Jean-Noël Jeanneney aurait pu reprendre à son compte la formule de son héros : « Il y a deux organes inutiles : la prostate et le Président de la République. »
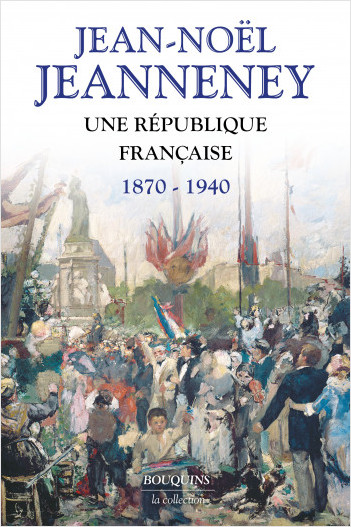
Jean-Noël Jeanneney et Michel Winock ont ainsi passé leurs carrières, leurs vies d’historiens à ausculter la Troisième République, à travers ses institutions et ses grandes figures. Et pour cause. Jean-Noël Jeanneney l’a en héritage. Petit-fils de son dernier président du Sénat, Jules Jeanneney, il lui a consacré un essai qui figure dans le nouveau volume de la collection Bouquins rassemblant plusieurs de ses livres. Issu d’un milieu modeste, Michel Winock, est resté quant à lui sur la berge universitaire pour observer ces cataractes républicaines qui ont charrié entre 1871 et 1940 les hommes et les idées de la plus belle des républiques. Parvenu à cet âge où l’on perd ses amis, il enchaîne aujourd’hui avec plaisir ces enterrements républicains, de Louis Rossel, « le patriote au poteau », seul officier à avoir rallié la Commune et aujourd’hui oublié à Charles Péguy, mort au champ d’honneur voilà 110 ans en passant par Victor Hugo, Louise Michel et bien évidemment Jean Jaurès, assassiné en même temps que la paix, le 31 juillet 1914.
Jean Jaurès, voilà la figure qui rassemble, avant Clemenceau, nos deux hommes. « J’ai mille raisons de préférer le combattant inépuisable de la paix à celui que Romain Rolland appellera plus tard le « rossignol du carnage », l’internationaliste au doctrinaire de l’enracinement » écrit ainsi Michel Winock dans son dernier ouvrage Pompes funèbres en comparant le fondateur de l’Humanité à Maurice Barrès dans son portrait en miroir. Jean-Noël Jeanneney ne dit pas autre chose dans l’un de ses principaux succès de librairie, Le Duel, une passion française 1789-1914 (Seuil, 2004) lorsque Jean Jaurès demanda réparation à Paul Deroulède, l’idole de Barrès et chantre de la revanche face à l’Allemagne et du nationalisme : « Son siècle lui impose, en dépit de tout ce qui aurait dû l’en détourner, de surgir seul, ici, hors de la foule ».
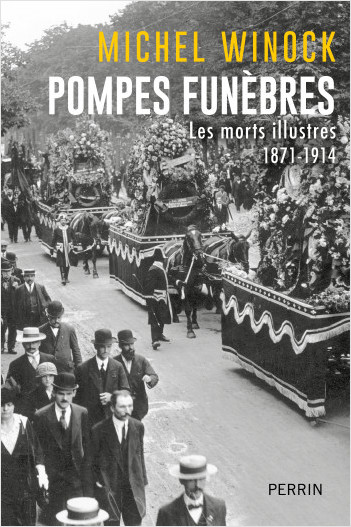
Et puis bien évidemment le Tigre. Chacun lui a consacré une biographie et s’en est constamment approché de près ou de loin, par le biais de la Grande guerre et en compagnie de certains de ses collaborateurs comme Georges Mandel, cet homme qu’on attendait pour reprendre le titre du très bel ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et dont le destin aurait pu être celui d’un Charles de Gaulle. Un Clemenceau aux côtés de Michel Winock dans ces cortèges funèbres. Chroniquant comme journaliste l’enterrement du Président de la République Sadi Carnot, assassiné par un anarchiste le 25 juin 1894 et qui « avait donné à son pays tout ce qui était en lui, y compris la vie », le Tigre fut hué aux obsèques d’un Zola qui avait publié dans son journal, L’Aurore, son fameux « J’accuse… ». Une figure qui, devenue octogénaire comme nos spectateurs engagés, affirmait que « les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, qui ont tous été remplacés » Or, il arrive parfois que des historiens talentueux se glissent parmi l’assistance…
Par Laurent Pfaadt
Jean-Noël Jeanneney, Une République française 1870-1940
Bouquins, 1344 p.
Michel Winock, Pompes funèbres. Les morts illustres, 1871-1914
Aux éditions Perrin, 2024, 352 p.
A lire également :
Michel Winock, Gouverner la France
Gallimard, coll. Quarto, 2022, 1216 p.
Ego-Histoire, Bouquins, 2024, 1120 p.