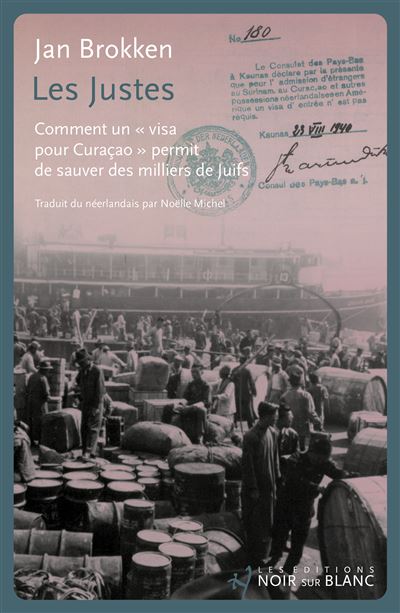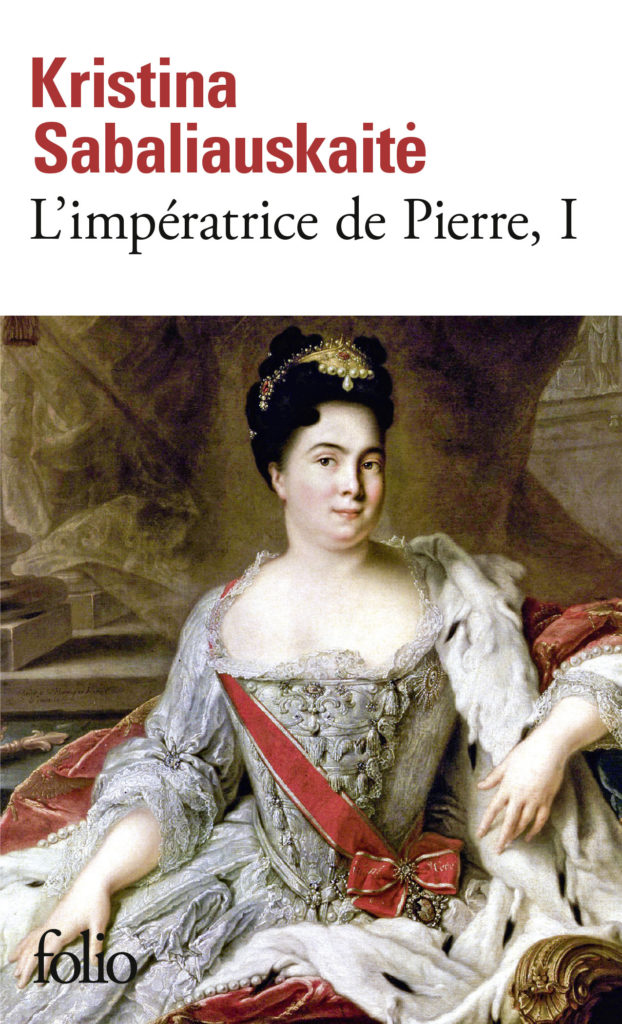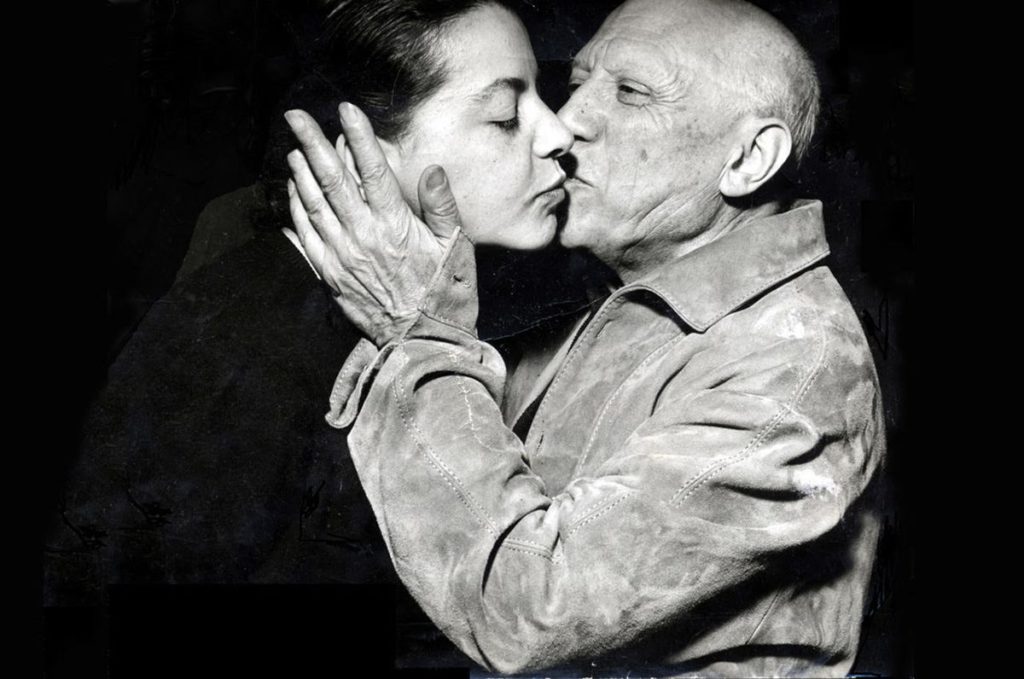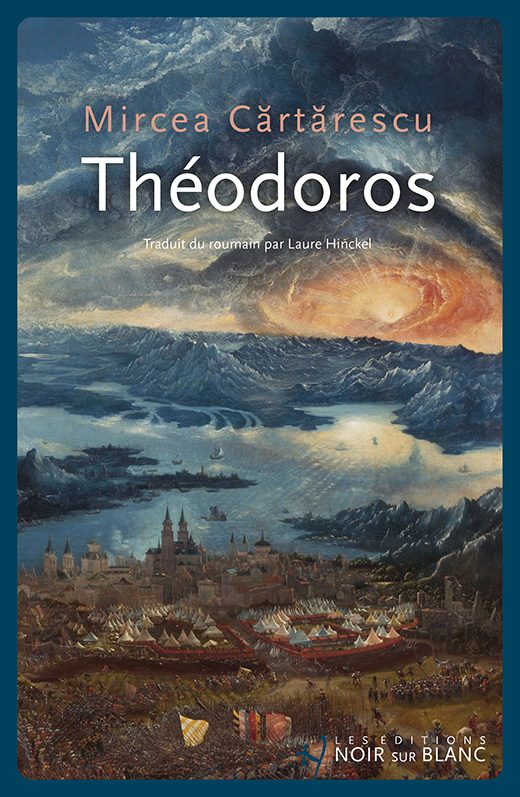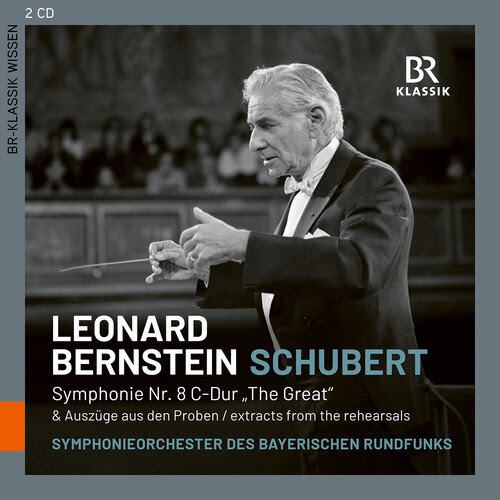De LA à Berlin en passant par Madrid, Paris et le Montana, Hebdoscope vous propose d’embarquer avec quelques uns des plus grands maîtres du polar.
Julian Semenov, A l’Ouest le vent tourne, traduit du russe par Monique Slodzian, éditions du Canoë, 832 p.
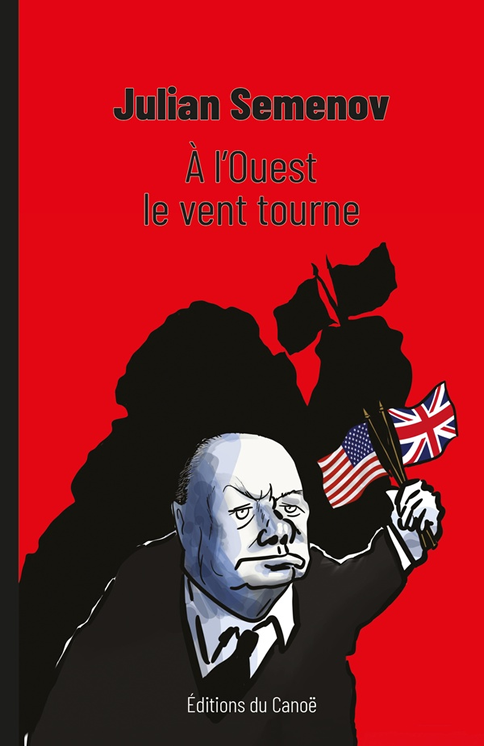
On ne va pas vous révéler de scoop mais rassurez-vous, il va bien. Il s’en est tiré. En tout cas pour l’instant. Car si le Troisième Reich n’existe plus, une nouvelle guerre s’apprête à démarrer. Et celle-ci est froide, glaciale même pour les anciens espions. Max Otto von Stierlitz alias Maxim Maximovich Isaуev, agent du NKVD infiltré dans l’appareil nazi est à Madrid, en attente d’une exfiltration par Odessa, ce réseau permettant aux anciens nazis de fuir leurs juges vers l’Amérique du Sud notamment. Alors que la chasse aux communistes vient de débuter aux Etats-Unis, ces derniers approchent d’anciens nazis dont Stierlitz sans connaître la véritable identité de ce dernier.
Poursuivant sa publication de l’œuvre de Semenov désormais considéré comme le John Le Carré russe par un public français de plus en plus conquis, A l’Ouest le vent tourne nous emmène dans cet après-guerre où les alliés d’hier sont devenus les nouveaux ennemis et où parmi les anciens bourreaux se sont glissés, comme Stierlitz, des espions soviétiques. Une course contre la montre vient de débuter. Stierlitz parviendra-t-il, une fois de plus à s’en sortir ? Réponse à la dernière page du nouvel opus de cette magnifique saga d’espionnage toujours aussi palpitante.
James Ellroy, Les Enchanteurs, traduit de l’anglais par Sophie Aslanides et Séverine Weiss, Rivages, 400 p.
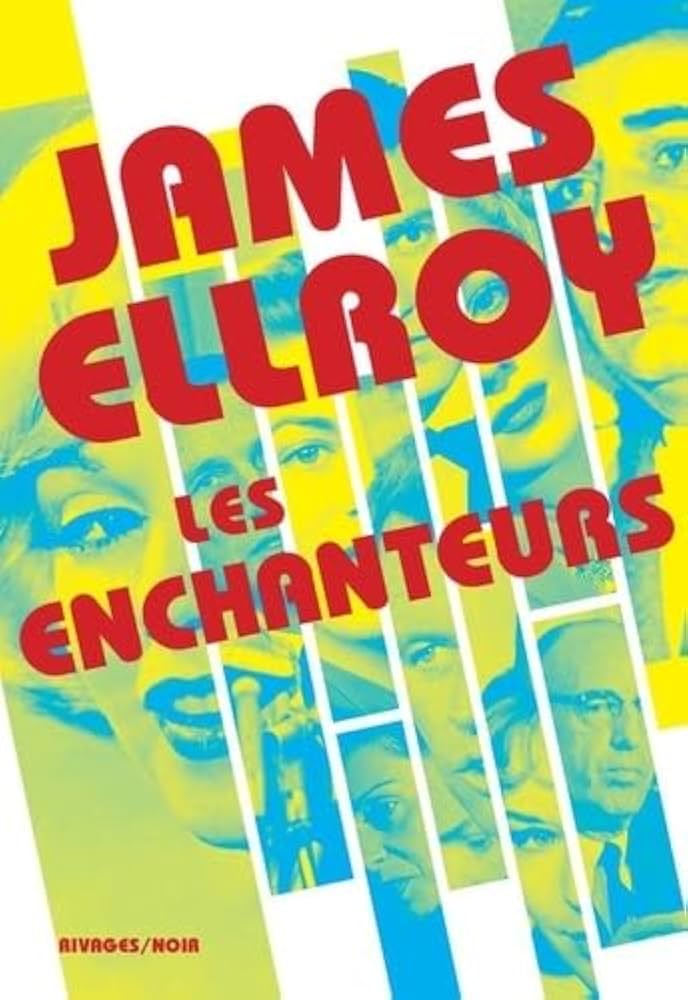
On ne présente plus le « Demon Dog », le maître du roman noir américain, de ces années 50 et 60 pleines de sexe, de crimes et de saloperies en tout genre. Troisième acte du Quintette de Los Angeles en forme d’opéra macabre, ce nouveau livre débute à la mort de Marilyn Monroe, le 4 août 1962. Robert Kennedy, bien décidé à faire le ménage dans les incartades de son frère, prend contact avec le chef de la police de LA, Bill Parker. Il lui faut un type capable d’aller foutre son nez dans la merde pour saloper la réputation de l’égérie du cinéma hollywoodien.
Et voilà que notre brave Freddy Otash, déjà croisé dans Extorsion (Rivages, 2014), refait surface. Pervers invétéré, l’ancien flic va se charger à merveille de cette besogne. Ce qu’il trouvera fera passer les joyeusetés d’un Donald Trump avec une star du porno pour du petit lait, faites pour cela confiance à notre cher Ellroy. Une nouvelle fois prodigieusement bien écrit, les Enchanteurs vous embarqueront dans le train fantôme de l’Amérique des bas-fonds et des coups tordus.
Anaïs Renevier, La disparue de la réserve Blackfeet, éditions 10/18, 240 p.
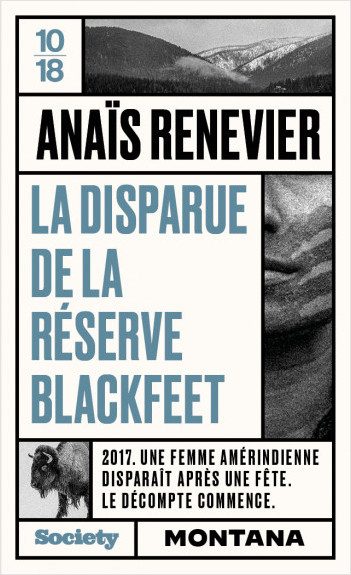
Début juin 2017, une jeune femme amérindienne de 20 ans, vivant dans la réserve des Blackfeet dans le Montana, Ashley Loring Heavyrunner, disparaît au sortir d’une fête. Les derniers témoins l’ont vu monter dans le pickup d’un homme d’une cinquantaine d’années, un certain Sam McDonald connu pour sa consommation de drogues. Voilà le point de départ de la nouvelle enquête policière de cette série, ces True Crimes littéraires pilotés par le magazine Society et les éditions 10/18. Cette fois-ci, notre Matthew McConaughey se nomme Anaïs Renevier, journaliste déjà autrice de L’Affaire Alice Cummins qui nous embarque dans cette nouvelle enquête passionnante qui se lit, une fois de plus, d’un trait.
Les vêtements et les bottes d’Ashley sont retrouvés mais les empreintes ne sont pas exploitables. L’enquête est au point mort, bâclée comme d’habitude. En se penchant sur ce coldcase, Anaïs Renevier révèle alors qu’Ashley témoigna contre un homme qui lui tira dessus près de dix ans auparavant. Cet homme vient justement d’être arrêté pour le meurtre d’un certain Alvin qui s’apprêtait à révéler la vérité sur la mort d’Ashley. La victime ne possédait plus de tête ni de mains. Comme pour éviter de parler et de confronter ses empreintes ? Alors un conseil : gardez vos mains bien en vue sur ce livre…
Luke McCallin, Conspiration, traduit de l’anglais par Nicolas Zeimet, Toucan Noir, 608 p.
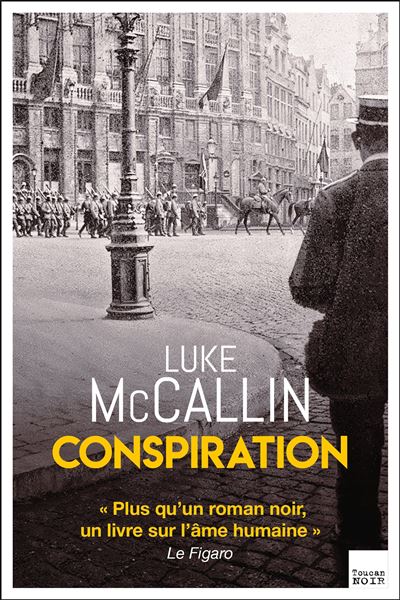
On avait quitté Gregor Reinhardt en 1943-1944 à Sarajevo où se déroulaient ses premières aventures. Puis on l’avait retrouvé après guerre, inspecteur de la police criminelle de Berlin. Son créateur, Luke McCallin, nous ramène, dans ce préquel, à la fin de la Première guerre mondiale. Reinhardt est alors un jeune lieutenant envoyé sur le front dans le nord de la France. Et voilà qu’un attentat décime tout l’état-major. Les soupçons se portent très vite sur l’un des membres de la compagnie de Reinhardt. Mais ce dernier a des doutes surtout après le suicide de l’accusé. Ses premières investigations vont alors le mener dans les ténèbres d’une incroyable conspiration aux innombrables ramifications.
A travers ce roman une fois de plus magnifiquement mené de bout en bout où le suspense ne fait que grandir, Luke McCallin met en scène la naissance d’une vocation mue par le souci de justice mais également celle d’un héros qui peut s’asseoir fièrement à la table des Ignacio del Valle et Fabiano Massimi et peut même se voir autoriser à trinquer avec un certain Bernie Gunther…
Romain Slocombe, Sadorski chez le docteur Satan, coll. La bête noire, Robert Laffont, 512 p.
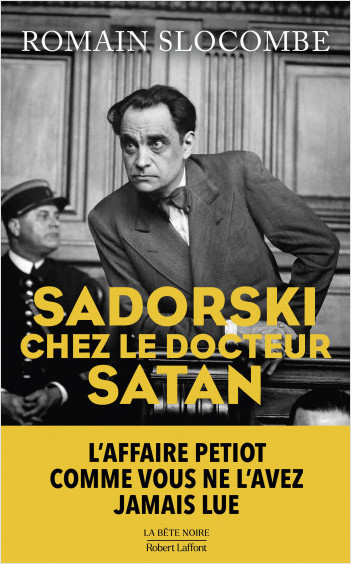
De retour d’Allemagne, le train vient enfin de s’arrêter à la gare de l’Est. Le quai de la gare est décoré de petits drapeaux français car Paris vient d’être libérée. Les Allemands ont fui et les traîtres se cachent de peur d’être arrêtés et jugés par une Résistance gaulliste et communiste. Cette dernière cherche d’ailleurs un homme, un flic collabo, une pourriture dépourvue de morale et devenu un héros littéraire désormais bien connu des amateurs de polars historiques : Léon Sadorski.
Notre anguille a, une fois de plus, retourné sa veste car il a rejoint les derniers Français soutenant le Führer qui vont bientôt avec la Waffen SS Charlemagne défendre le bunker d’Hitler et préparent des attentats sur le sol français. Mais voilà que dans ces heures sombres sévit un autre monstre : le docteur Petiot, ce tueur en série avant l’heure que l’on surnomme le docteur Satan. Sous le prétexte de les aider, ce dernier a en réalité, assassiné nombre de juifs pour s’emparer de leurs biens. Et bientôt le chemin de ce dernier croise celui de Sadorski. Surtout n’attendez pas que ce dernier se mette au service de la justice, non, Sadorski est surtout préoccupé par le trésor amassé par le tueur. La nouvelle aventure du héros de Romain Slocombe est une nouvelle fois passionnante. Elle emmène son lecteur dans cette période de l’immédiat après-guerre, entre crimes et vengeance, où les masques ne sont pas encore complètement tombés et où l’on ne distingue pas les héros des salauds. Un marécage puant parfait pour Sadorski. Et puis ce dernier sait mieux que quiconque que l’argent n’a pas d’odeur, surtout quand il s’agit de celui du diable…
Par Laurent Pfaadt