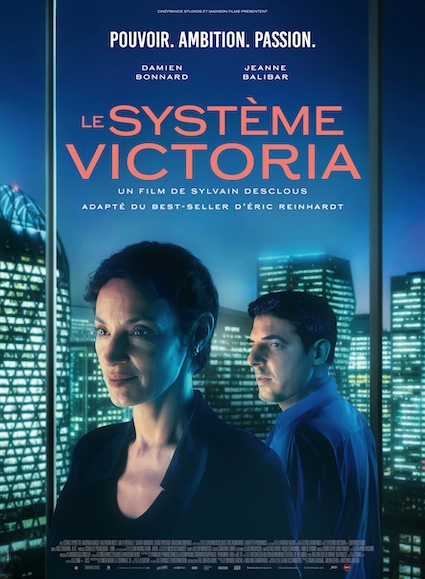un film de Manèle Labidi
Confirmant depuis Un divan à Tunis son sens de la comédie et du rythme, allié à un regard acéré porté sur notre société, Manèle Labidi signe avec Reine Mère un film drôle, original et salutaire en ces temps obscurs du rejet de l’autre.

Nécessaire sans doute quand on apprend qu’avant même la sortie du film, la réalisatrice a essuyé des critiques incendiaires de son film sur les réseaux sociaux, quand ce ne sont pas des insultes. Les questions posées lors des avant-premières où elle se rend pour présenter son film sont parfois renversantes de bêtise. Depuis les années 90, période à laquelle son film se déroule, la parole s’est décomplexée et dès lors, les gens ne se cachent plus pour afficher leur racisme. On croit voir un film « d’époque » – c’était il y a 40 ans – et Reine Mère est bien d’actualité.
Heureuse idée que d’avoir réuni Camélia Jordana et Soufiane Zermani, les parents de Mouna, scolarisée dans leur quartier parisien qu’ils ne veulent pas quitter alors que le propriétaire veut récupérer leur appartement. Le parcours du combattant pour trouver un logement est édifiant et répond à la question de la « ghettoïsation » dont font les frais les immigrés qu’il faut regrouper ensemble, le plus loin possible des centres villes. En ces années 90, avec la montée du parti du Capitaine Crochet et la guerre du Golfe, les arabes sont non persona grata. On voudrait que ce couple n’ait pas d’enfants ou bien qu’il soit italien ! Amor (Soufiane Zermani) est parfait dans son rôle de mari amoureux de sa femme et désespéré de leur situation. Comparé par la réalisatrice elle-même à Vittorio Gassman, il a une intensité de jeu remarquable. Quant à Camélia Jordana dans le rôle d’Amel, comparée quant à elle à Anna Magnani, elle a une fougue, une détermination et une énergie du personnage indomptable qu’elle incarne qui se refuse à se laisser piéger dans un déterminisme social assigné. Si elle doit être femme de ménage, ce sera sans blouse, en talons et auditrice libre de cours d’histoire à la fac où elle est employée.
Manèle Labidi a puisé dans ses souvenirs d’enfance et n’a pas voulu faire un film autobiographique mais une « biomythographie » (selon Audre Lorde). Déjà Freud en personne s’invitait sur le divan de Tunis. Ici, c’est Charles Martel qui surgit dans la cour d’école de Mouna et dans l’appartement familial. Seule Mouna le voit depuis qu’elle a entendu cette phrase terrible : « Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers » ! C’était en 732. Comme le dit la réalisatrice, quand elle était au CM1, cette phrase a éveillé un grand malaise chez elle et la prise de conscience qu’elle était arabe. Comment vivre avec ce sentiment dans la France de Chirac qui parle des « odeurs » … ? Charles Martel devient son ami imaginaire, Damien Bonnard, inénarrable dans sa cote de maille avec sa couronne sur la tête. Le film est poétique et plein de fantaisies, avec des morceaux de comédies musicales. Damien Bonnard, faisant des claquettes ou maquillé comme une poupée vaut le détour. Plus sérieusement, Charles Martel a été réhabilité pour la mémoire nationale au moment de la colonisation de l’Algérie. Il est une image fantasmée de la société française, loin de la vérité historique. Consulté pour le film, l’historien et auteur d’un livre sur Charles Martel, William Blanc, s’interroge sur la force symbolique du personnage : « Est-ce un spectre qui hante l’hexagone comme le reflet d’un passé et d’un présent dérangeant ? Ou bien symbolise-t-il un apaisement possible et une meilleure compréhension de l’autre ? » Le spectateur tranchera.
Elsa Nagel