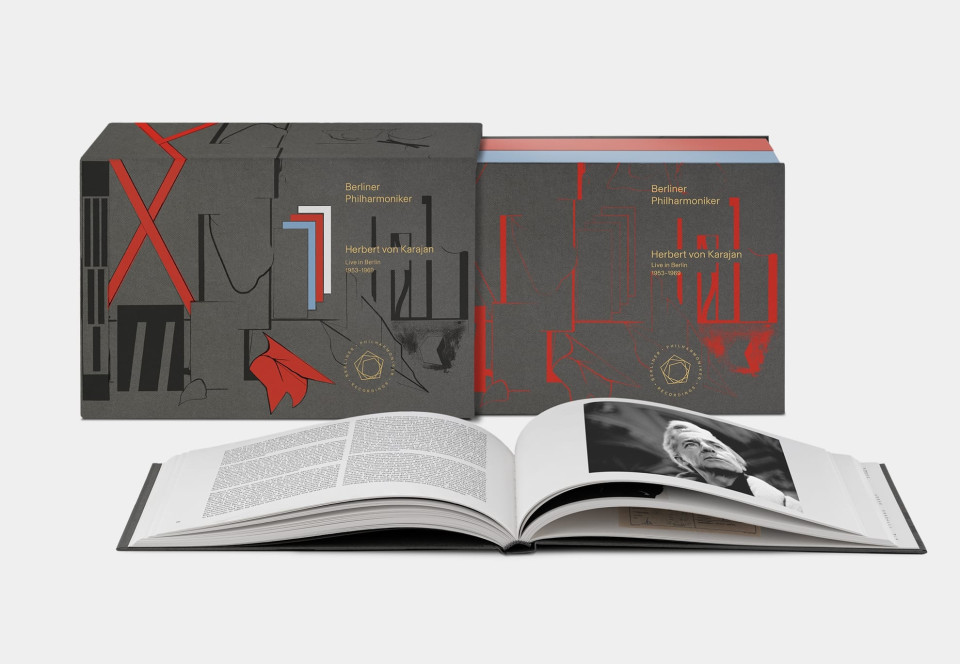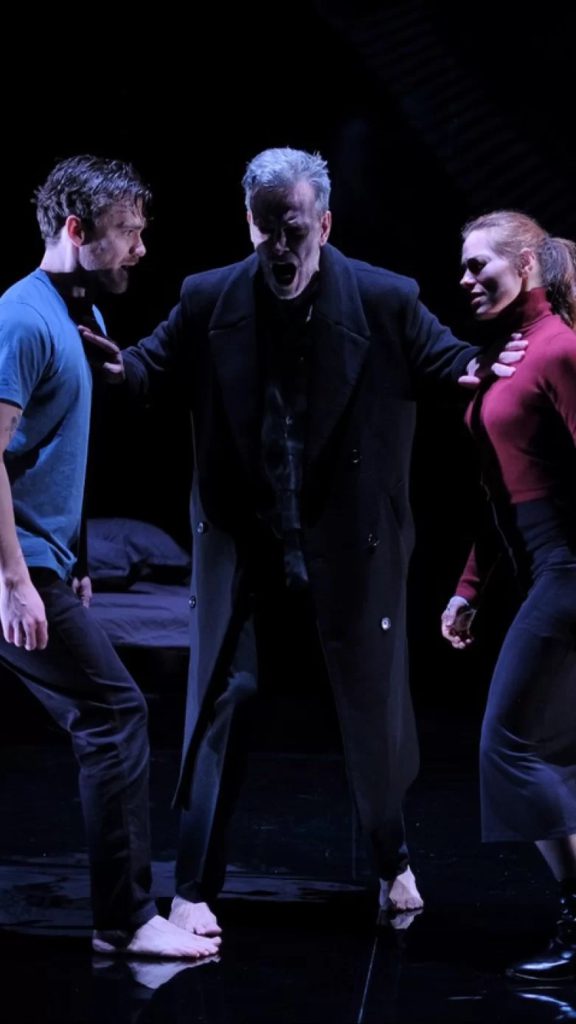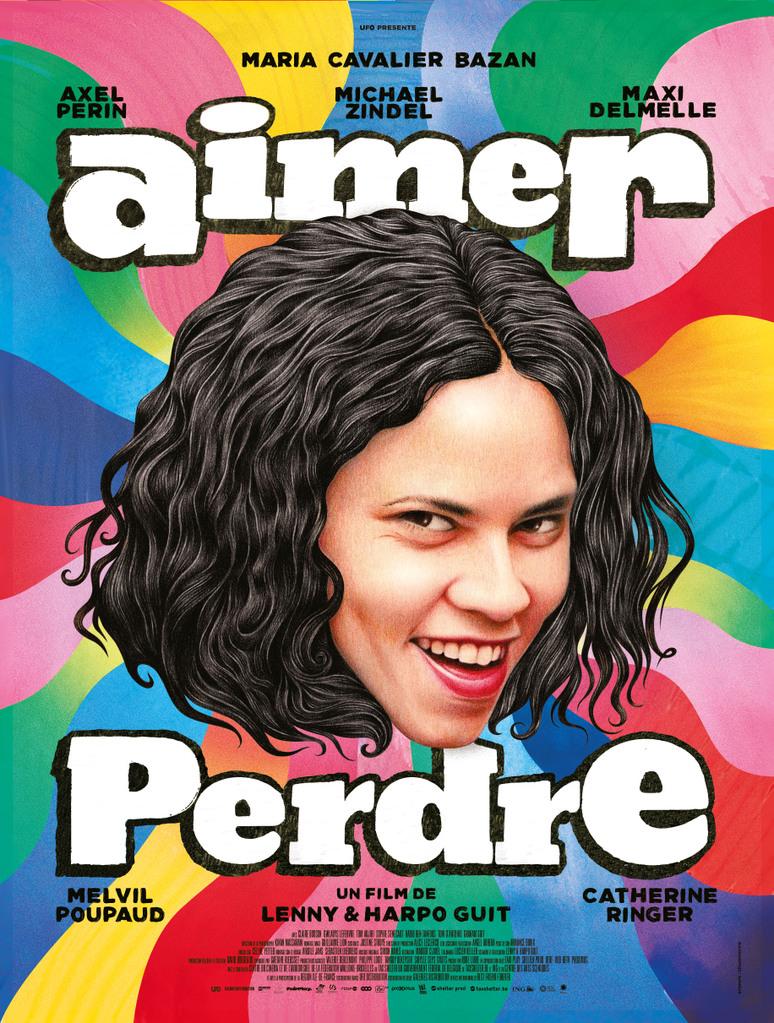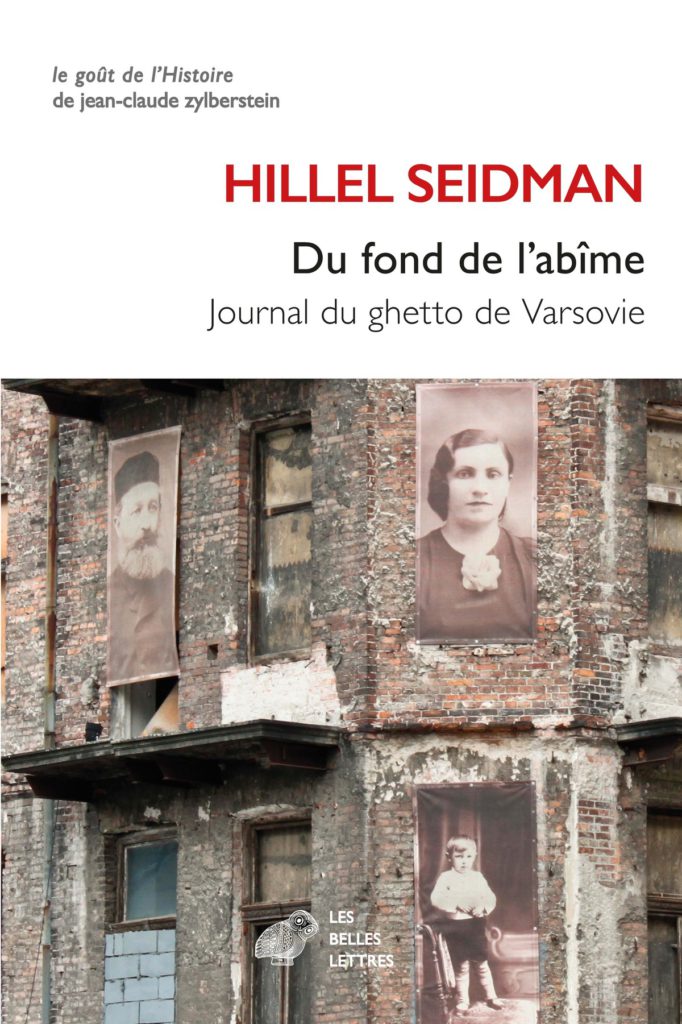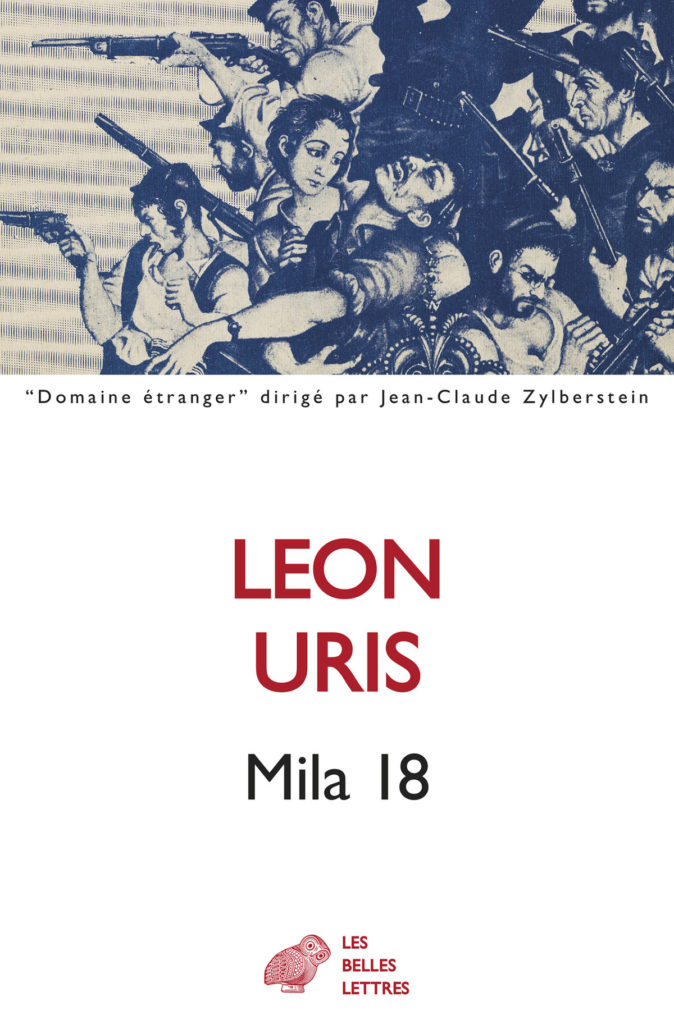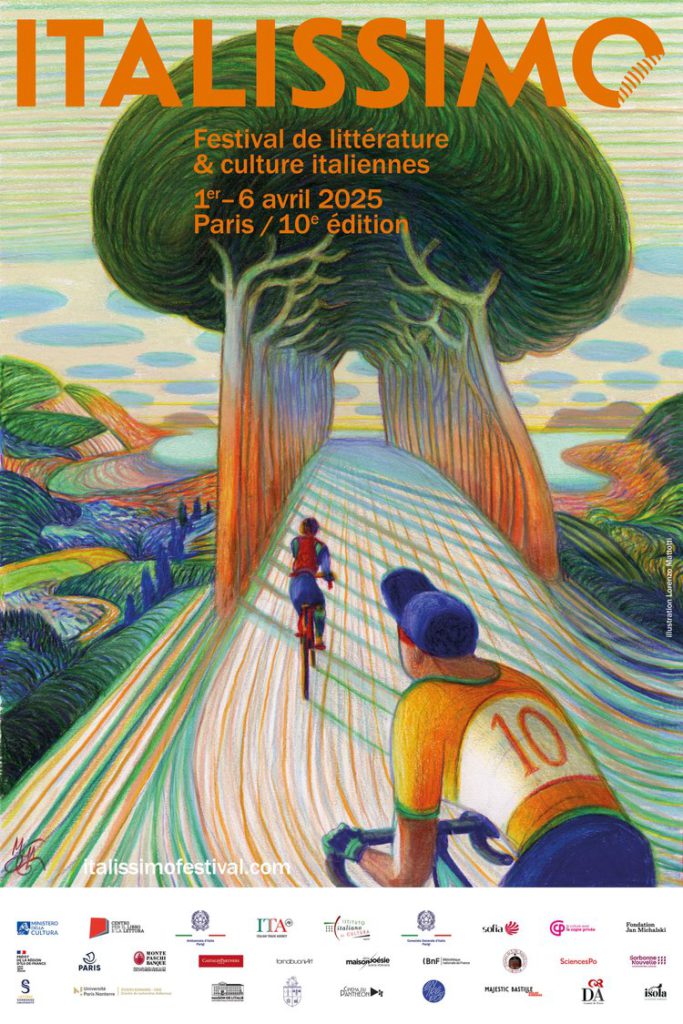Les éditions des Syrtes poursuivent la publication des œuvres de Gueorgui Demidov, l’une des grandes voix du goulag
Moins connu qu’Alexandre Soljenitsyne ou Varlan Chalamov, Gueorgui Demidov (1909-1988) doit être considéré comme l’un des grands témoins du goulag et du système répressif soviétique. Ingénieur à l’institut de physique de Kharkov, Demidov fut déporté à plusieurs reprises et passa près de vingt années dans différents camps notamment ceux, terribles, de la Kolyma qu’il décrivit dans ses ouvrages précédents publiés aux éditions des Syrtes : Doubar et autres récits du goulag (2021) et L’amour derrière les barbelés (2022), les deux premiers tomes d’une vaste entreprise de traduction de l’intégralité de l’œuvre de Demidov. Alors que le manuscrit de Vie et Destin de Vassili Grossman parvenait à l’ouest en 1980, celui de Demidov fut confisqué. Ce n’est qu’après sa mort et la glasnost en 1988 pour que le public put enfin découvrir la puissance évocatrice de son œuvre. Dans la préface de ce troisième tome baptisé Merveilleuse planète et traduit par Nicolas Werth et Luba Jurgenson, Geneviève Piron estime ainsi que dans ses écrits « Demidov atteint à l’universel : il fait sortir du camp la vie qui s’y trouvait reléguée et place le camp au milieu de la vie ».

A la différence d’un Soljenitsyne et d’un Chalamov, Demidov plonge ses récits dans une littérature qui, d’une certaine manière, rend peut-être plus justice à ces personnages incroyables sortis de circonstances extraordinaires et dont les traits de caractère peuvent parfois être victimes d’analyses trop cliniques. Chez Demidov, les truands sont romantiques et les intellos tentent de conserver une logique hors du temps. Mais c’est ainsi qu’ils demeurent humains. Là réside le pouvoir littéraire de Demidov, celui d’ériger l’imagination en bouclier indestructible qui se teint du bronze de l’amour, du fantastique et de la philosophie – les critiques du régime sont à peine voilées – pour opposer à ce même régime l’éclat de sa résistance.
Quant à Nicolas Werth, il ne s’est pas contenté d’écrire sur Chalamov et de traduire Demidov. Il est allé lui-même arpenter la route de la Kolyma pour rencontrer les derniers témoins et s’imprégner de cette atmosphère où le désarroi des hommes des temps passés rivalise avec la beauté d’une nature sauvage qui n’a jamais été domestiquée. Dans un merveilleux petit livre récompensé par le prix Essai France Télévisions en 2013 et publié en poche, il retrace, entre le 13 août et le 3 septembre 2011, le voyage qu’il effectua en Sibérie avec plusieurs compagnons dont Irina Flige, responsable de l’association Memorial à St Petersbourg et autrice du magnifique Sandormokh, le livre noir d’un lieu de mémoire (Les Belles Lettres, 168 p.), nom de ce charnier de la Grande Terreur en Carélie.
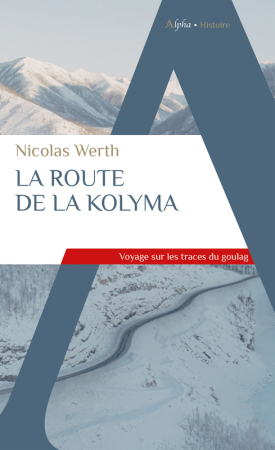
Nicolas Werth propose ainsi un passionnant voyage initiatique dans cette région de Sibérie riche en mines d’or devenue la terre du goulag et le tombeau de dizaines de milliers d’êtres humains condamnés à l’enfer parfois juste pour avoir volé un morceau de pain. Cette route de la Kolyma et ses paysages magnifiques célébrés par Chalamov notamment dans le pin nain est avant tout un voyage dans la mémoire, celle de l’enfer blanc qui accueillit plusieurs millions « d’ennemis » du stalinisme en compagnie des grandes voix, à la fois littéraires de Varlam Chalamov et d’Evguenia Guinzbourg, et celles, toujours aussi puissantes des derniers survivants. Son récit, passionnant de bout en bout, alterne entre découvertes des ruines des camps, récits des derniers survivants et de ces hommes et femmes qui tentent d’éviter que tombent dans l’oubli les mots de Demidov. « De même que les vestiges des camps s’étaient fondus dans la nature et le paysage de la Kolyma, l’expérience du camp à laquelle ils avaient eu la force de survivre s’était tout simplement dissoute dans la vie, dans leur vie, une vie faite de dureté, de luttes, de privations, de quelques joies aussi » écrit Nicolas Werth comme s’il parlait de Gueorgui Demidov. A l’heure où plus que jamais, le pouvoir russe tente d’effacer le passé après avoir interdit l’association Memorial et persécute toujours ses membres, la lecture de ces livres devient plus que nécessaire.
Par Laurent Pfaadt
Gueorgui Demidov, Merveilleuse planète, traduit du russe par Luba Jurgenson et Nicolas Werth
Aux éditions des Syrtes, 272 p.
Nicolas Werth, La route de la Kolyma
Chez Alpha Histoire, 272 p.