Plus d’un an de guerre et déjà le conflit opposant l’Ukraine et la Russie tend à se banaliser, à faire partie de notre quotidien. Les yeux du monde entier commencent à détourner leur regard vers une Chine de plus en plus menaçante envers Taïwan et vers une présidentielle américaine à ses débuts. La guerre continue cependant à faire rage dans les plaines et les villes d’Ukraine où des milliers d’hommes et de femmes périssent tous les jours parmi lesquels de nombreux artistes et écrivains engagés dans la défense de leurs terres et de leur liberté à qui nous rendons hommage ici tandis que leurs sanctuaires, les bibliothèques, sont détruites, rasées par les forces d’occupation. Valeriya Karpylenko, poétesse et combattante de l’usine Azovstal dont nous avions publié l’un de ses nombreux poèmes dans notre épisode précédent a été libérée le 10 avril. Elle a pu retrouver les siens et cultiver le souvenir d’Andrei, son mari tué dans l’usine de Marioupol.

Ainsi près de 1500 infrastructures culturelles ont été endommagées ou détruites depuis le début du conflit dont 555 bibliothèques, musées et galeries. Pour autant, la population ukrainienne aidée des forces armées se mobilisent pour reconstruire ce qui a été détruit dès qu’elles le peuvent notamment dans les villes reconquises comme à Rivne et Ternopil. A Kherson, après la reprise de la ville en novembre 2022 par les forces ukrainiennes, la bibliothèque centrale pour enfants a repris son activité. Les troupes russes ont volé ordinateurs portables et projecteurs mais n’ont pas touché aux livres ! Dans les villes toujours sous occupation notamment dans l’est du pays comme à Lyman, Toretsk ou Siversk dont nous publions les photos dans cet épisode, des bénévoles au courage exceptionnel, continuent à entretenir la flamme de la culture et du livre. Nous leur rendons également hommage.
Bibliothèque ukrainienne dont voici le sixième épisode n’oublie pas tous ces héros du quotidien et continue à mobiliser l’opinion pour défendre les bibliothèques du pays. Et tandis que l’histoire continue à s’écrire sur les champs de bataille, la guerre a définitivement pris place dans les livres d’histoire, les récits et autres témoignages. Andrei Kourkov, dans son Journal d’une invasion, a écrit que « la guerre et les livres sont incompatibles. Mais après la guerre, des livres raconteront son histoire. » Pour autant des livres racontent déjà cette histoire et comme à chaque épisode, Bibliothèque ukrainienne se veut l’écho de ces parutions qui rendent compte du conflit, de sa complexité et de son impact sur le monde. Pour ne pas banaliser cette guerre, pour rester mobilisé car, qu’on le veuille ou non, cette guerre est aussi la nôtre.
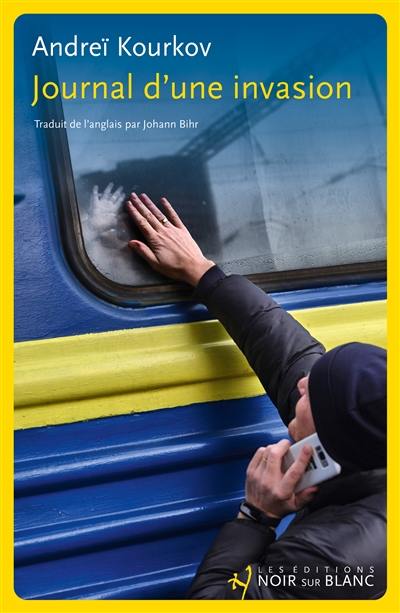
Andrei Kourkov, Journal d’une invasion, éditions Noir sur Blanc, 256 p.
Encore peu connu voilà deux ans, on ne présente désormais plus Andrei Kourkov, l’écrivain ukrainien le plus célèbre, prix Médicis étranger l’année dernière pour Les Abeilles grises (Liana Levi, 2022). Comme tant d’autres intellectuels et écrivains ukrainiens que nous avons relayé dans ces colonnes, il a fui son pays et vit désormais en exil en Allemagne. Dans Journal d’une invasion, il retrace cette guerre bien avant son déclenchement. Entre auto-dérision – la roulette du dentiste tombant en panne dans la bouche d’un patient faute d’électricité – et routine du quotidien qui prend des airs d’actes héroïques comme cuire et manger du pain dans les ruines, entre souvenirs d’enfance et opérations militaires (attaque de l’aéroport d’Hostomel, destruction de Marioupol), Andrei Kourkov livre avec ce document dédié aux soldats de l’armée ukrainienne – il confesse d’ailleurs ne plus pouvoir écrire de fiction – une profonde réflexion sur les rapports entre l’Ukraine et la Russie, sur leurs histoires politiques et leurs langues, sur enfin la réécriture de l’histoire.
Souvent, sa plume d’ordinaire si surréaliste se veut épique, martelant le lecteur comme un tocsin comme lorsqu’il affirme que « l’Ukraine sera soit libre, indépendante ou européenne, soit elle n’existera pas du tout ». Véritable ode à l’Ukraine, à son peuple et à sa souveraineté, ce Journal d’une invasion devrait connaître une suite.

Michel Goya, Jean Lopez, L’ours et le renard, Histoire immédiate de la guerre en Ukraine, Perrin, 352 p.
Très tôt la bataille de Bakhmout a été surnommée la « Verdun de l’Ukraine » par de nombreux médias. Une histoire immédiate qui venait d’entrer de plein fouet dans celle des 20e et 21e siècles. Il était donc naturel que sa codification à une échelle globale prenne forme alors même que le conflit n’est pas encore achevé.
Les deux auteurs – Michel Goya, expert du fait militaire et Jean Lopez, l’un de nos meilleurs spécialistes de l’histoire de la guerre à l’Est pendant le second conflit mondial – ont choisi le dialogue pour évoquer cette première année de guerre, leur analyse s’arrêtant à la mi-mars 2023. Ils y évoquent notamment dans un récit qui fourmille de détails l’attaque du 24 février 2022 et l’échec de la Blitzkrieg, l’évacuation de Kherson, la milice Wagner, les crimes de guerre, la fourniture de chars par les puissances européennes ou les tentatives d’assassinat contre le président Zelensky et son gouvernement. Leurs expertises et analyses concentrées sur le fait militaire demeurent toujours pertinentes notamment lorsqu’elles évoquent la possibilité d’une contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays, contre-offensive déclenchée ces derniers jours : « une percée en direction de Melitopol serait beaucoup plus productive. Si les Ukrainiens parvenaient à la mer d’Azov, le front russe serait coupé en deux. »
Une raison suffisante pour lire ce livre passionnant de bout en bout qui permet, au-delà des flux d’informations, de resituer et de comprendre avec clarté ce qui se joue aux portes de l’Europe.
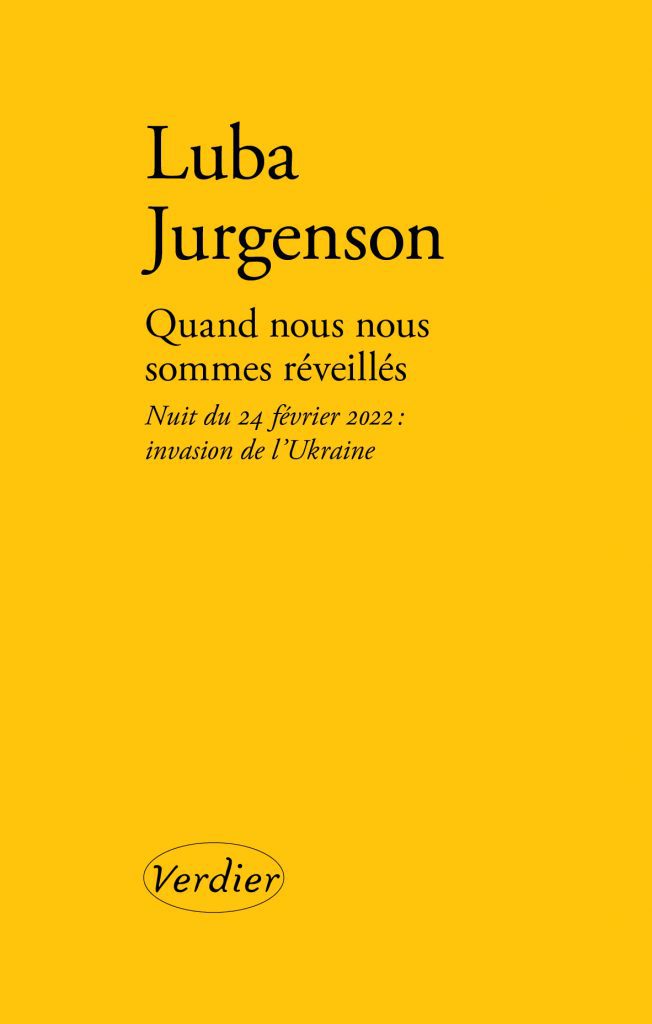
Luba Jurgenson, Quand nous nous sommes réveillés, nuit du 24 février 2022 : invasion de l’Ukraine, Verdier, 96 p.
L’une de nos meilleures traductrices du russe, Luba Jurgenson évoque dans ce témoignage personnel, sa sidération de la guerre. Vécu comme un cauchemar qui a pris forme sans s’en rendre compte, dans ces petits riens qu’on ne remarque pas, son témoignage mêle à la fois récit personnel et histoire d’une dérive de ce pays dont elle aime tant les écrivains.
Pour vaincre ce cauchemar, Luba Jurgenson utilisent les armes qu’elle connaît le mieux : la langue, la littérature et l’histoire. Elle convoque ses maîtres, ceux dont elle a épousé les voix, Chalamov bien évidemment mais également Grossman et Mandelstam et ses souvenirs de ce « pays disparu » que l’on croyait à jamais rangé dans les livres d’histoire. Aujourd’hui ces derniers, en Russie, suintent du sang de la guerre et tentent par tous les moyens d’amputer à l’Ukraine, ce « bras gauche de l’Europe », sa liberté et sa langue. Avec ce témoignage à la fois touchant et inspirant, Luba Jurgenson nous invite à entrer dans sa « maison dévastée » pour y trouver quelques motifs d’espoir malgré tout.
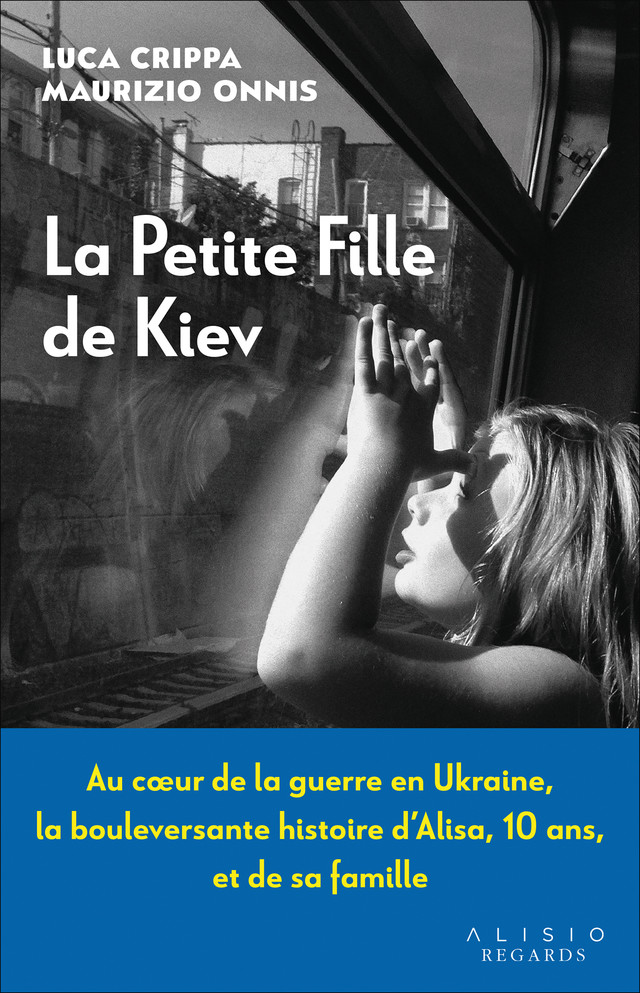
Luca Crippa, Maurizio Onnis, La petite fille de Kiev, Alisio, 320 p.
Alisa est partout et nulle part à la fois. Elle n’existe pas et en même temps elle est le visage de tous ces enfants ukrainiens. Voilà ce qu’on ressent à la lecture de ce livre puissant, envoûtant jusqu’à la dernière page. A cause de son caractère universel. Luca Crippa et Maurizio Onnis, auteurs du Photographe d’Auschwitz, ont composé à partir de centaines de témoignages de réfugiés et de victimes ce récit, cette narrative non-fiction qui évoque la guerre à hauteur d’enfant.
Vivant dans une banlieue de Kiev, Alisa, dix ans, et sa famille sont comme des millions d’Ukrainiens surpris par l’attaque des forces russes à laquelle ils n’ont pas voulu croire. Jetées sur les routes de l’exil aux premières heures du 24 février 2022, elles tentent alors de rejoindre Lviv. Alisa ne comprend pas immédiatement ce qui se passe puis voit un peuple entier reprendre courage et résister. Elle s’émeut à propos de choses qui n’appartiennent qu’à l’univers des enfants comme ces animaux des zoos qu’il faut protéger et qui pourtant concourent à faire de la banalité de la vie, un élément de paix et de stabilité qui a volé en éclats. Mais bientôt la résistance et la résilience reprennent le dessus. Ce livre est bouleversant car Alisa pourrait être la fille de chaque lecteur, une petite fille devenue trop vite adulte.
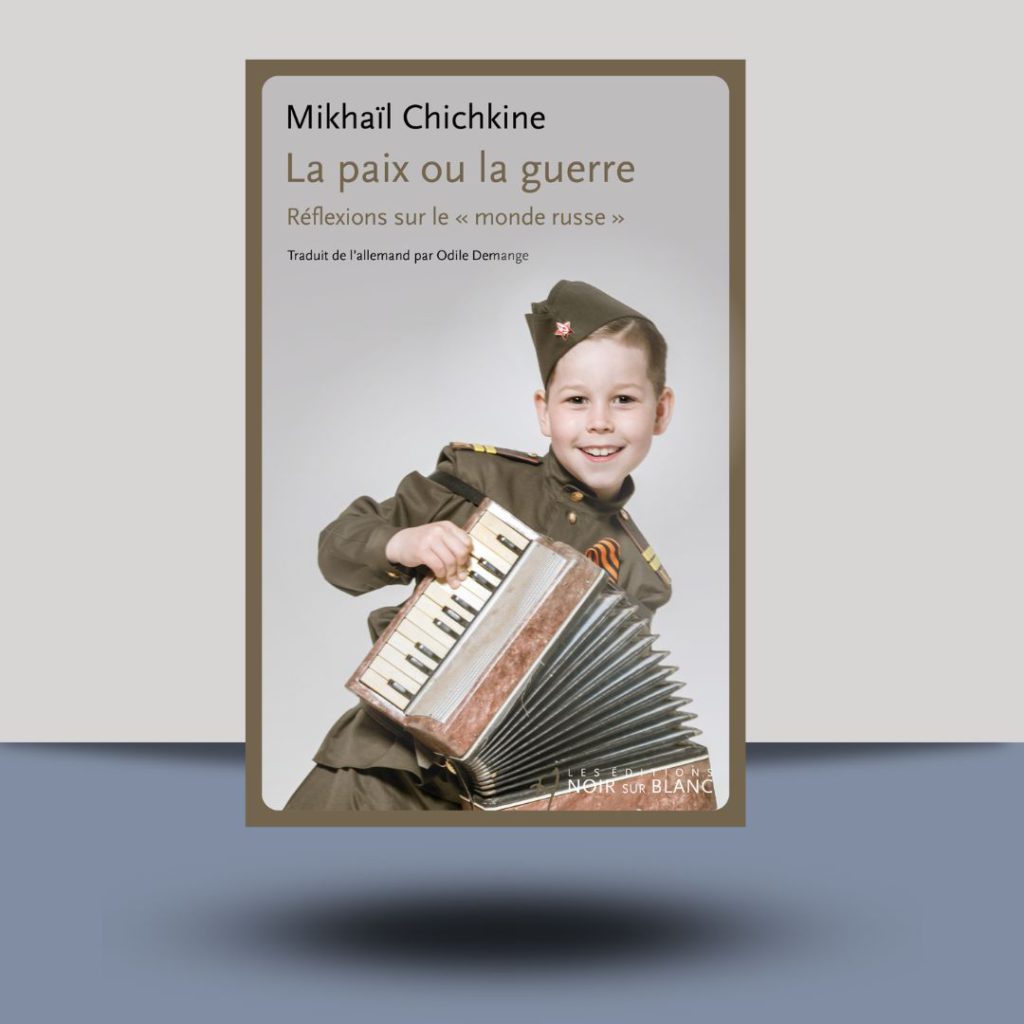
Mikhaïl Chichkine, La paix ou la guerre, Réflexions sur le « monde russe », éditions Noir sur Blanc, 208 p.
Ecrire l’histoire, c’est aussi analyser en toute objectivité, les motivations de l’agresseur. Poursuivant la lecture entamée avec le Journal d’une invasion d’Andrei Kourkov et son analyse de la réécriture de l’histoire par la Russie, les éditions Noir sur Blanc publient dans le même temps le recueil d’essais de Mikhaïl Chichkine sur le monde russe. L’un des intellectuels russes les plus brillants de sa génération et opposant à Vladimir Poutine depuis l’annexion de la Crimée en 2014 a été récompensé pour ce livre par le prix Strega européen en 2022, ex-aequo avec Amélie Nothomb.
Il y livre des réflexions éclairantes sur des sujets tels que la mésentente entre Russie et Occident, le style de vie russe ou les relations à venir entre la Russie et le monde. Particulièrement intéressante est son analyse des tentatives démocratiques qui conduisirent invariablement à de nouvelles autocraties et dictatures dans l’histoire russe. Un livre plus que salutaire pour comprendre ce monde de demain dans lequel, fatalement, la Russie aura, une nouvelle fois, un rôle à jouer.
Par Laurent Pfaadt
