George Orwell & La vie ordinaire de Stéphane Leménorel
Dès les Trente Glorieuses, d’éminents lanceurs d’alertes avaient prédit la plupart des désastres qui compromettent « la possibilité d’avoir encore un monde » (p. 62). La biologiste Rachel Carson et son Silent Spring (1962) ou l’agronome René Dumont, le philosophe Günter Anders, des écrivains aussi : Romain Gary avec Les racines du ciel (Goncourt 1956)… Mais avant eux, dès les années trente, Georges Orwell (1903–1950) dénonçait le mythe du progrès et prônait la décroissance.
Dans la collection dirigée par Serge Latouche « Précurseur·ses de la décroissance » chez le passager clandestin, Stéphane Leménorel nous présente (souvent avec de jolies formules) les analyses et les idées que développait l’auteur britannique incluant des extraits d’œuvres moins connues que 1984.
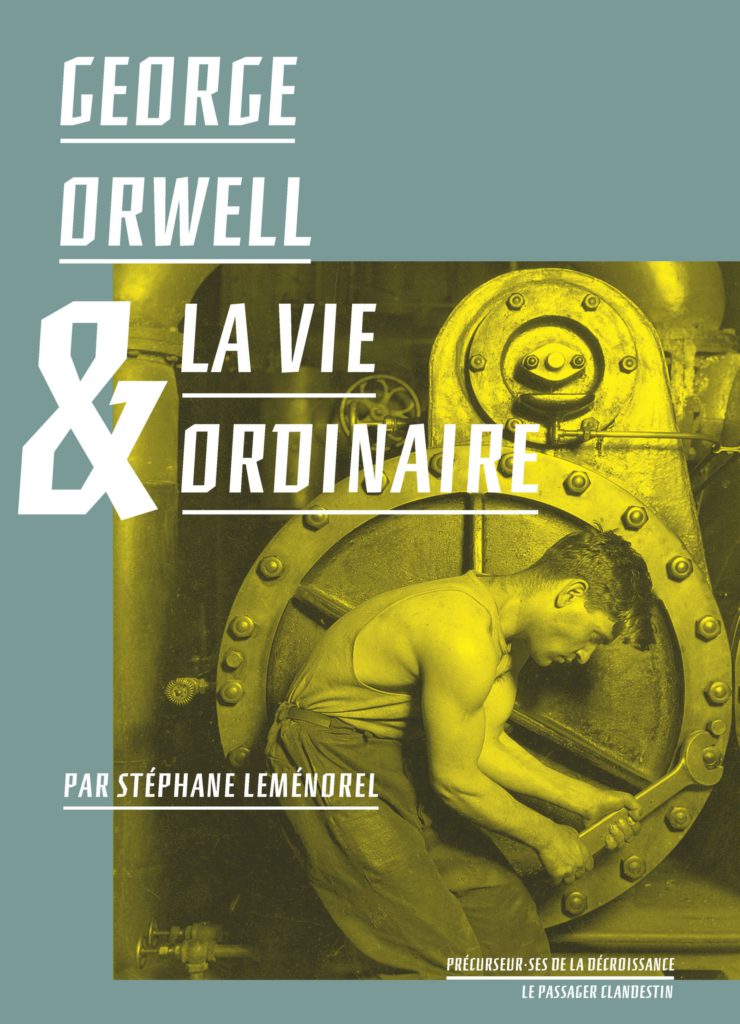
« George Orwell a construit sa pensée au contact des
réalités concrètes, n’ayant pas hésité à s’immerger dans la misère la plus
sordide pour comprendre ce monde de l’intérieur. » (p. 12)
Et cela par-delà le genre. Le roman Une histoire birmane (1935)
s’inspire des cinq années passées dans la police impériale britannique (je
servais dans la police, c’est-à-dire que j’étais au cœur de la machinerie du
despotisme [1]).
Avec des récits inspirés de son expérience personnelle, Dans la dèche à
Paris et à Londres (1933) évoque sa vie parmi les pauvres des deux
capitales. Avec des chroniques de témoin privilégié, Hommage à la Catalogne
(1938) relate sa participation à la guerre d’Espagne auprès des Républicains et
le traumatisme de l’impitoyable liquidation des autres mouvances communistes
par les staliniens. Et aussi des reportages commandités : les conditions
de vie des mineurs avec Le Quai de Wigan (1937) ou comme correspondant
de guerre en Europe (1945).
« Si c’est en Espagne qu’il a fait la rencontre,
décisive, du mensonge politique organisé, il le retrouve également en
Angleterre. » (p. 20)
Ses critiques du stalinisme se heurtent à la russophilie aveugle des
intellectuels de gauche. Ces controverses avivent sa farouche méfiance envers la
sphère politique dont il déconstruit les discours en pointant l’usage pervers
des mots : La politique et la langue anglaise (1946). Comment ne
pas penser à LTI, la langue du IIIe Reich de Victor Klemperer
(1947) ? Et effectivement dans sa dystopie 1984 (son dernier livre),
Orwell érigera la novlangue en vecteur essentiel de la tyrannie.
« La machine est le modèle le plus abouti de la
rationalité économique. Elle correspond au projet d’une modernité viciée »
(p. 41)
Avec à terme, la transformation de l’homme en automate comme le regrette Orwell
ou en machine comme le développe Günter Anders dans L’obsolescence de
l’homme (1956). En prolongement Stéphane Leménorel suggère le
travestissement de ce futur « camp de concentration technologique
universel » par les accessoires de La société du spectacle (Guy
Debord, 1967).
« L’empire de la nature, pour impitoyable qu’il soit,
est bien moins violent que l’empire des hommes, et bien moins encore que celui
des machines. » (p. 57)
Dans sa réflexion, Orwell souhaite avant tout ouvrir des horizons à défaut
d’apporter des réponses définitives et toutes faites – il les détestait !
– avec l’envie de réenchanter le monde. La décroissance n’est pas un retour à
l’âge de pierre et il s’y adonne dans l’île de Jura en Écosse où il s’est
retiré loin de la modernité et des métropoles.
Orwell : une pensée claire, exigeante et visionnaire. Malheureusement… car dans son œuvre, « il est rare d’y trouver une inquiétude dont l’avenir n’ait pas montré la justesse » (p. 111).
Par Luc Maechel
Stéphane Leménorel, George
Orwell & La vie ordinaire
le passager clandestin, collection « Précurseur·ses de la
décroissance »,
124 p., 10 €
[1] Le Quai de Wigan (1937)