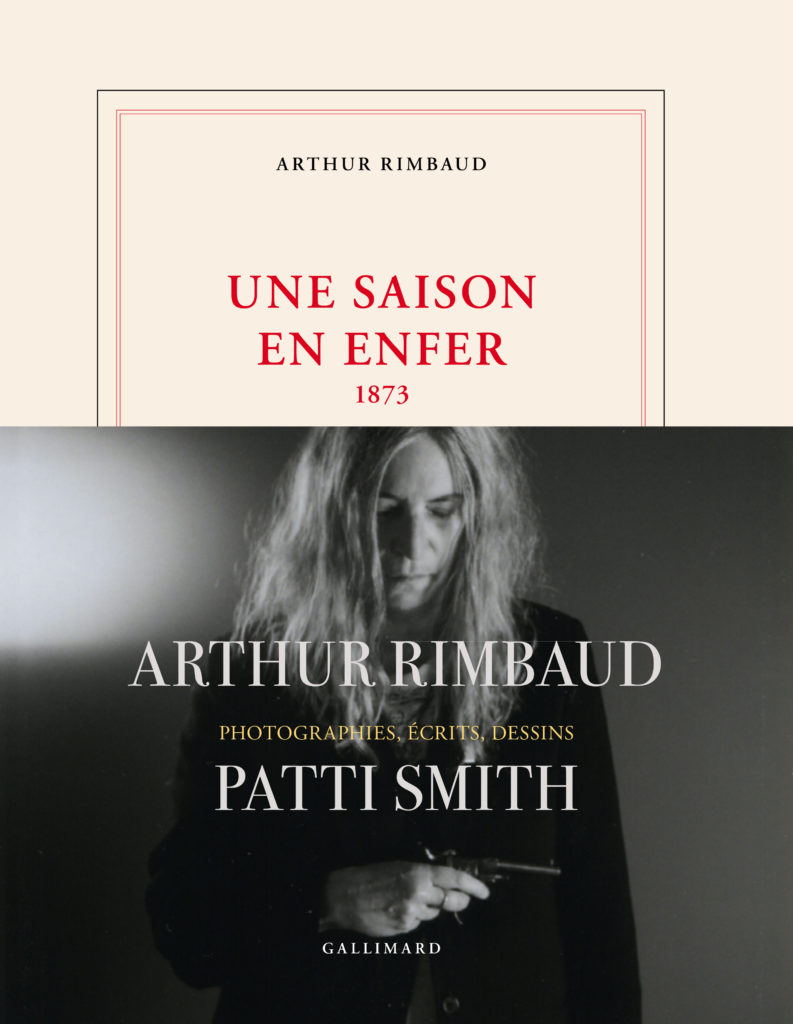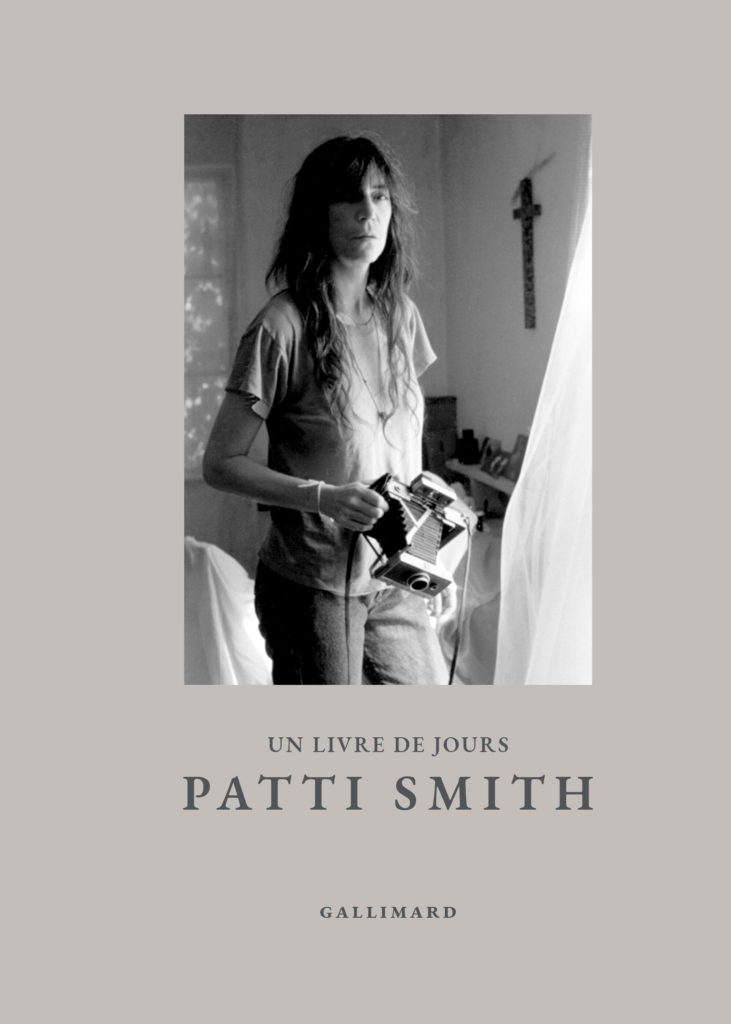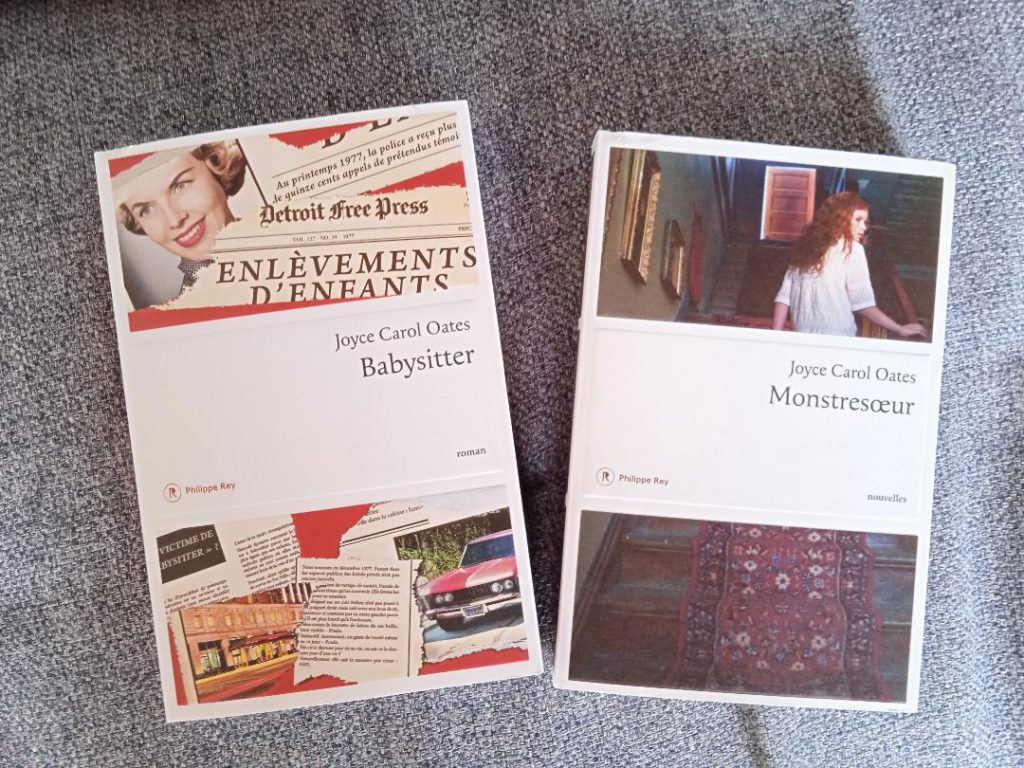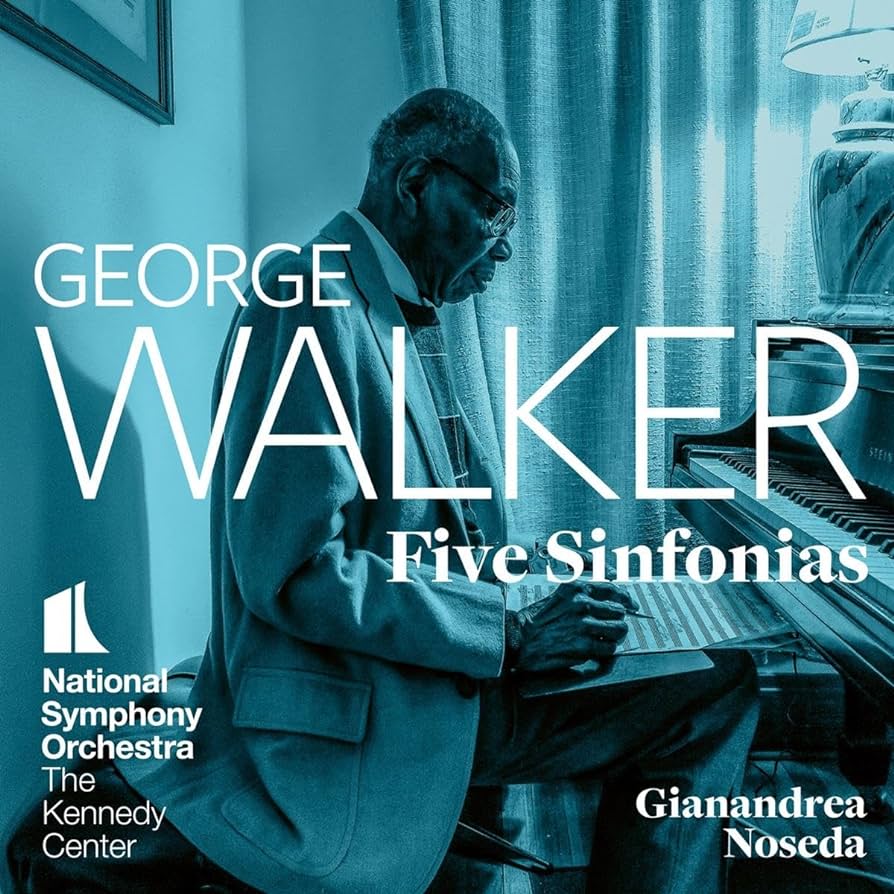Un ouvrage passionnant retrace les combats des Tchécoslovaques contre les totalitarismes du 20e siècle
Durant ce 20e siècle si tourmenté, les Tchécoslovaques personnifièrent mieux qu’aucun autre peuple, la lutte sans cesse recommencée contre toutes les formes de totalitarisme. C’est ce que nous montre à merveille Paul Lenormand, maître de conférences à l’université Paris-Nanterre dans ce livre passionnant tant dans sa construction que dans sa façon de faire cohabiter le global et le particulier. Paul Lenormand a ainsi fait le choix de transcender les frontières historiques pour jeter une lumière sur la longue durée.
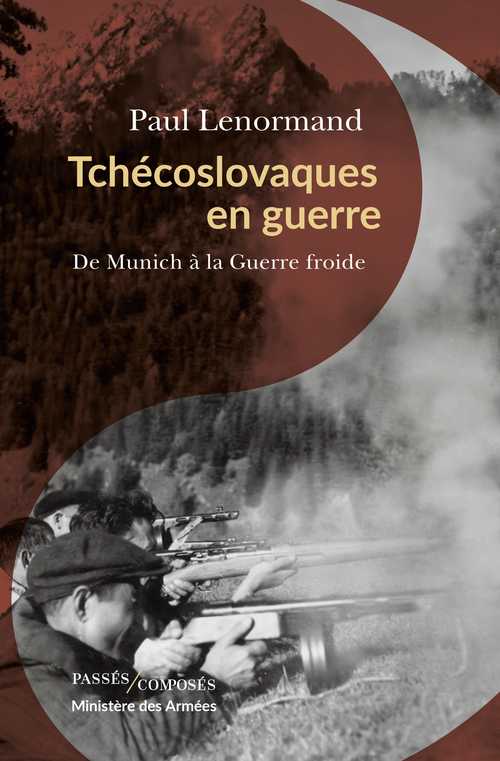
A la suite du traité de Versailles, en 1919, naquit le nouvel Etat de Tchécoslovaquie réunissant tchèques et slovaques sous l’égide de leur père fondateur, Tomáš Masaryk. Un pays pourtant « sans assise historique » comme le rappelle l’auteur qui agrégea diverses minorités notamment allemande avant de devenir dans les années 1930, sous l’égide d’un Edvard Benes, une terre convoitée par le Troisième Reich.
Abandonnée par les puissances occidentales en 1938 lors des accords de Munich qui mirent fin au rêve démocratique puis divisé entre une Bohème-Moravie écrasée par un Reinhard Heydrich et une Slovaquie indépendante placée entre les mains de Monseigneur Jozef Tiso, le peuple tchécoslovaque se mobilisa secrètement pour abattre la tête de l’hydre nazi.
Paul Lenormand montre ainsi parfaitement la lutte engagée dans ces années de guerre entre ceux qui d’alliés allaient devenir les futurs ennemis de la guerre froide. Car si les Anglais armèrent les hommes de l’opération Anthropoïd qui éliminèrent le numéro 2 de la SS, Moscou procédait dans le même temps à la soviétisation de l’armée en vue d’une future prise de pouvoir. Et malgré les velléités du général Patton, c’est bien l’armée rouge qui entra la première dans Prague constituant ainsi « une occasion manquée manifeste pour des Américains timorés » selon l’auteur.
Commença alors un nouvel hiver marqué par le coup de Prague en 1948, l’épuration des élites et la promotion d’hommes tels que Bedrich Reicin à la tête du renseignement militaire qui rejoint dans ce livre une galerie de portraits fascinants. Un Reicin qui fut lui-même victime d’une autre purge en 1952. Autre pays communiste mais mêmes méthodes.
Pour autant, les Tchécoslovaques ne renoncèrent pas à la liberté. Même un printemps orageux et avorté en 1968 ne les empêcha pas de rêver à cette liberté qu’ils obtinrent finalement en décembre 1989. Leur courage, leur abnégation sont aujourd’hui entrés dans la mémoire de l’humanité et ce livre leur rend un vibrant hommage.
Par Laurent Pfaadt
Paul Lenormand, Tchécoslovaques en guerre, de Munich à la guerre froide
Chez Passés composés, 352 p.