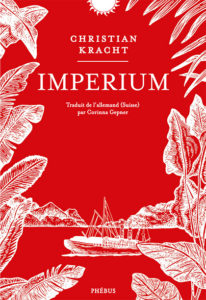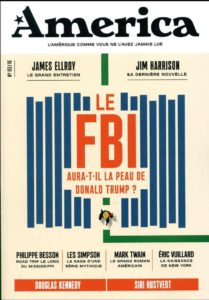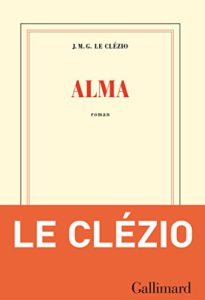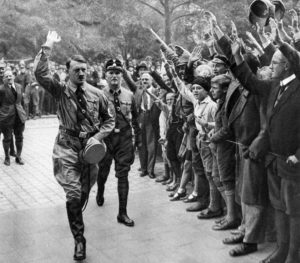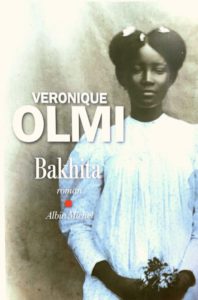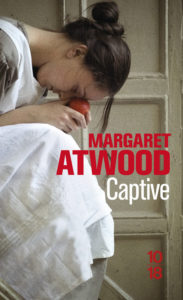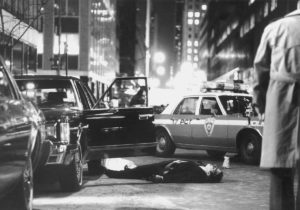Béatrice Mousli signe une biographie réussie de l’intellectuelle
Susan Sontag
« Un grand poète est moins un inventeur qu’un éclaireur » disait le
grand Jorge Luis Borges. Et en pensant à Susan Sontag, éclaireur
est le mot qui vient immédiatement à l’esprit tant elle défendit des
sujets qui n’allaient pas de soi.
Près de treize ans après sa mort, la France paie enfin sa dette à
cette grande amoureuse de notre pays avec cette biographie qui
permet de mieux connaître cette inconnue du grand public
français qui fut pourtant l’une des intellectuelles américaines les
plus importantes et les plus influentes de la seconde partie du 20e
siècle.
Résumer la vie de Susan Sontag relève de la gageure tant cette
intellectuelle brilla dans des arts et des univers différents, un peu
à la manière de ces artistes de la Renaissance, étrangers à toute
notion de frontières artistiques. C’est ce que montre Béatrice
Mousli, professeur à l’université de Californie du sud, dans cette
biographie remarquable. L’auteur est ainsi allé puiser dans cette
Los Angeles qu’aimait tant Susan Sontag et pour la première fois
dans les archives de l’université de Californie, matière à sa
biographie pour tracer les contours intellectuels de cette figure
artistique, philosophique, littéraire et surtout citoyenne. Car c’est
ainsi que ressort l’image de Sontag, celle d’une citoyenne du
monde qui porta la voix d’une Amérique telle qu’on l’aime et qui se
fait de plus en plus rare, celle d’une liberté sans concessions
comme lorsqu’elle attaqua violemment en 1982 le communisme,
qualifié de « fascisme à visage humain ». Cependant, cela
n’empêcha pas Sontag ne se montrer parfois féroce à l’égard de
son propre pays, en stigmatisant, vilipendant l’impérialisme
américain et lui valut de militer contre les guerres du Vietnam et
d’Irak. En Sontag, les Etats-Unis trouvèrent paradoxalement l’une
de leurs meilleures ambassadrices, prouvant que, malgré ses
travers et ses inégalités considérables, ce pays recèle une vitalité
démocratique considérable, capable de produire et de laisser
s’exprimer des personnes comme elle.
Celle que les médias considéraient dans les années 60 comme « la
femme la plus intelligente d’Amérique » s’engagea également en
faveur des droits de l’homme, des malades du SIDA ou du
féminisme avec des positions avant-gardistes comme lorsque,
dans la revue des Temps modernes, en décembre 1975, elle
estimait que l’égalité passera par les abandons des idées de
féminité et de masculinité au profit de celle d’êtres humains.
Enfin, cette biographie est un formidable voyage dans cette
culture qu’elle vénérait plus que tout. La photographie qui la
fascina et dont elle écrivit un essai mais également la littérature –
véritable boulimique, elle pouvait lire un livre par jour – ou le
cinéma (son film Brother Carl fut projeté hors compétition à
Cannes en 1972). La biographie fourmille ainsi d’artistes et de
personnages. On y croise outre Annie Leibowitz bien entendu,
Jasper Johns, Andy Warhol, John Cage, Merce Cunningham,
Joseph Brodsky ou Jorge Borges. Elle-même auteur, elle remporta
le National Book Award, le principal prix littéraire américain pour
son ouvrage En Amérique. « De nombreuses personnes considèrent
lire comme une manière de s’évader, du monde réel de tous les jours
vers un monde imaginaire, celui des livres. Les livres sont bien plus que
cela. Ils sont une façon de devenir pleinement humain » disait-elle à
propos des livres.
Borges avait raison, Sontag était une grande poétesse.

Laurent Pfaadt
Béatrice Mousli,
Susan Sontag, Grandes biographies,
Flammarion, 624p. 2017