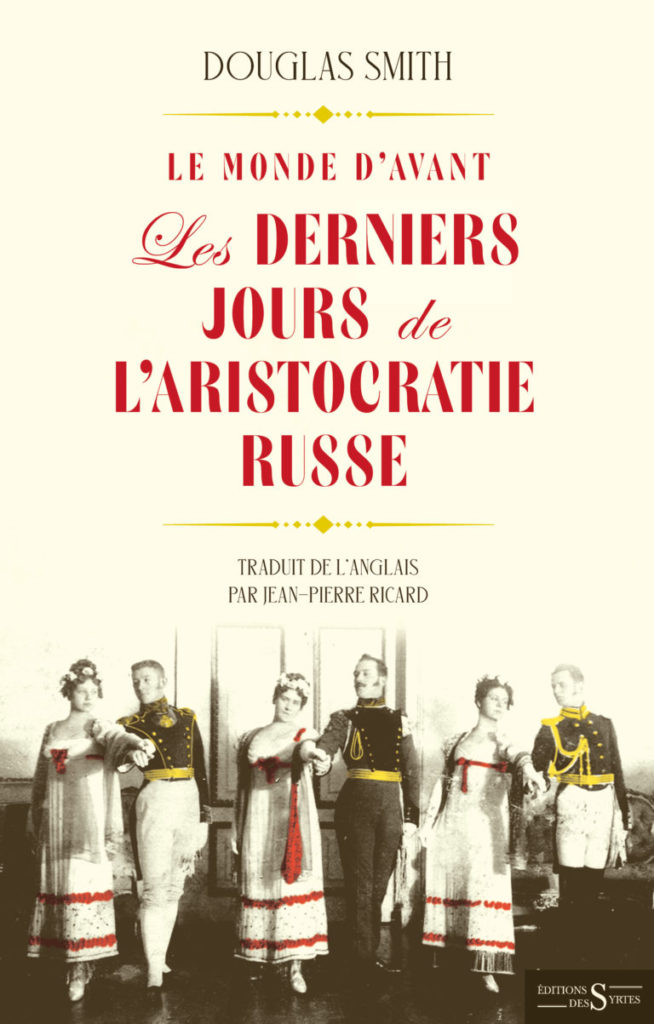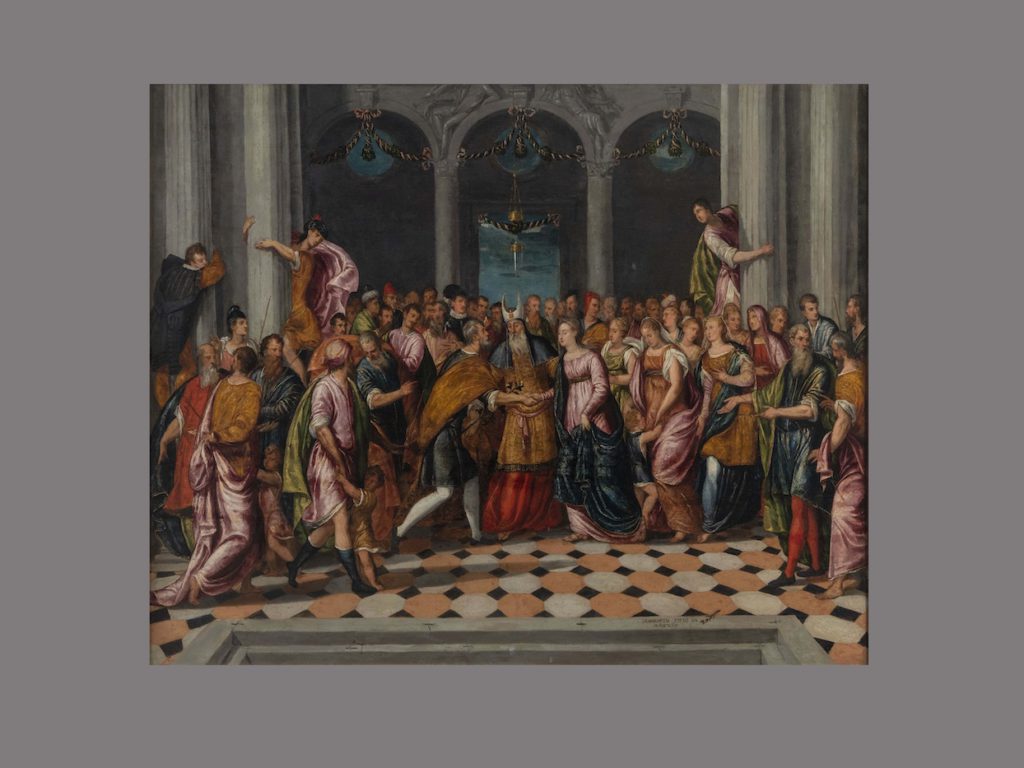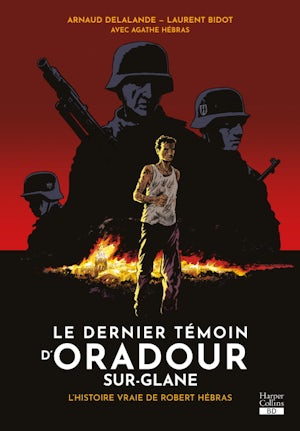La jeune comédienne d’origine turque Hatice Ozer nous a offert deux spectacles dans lesquels la musique, la poésie, la sensibilité et la joie de vivre tenaient une large place.

Sur le plateau c’est un endroit de vie simple qui est mis en place, qui rappelle la modestie des lieux où elle a vécu enfant dans cette cité du Périgord où se retrouvaient de nombreux émigrés turcs. On y voit une petite table et deux chaises, un instrument de musique suspendu au plafond, une grande bassine pour se laver, une malle en osier d’où Hacine habillée en jeune fille sage avec sa robe de velours noir et ses petites socquettes blanches retire un récipient rempli d’une terre avec laquelle en l’éparpillant elle dessine les contours de son aire de jeu, symbole d’un pays lointain et de celui qui est maintenant son lieu de vie, le théâtre, ce théâtre dont elle avait très tôt le désir, mais ne s’y sentait pas forcément autorisée en raison de la situation sociale de ses parents qui voulaient qu’elle ait un « vrai métier » puisqu’ils avaient quitté leur pays, en l’occurrence la Turquie, en1986 pour donner à leurs enfants des chances de réussite. Elle s’imposa donc de faire des études d’arts plastiques pour devenir professeur mais n’abandonna pas son désir de devenir actrice. Après le conservatoire de Toulouse, c’est à Strasbourg qu’elle complète sa formation en suivant le cursus « Premier Acte » initié par Stanislas Nordey.
Devenue comédienne elle joue dans plusieurs pièces puis crée sa propre compagnie « La neige la nuit » basée en Dordogne.
Bientôt nous dit-elle un cauchemar lui revient à plusieurs reprises où elle se voit dans l’eau, entourée de noyés et retournant l’un d’eux, elle découvre le visage de son père.
Elle réalise alors que son père, Yavuz Ôzer est, à sa manière, un artiste. Ne fait-on pas appel à lui pour, les fêtes qu’il agrémente par ses contes et ses chants ? il est un « amoureux », un « ashik » comme on dit en Anatolie, le pays d’où il vient.
L’idée lui vient de faire un spectacle avec lui, désir d’un partage à faire, justement partager avec un public que l’on reçoit comme dans un « Khâmmarât », un cabaret où l’on boit et chante.
Et ce soir nous y sommes conviés.
Tout commencera par la cérémonie du thé, le préparer et l’offrir. Quelques spectateurs en seront bénéficiaires mais tous l’apprécient comme ce signe d’hospitalité et de partage.
Lui est arrivé avec simplicité, vêtu d’un jean et d’une chemisette beige et tout en buvant le thé, père et fille évoquent ces histoires qui, au dire du père, sont un mélange de 60/00 de vérité, 30% de mensonge et 10% de mystère.
Bientôt, il va décrocher le saz le luth oriental qui ne doit jamais toucher terre et qui accompagne les chants pleins de mélancolie qui parlent d’amours contrariées, de la beauté des femmes aux, sourcils noirs et aux gros seins. Hatice traduit ces paroles qui, on le sait, touchent, quand ils se réunissent autour de lui, les gens de son pays venus travailler comme lui sans désir d’être là, pour échapper à la misère.
Alors pendant qu’il chante ses mélopées Hatice esquisse des pas de danse tout en plantant sur le plateau des tiges de fleurs jaunes le transformant en un jardin paradisiaque comme pour narguer la tristesse du destin et témoigner de la lumière qu’apportent la poésie, la musique, l’art théâtral dont ensemble ils sont acteurs.
Marie-Françoise Grislin pour Hebdoscope
Représentation du 22 mai au TNS