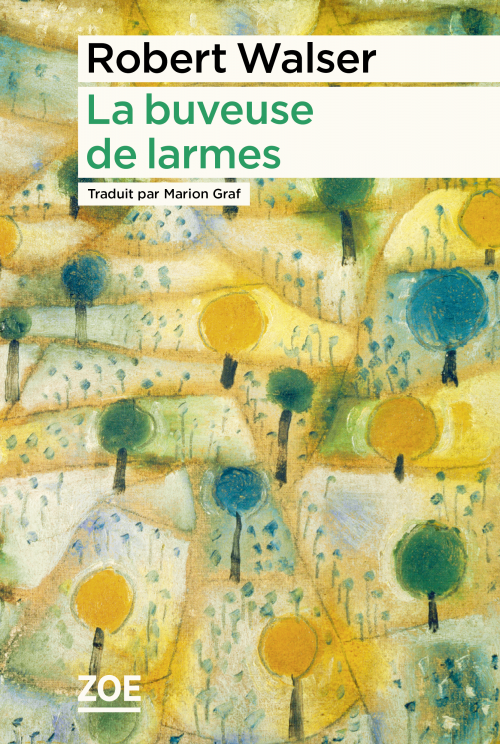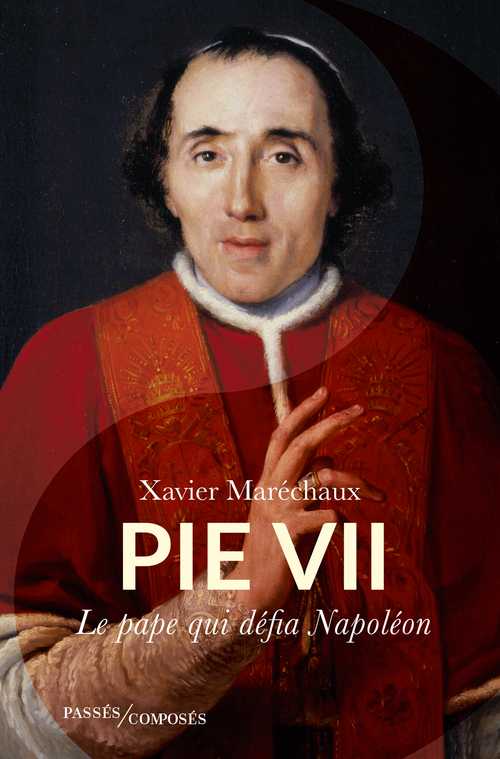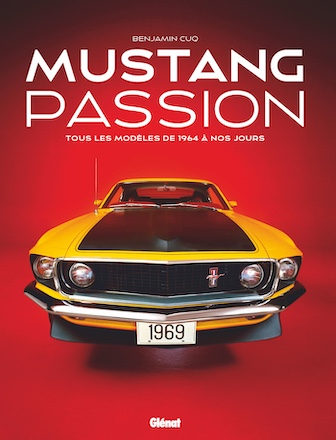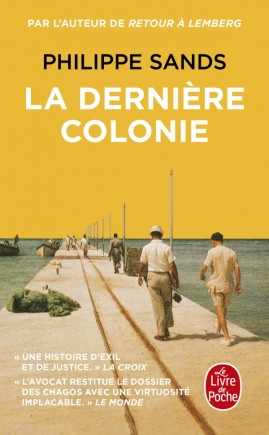Un film de Saïd Belktibia
Basé autour de souvenirs d’enfance de son metteur en scène, Roqya est un film qui mêle plusieurs genres. Le thriller y côtoie le fantastique, au cœur d’une chasse à la sorcière éprouvante.

Présenté il y a quatre mois hors compétition au 31ème Festival International du Film Fantastique de Gérardmer, le film y a reçu un accueil plutôt chaleureux. Dans cette histoire de persécution que subit une jeune maman élevant seule son fils, Saïd Belktibia a mis des souvenirs de son enfance agitée. A l’époque, sa mère le pensait habité par un esprit maléfique (un djinn), et avait justement eu recours à la roqya, cette médecine prophétique se rapprochant de la sorcellerie dans sa manière d’aborder les maladies occultes telles la possession.
L’élément surnaturel justifiait donc la présence du long-métrage dans la prestigieuse manifestation vosgienne, même si les autres facettes (thriller, drame social) étaient tout autant présentes.
Invité sur la grande scène de l’Espace Lac avec deux de ses comédiens, Saïd Belktibia s’était exécuté de bonnes grâces, promettant au public son lot d’émotions fortes. La suite allait lui donner raison, le film ne donnant pas une seconde de répit au spectateur sur sa durée (90 minutes). Après une courte introduction à base d’extraits de films et documentaires tirés de l’Histoire nous expliquant l’évolution de la sorcellerie et sa perception à travers les âges, nous rencontrons l’héroïne, Nour, interprétée par la toujours très juste Golshifteh Farahani.

Nour vit de contrebande d’animaux exotiques. Elle parcourt le monde à leur recherche et les revend autour de chez elle, dans les banlieues de Paris, à des rebouteux pratiquant la roqya. Très populaires, ces guérisseurs supposés ont en effet besoin d’ingrédients, plantes et animaux en tout genre afin de fabriquer leur remèdes miracle. Et ceux-ci ne peuvent pas être achetés au coin de la rue. C’est donc là que Nour intervient. Au moment où nous faisons sa connaissance, sa petite affaire prend de l’envergure.
Embringuée dans une séparation douloureuse, Nour jongle entre son activité prenante, en plein essor (elle est d’ailleurs sur le point de mettre en ligne son site internet, suite au succès de son petit commerce) et la garde de son fils, au cœur d’un conflit avec un père de plus en plus pressant (interprété par Jérémy Ferrari). Le début du film nous présente Nour comme une femme pleine de ressources, très énergique, dont on ne sait si elle est juste une banale arnaqueuse, ou si elle possède réellement un don de guérisseuse.

La démarche du réalisateur est directe et efficace : en quelques scènes il a fait le portrait de cette mère courageuse et de sa vie compliquée. Habitant une barre de banlieue parisienne, Nour n’a pas beaucoup de moyens, bricole beaucoup, se débrouille et est à l’orée de l’expansion de son business. Attachante, elle espère que ce site internet lui permettra de prendre une autre dimension. Nour a du cœur, elle aura l’occasion de le prouver.
Mais suite au décès d’un gamin perturbé qu’elle suivait, elle va se voir pourchassée par toute une meute de la cité où elle habite. Pire, les réseaux sociaux qui jusque là la portaient aux nues et avaient contribué à l’essor de son commerce, font subitement marche arrière, devenant le vecteur de l’ire populaire, en participant en temps réel à une véritable chasse aux sorcières. Après avoir bien pris le temps de caractériser ses personnages (l’héroïne, son ex mari, ses voisins, tous ont droit à une attention particulière), le metteur en scène enchaîne sur une cavale très réaliste. Que ce soit à travers les couloirs ou les caves de ces grands immeubles de banlieue ou dans les rues à la nuit tombée, Saïd Belktibia nous fait partager la fuite de son héroïne, qui a enfin compris le côté dangereux de son petit commerce. Mais peut-être une peu tard…
Dans sa dernière partie, Roqya embrasse pleinement l’aspecte fantastique de son histoire. Nour décide de mettre en pratique ce qu’elle a étudié de la roqya pour se défaire de ses poursuivants en quête d’un bon lynchage. Elle utilisera au passage des méthodes radicales que les amateurs d’hémoglobine apprécieront (cf. son utilisation de la pompe à vide). Roqya est un film intéressant à bien des égards. Abordant la religion, la situation des banlieues et le surnaturel, il nous bringuebale aux côtés de son attachante héroïne dans une frénésie d’action qui ne se calme qu’aux toutes dernières images, nous montrant Nour et Amin sur un bateau, prêts à démarrer une nouvelle vie…
Jérôme Magne