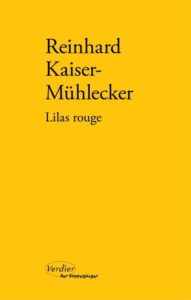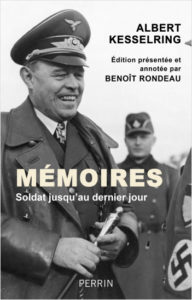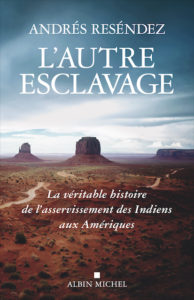
Le 15 mars 2021, Deb Haaland devenait la première amérindienne
secrétaire à l’Intérieur d’un gouvernement fédéral des Etats-Unis.
Près de 150 ans plus tôt, l’un de ses prédécesseurs, James Harlan,
s’élevait contre la réduction en esclavage des Indiens du Nouveau-
Mexique, dénonçant une pratique que beaucoup jugeait normale et
ancestrale.
Pendant longtemps, l’esclavage des Indiens est passé au second plan,
écrasé par celui des Africains puis des Afro-américains. Pourtant
interdit par la couronne espagnole depuis 1542, il a perduré sous
des formes insidieuses, maquillé juridiquement et ignoré de tous car
il servait les intérêts politiques, économiques et religieux de tous.
C’est ce que révèle le livre absolument magistral d’Andrés Reséndez,
professeur à l’université de Yale et de Californie-Davis. En
s’appuyant sur une abondante documentation recensant
d’innombrables faits aux quatre coins des Etats-Unis, l’auteur
examine avec une objectivité stupéfiante ce phénomène qui a
concerné entre 2,5 et 5 millions de personnes, pour la plupart des
femmes et des enfants, employés et rééduqués. Couvrant plusieurs
siècles de pratiques, il expose aussi bien les arguties juridiques et
religieux – comme ceux de Mormons de l’Utah utilisant l’esclavage
pour permettre la rédemption des Indiens – servant à justifier de
telles pratiques, que la collaboration de tribus indiennes afin
d’alimenter ce système qualifié par l’auteur « d’angle mort » de
l’histoire américaine.
Parmi les dispositifs qui permirent à cet autre esclavage de subsister
figure la pratique du péonage, version moderne du servage qui
permettait aux propriétaires terriens de s’assurer une main d’œuvre
gratuite notamment parmi les Indiens capturés. Exclus du 13e
amendement consacrant l’abolition de l’esclavage, les Indiens durent
ainsi attendre le Peonage Act de 1867 pour voir leur condition
évoluer. Cependant, il ne régla rien car dans le même temps, comme
le rappelle Andrés Reséndez, « la politique de déportation du
gouvernement fédéral offrit aux trafiquants d’esclaves indiens de
formidables occasions d’exercer leur métier ». Une véritable économie
parallèle se mit ainsi en place, permettant à des régions entières
comme la Californie par exemple, de connaître une expansion
économique. Et l’émancipation des Afro-américains conduisit
malheureusement à reléguer dans l’ombre le sort des premiers habitants des Etats-Unis malgré quelques voix comme celle du
célèbre sénateur Charles Sumner.
Ce livre marque ainsi une étape cruciale dans la compréhension
complexe des phénomènes d’esclavage dans le Nouveau Monde et
en particulier aux Etats-Unis. Il révèle également, sans concessions,
la construction schizophrénique d’une nation, défenseuse à la fois de la liberté et de l’oppression, et où la soif d’expansion et le
développement d’une puissance se sont appuyés en permanence sur
la violence et le crime. C’est en cela que le livre d’Andrés Reséndez
constitue assurément une petite révolution. Jamais l’adage voulant
que l’histoire rendra justice aux vaincus ou aux oubliés n’a été aussi
vrai qu’ici. Pour cela, il faut des historiens courageux, des chercheurs
de vérité, des lanceurs d’alerte, capables de dire, comme Andrés
Reséndez, ce qui a été mais surtout, ce qui perdure.
Par Laurent Pfaadt
Andrés Reséndez, L’Autre esclavage:
La véritable histoire de l’asservissement des Indiens aux Amériques
Chez Albin Michel, 544 p.