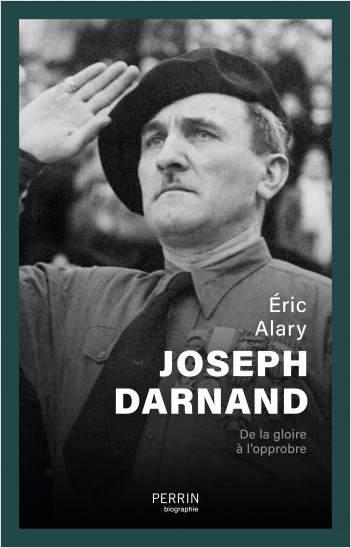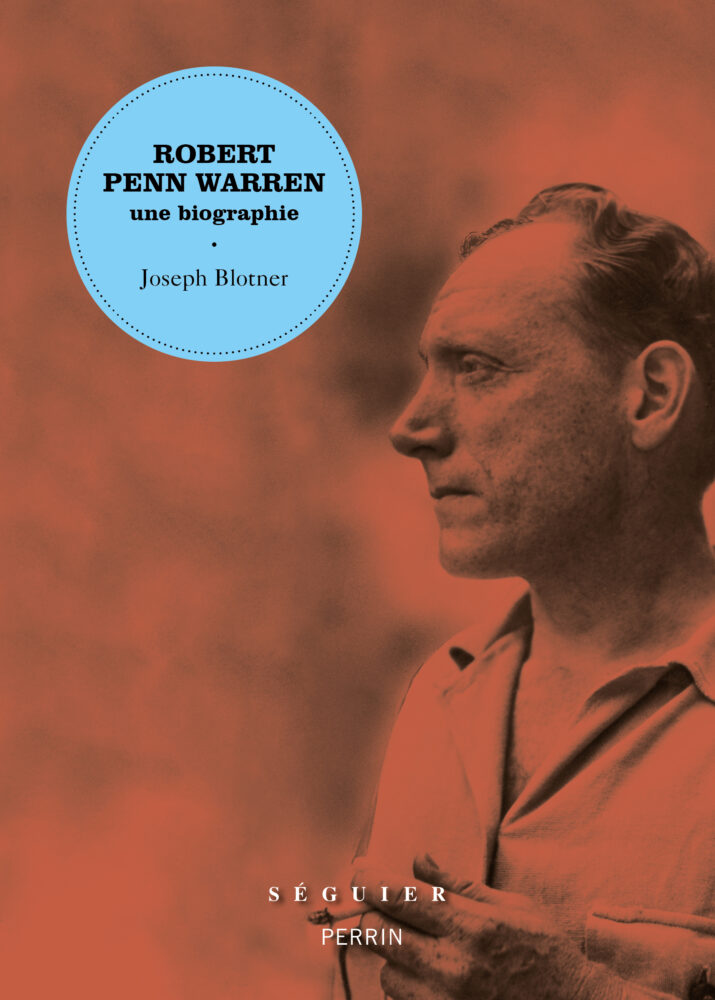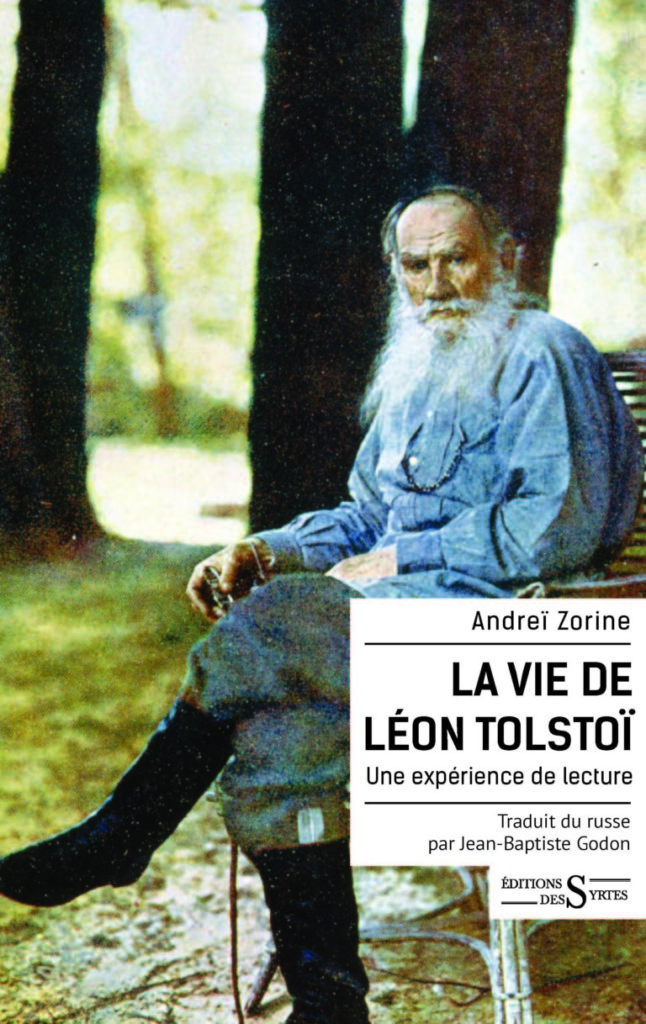Le centre de la Vieille Charité de Marseille consacrait une magnifique exposition à l’artiste algérienne d’art moderne Baya
Rien ne prédisposait cette jeune fille à devenir un peintre renommé enflammant de son art naïf le tout Paris de l’après-guerre. « Son histoire est aussi miraculeuse que les gouaches et les histoires dont elle est l’auteur. Peut-être est-ce aussi chose très naturelle d’écrire des contes lorsqu’on a une destinée sur laquelle semble avoir veillé une fée » écrivait ainsi Edmonde Charles-Roux dans le magazine Vogue en février 1948.

© Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
Baya, de son vrai nom Fatma Haddad, est née en 1931 dans un petit village près d’Alger. Travaillant dans une ferme, elle rencontra là-bas un couple de peintres qui l’accueillit chez lui à Alger et allait décider de son destin. Un patrimoine culturel de l’Algérie façonnant son imaginaire allié à des dons indéniables pour la sculpture et la peinture comme en témoignent ses premiers dessins exposés, libérèrent son immense talent artistique. Elle n’a que treize ans mais ses femmes, ses formes sont déjà là. Révélée à seize ans par le galeriste Aimé Maeght, subjugué par cette jeune artiste, qui lui organisa en novembre 1947 sa première exposition personnelle, Baya suscita immédiatement l’admiration d’un Picasso certainement sensible à sa Femme allongée au vase (1949), de Mirò et de Camus, le futur prix Nobel disant même après l’avoir rencontré que « dans ce Paris noir et apeuré, c’est une joie des yeux et du cœur. J’ai admiré aussi la dignité de son maintien au milieu de la foule des vernissages: c’était la princesse au milieu des barbares. »
Parmi les 150 œuvres présentées, nombreuses sont demeurées jusqu’à aujourd’hui inédites car retrouvées en 2023. L’art de Baya oscille ainsi entre un art brut visible sur la monumentale Grande frise (1949) du musée Reattu d’Arles, un art naïf et une forme de surréalisme. Les gouaches présentées diffusent ainsi ses couleurs chatoyantes et dessinent une incroyable magie notamment dans Deux femmes (1947). Les personnages semblent danser sous nos yeux (Musicienne aux oiseaux, grappe et fleurs, 1998). Les drapés mêlent à la fois une dimension orientale, maghrébine tirée des cultures algériennes tant arabe que berbère mais également une touche picturale comme sortie de la Renaissance italienne.
Restée fidèle à ses idées et à son intuition malgré sa fascination pour Matisse, son art évolua au fil du temps et des vicissitudes de sa vie et de son pays. La musique pénétra ainsi son art, les instruments devenant les personnages d’une peinture épousant en quelque sorte une mélopée picturale comme dans le très beau Femme aux instruments de musique (après 1966, collection particulière) tandis qu’elle-même épousait le chef d’un orchestre arabo-andalous. Mais c’est au milieu des années 70 que l’art de Baya trouva sa pleine maturité avec des œuvres empruntes d’une harmonie proprement déconcertante qui confinent presque à de l’abstraction avant que ce même art n’accède enfin, au début des années 80, à une reconnaissance internationale amplement méritée.
En la voyant peindre sur le film qui clôt l’exposition, on se dit que le peintre enfant pour reprendre l’expression d’Edmonde Charles-Roux dans son article de 1948 ne partit jamais et nourrit un art qui plongea le visiteur dans une sorte de conte enchanteur, ces mêmes contes qu’elle racontait à sa mère adoptive à la manière d’une Shéhérazade. Pas de doute, Baya fut bel et bien une princesse de l’art.
Par Laurent Pfaadt