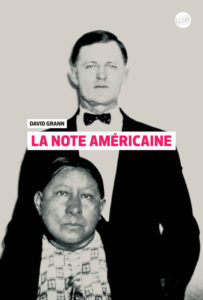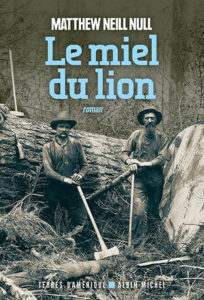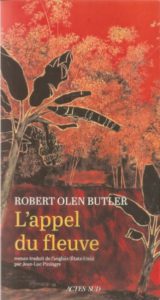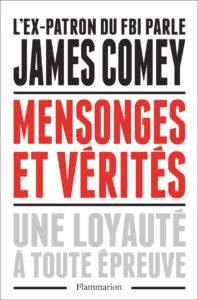C’est en 2005 que
Jürgen A.Messmer
fonde la galerie du
même nom en
mémoire de sa fille
Petra trop tôt
disparue. La
première
exposition rendait hommage au peintre et dessinateur suisse André Evard en
l’honneur duquel un prix international décerné à de jeunes
artistes a été créé.
La galerie Messmer qui a présenté de nombreux artistes tels
George Braque, Pablo Picasso, Salvador Dali, Raoul Dufy,
Victor Vasarely et bien d’autres grands noms, renoue cet été
avec la prédilection affichée de Jürgen A.Messmer pour les
œuvres d’André Evard.
Né en 1876 à Renan dans le Jura suisse, l’artiste part vivre à
la Chaux-de-Fonds puis s’installe à Paris de 1923 à 1927 où il
côtoie George Braque, Théo van Doesburg, Robert Delaunay
au Salon d’Automne ou à celui des Indépendants.
Très vite, on le considère comme un peintre d’avant-garde et
son style influencé par le pointillisme et l’expressionnisme lui
donne une place toute particulière entre cubisme et
constructivisme. Car André Evard n’a cessé d’osciller entre
l’art abstrait et l’art figuratif et de mélanger les genres pour
développer un style singulier, identifiable entre tous.
Inspiré par la nature, d’où le titre de l’exposition « Farben der
Natur » (Couleurs de la nature), André Evard a peint moult
natures mortes et paysages pour se tourner définitivement
vers une vision panthéiste et figurative de la nature. Les
œuvres accrochées à la galerie en témoignent, les couchers
de soleil embrasent l’horizon jusqu’à le transcender, les
nuages s’étirent, flamboient dans le bleu ou le rose, les
arbres en fleurs font vibrer la toile…
C’est une nature débordante de vie que le peintre nous
octroie dans une profusion de couleurs vives parfois insolites
mais qui expriment toujours la quête de la lumière pure. Ces
couleurs prégnantes où dansent le rouge, le bleu, le jaune, le
rose nous en mettent plein les yeux pour nous inviter à
entrer dans les tableaux de l’artiste jusqu’à nous immerger
dans un bain de lumière qui a partie liée avec notre cosmicité
et notre part d’éternité. André Evard possède le don de nous
restituer le rythme du monde car comme nous le rappelait
Bachelard « L’Art est l’écoute de notre voix intérieure », cette
voix, le peintre la porte jusqu’aux marges de l’infini où elle
entre en résonance avec la nôtre dans une parfaite harmonie
avec le temps qui nous traverse, nous fait et nous défait.
Françoise Urban-Menninger
Galerie Messmer à Riegel dans le Kaiserstuhl
Jusqu’au 9 Septembre 2018