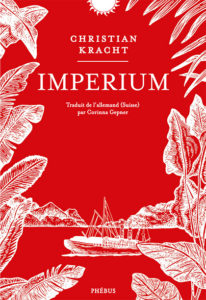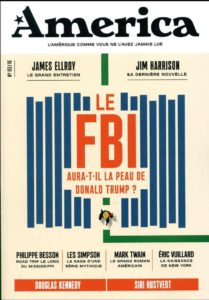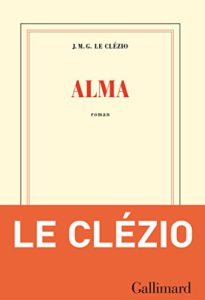Plusieurs romans
Plusieurs romans
rappellent que la
guerre reste une
source inépuisable
d’inspiration
Les plus grandes
tragédies donnent
souvent naissance
à des romans
immortels et les guerres ne font pas exception à cette règle. Il n’y a
qu’à lire Orages d’acier d’Ernst Jünger, les Nus et les Morts de
Norman Mailer ou Vie et Destin de Vassili Grossman pour s’en
convaincre. Des écrivains sont nés au contact du feu. Ils ont
ramené avec eux des brûlures qui consumèrent leurs consciences,
leurs âmes. Certains excellèrent à dépeindre le quotidien des
hommes projetés dans le brasier de la guerre, et à se faire le
porte-parole de ces êtres ordinaires confrontés à des situations
extraordinaires, de ces pères de famille, ces maris qui ne
s’attendaient pas à devoir défier l’Histoire.
Et de Stalingrad aux montagnes d’Afghanistan, l’automne littéraire
a été, de ce point de vue, riche en découvertes. Il y eut d’abord
l’extraordinaire roman d’Heinrich Gerlach, Eclairs lointains dont la
qualité tient autant de son contenu que de son périple. Gerlach fut
un officier de Wehrmacht au sein de cette VIe armée commandée
par le maréchal Paulus qui se retrouva encerclée à Stalingrad.
Auprès de ses hommes, Gerlach dépeint à merveille cette
idéologie qui lentement se mue en résignation, cette survie que
l’on tire de l’adoration du Führer et surtout l’inutilité d’une tâche,
d’une quête que l’on sait perdue et qui, pourtant, paradoxalement,
vous permet de rester en vie. Stalingrad comme d’autres batailles
fut un immense piège, aussi bien stratégique que moral et qui,
lentement, se referma sur ceux qui menèrent et subirent cette
bataille. En lisant ces pages pleines de boue, de glace, de larmes et
de sang, on a parfois l’impression de se contempler dans le miroir
de Vie et destin de Vassili Grossman. On se dit que Gerlach est là,
qu’il n’est qu’un figurant dans les scènes d’état-major de la
Wehrmacht de l’écrivain russe, qu’il n’est qu’une ombre dans ces
colonnes de prisonniers qui marchent vers leurs funestes destins.
Mais Gerlach eut la chance de survivre et d’être libéré. Et il en tira
Eclairs lointains.
Le roman est une nouvelle preuve que l’on écrit non pas pour soi
mais pour l’humanité. Sorte de testament destiné à ressurgir,
l’odyssée d’un homme devient alors celle d’un livre, preuve que les
grandes œuvres, les grands livres dépassent toujours leurs
créateurs. Une fois de plus, la destinée d’Eclairs lointains ressemble
à celle de Vie et Destin. L’ouvrage de Grossman, confisqué par le
KGB en 1961 dormit sur une étagère poussiéreuse de la
Loubianka pendant plus de vingt ans, non loin certainement de ces
Eclairs lointains. Car confisqué en 1949, Gerlach avait publié son
récit après sa libération en reconstituant ses souvenirs avant que
le manuscrit original de cette épopée ne nous parvienne au début
des années 2010, près de vingt ans après la mort de son auteur.
Ces « bombes de nos ennemis » telles que les appelaient Mikhaïl
Souslov, le n°2 du régime soviétique, ont fini par exploser et leurs
éclairs lointains retentirent et retentissent encore sur l’ensemble
de la planète notamment dans cet Afghanistan qui tient lieu de
décor au grand roman du danois Carsten Jensen.
Une idéologie a succédé à une autre mais la matrice reste la même : quels effets produisent la guerre sur les hommes qui la mènent et
la subissent ? A cette question Carsten Jensen, dans ce roman
magistral qui devrait être adapté au cinéma y répond à travers un
prisme littéraire composé des différents visages et personnages
de cette brigade danoise envoyée dans la province du Helmand en
Afghanistan pour y défendre la liberté. Mais quelle liberté ? Celle
de cet Occident qui fait la guerre et se compromet ? Peut-être. En
tout cas, au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans ce livre comme
dans une grotte obscure de ces montagnes immortelles en
compagnie de Schroder, d’Hannah, d’Andreas ou Ove, nos
conceptions du bien et du mal vacillent, s’altèrent en même temps
que la psychologie de nos héros. La guerre est un immense chaos,
physique et mental. Comme chez Gerlach, il absorbe les plus
courageux, les idéalistes et les salauds. A l’image de Schroder, elle
débarrasse les hommes de leur morale, de leurs valeurs, elle les
dévêtit de leur manteau civilisationnel, de leurs idéaux. Mais
comment pourrait-il en être autrement lorsqu’à soixante-dix ans
d’intervalle l’officier de la Wehrmacht dont on refuse la reddition
et le soldat danois qui se fait bombarder par ses alliés américains
s’interrogent sur le bien-fondé de leurs missions ?
Et quand la violence se fait habitude, elle devient drogue. Devenu
accros, les soldats se l’inoculent soit pour survivre face à cette
Histoire qui les broie, soit pour en jouir comme Schroder,
étonnant sosie danois du Kurtz de Conrad. Une fois de plus
l’ombre de Grossman n’est pas loin. Alors la trahison devient un
jeu, le massacre un passe-temps. Et c’est ce jeu que le lecteur est
invité à suivre dans ce roman. C’est peut-être ce qui rend
fascinant les romans de guerre car ils installent le lecteur à la
place de Dieu, contemplant ces créatures pathétiques et en même
temps touchantes. Car finalement peu importe l’époque, à
Stalingrad ou dans cette province afghane, les romans de guerre
révèlent les hommes dans leur plus simple nudité. Hier et
aujourd’hui, Gerlach et Jensen l’ont parfaitement compris.
Laurent Pfaadt
Heinrich Gerlach, Eclairs lointains, Percée à Stalingrad,
Anne Carrière, 633p. 2017
Carsten Jensen, La première pierre,
Phébus, 764p. 2017