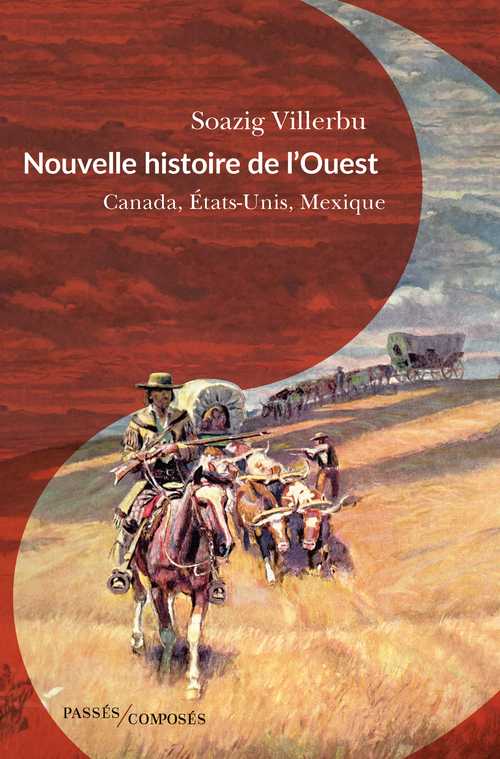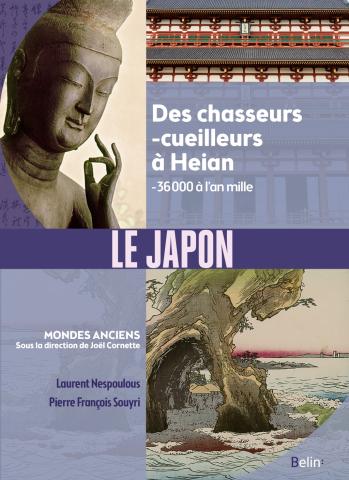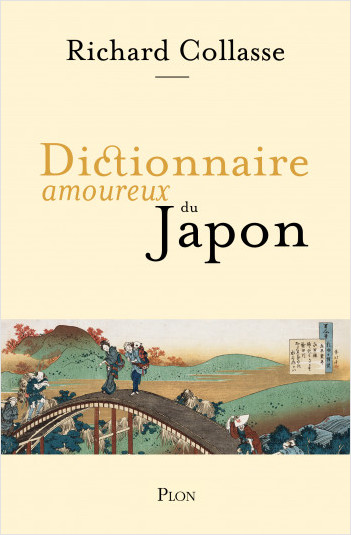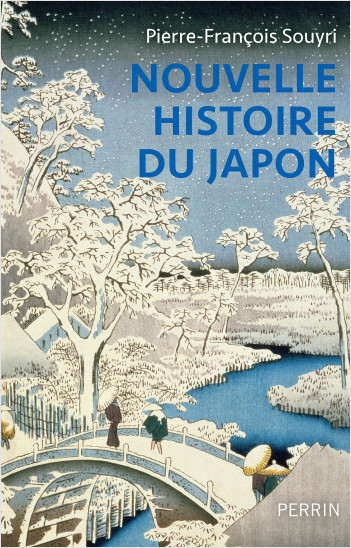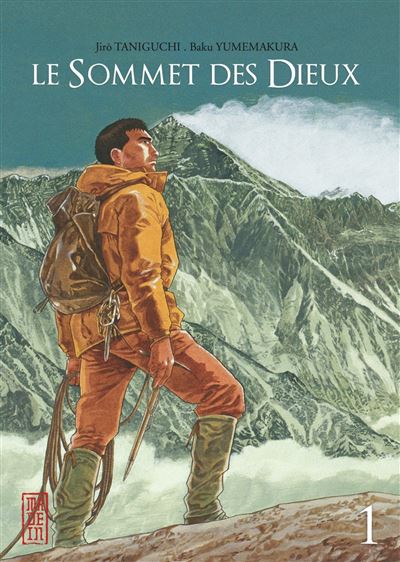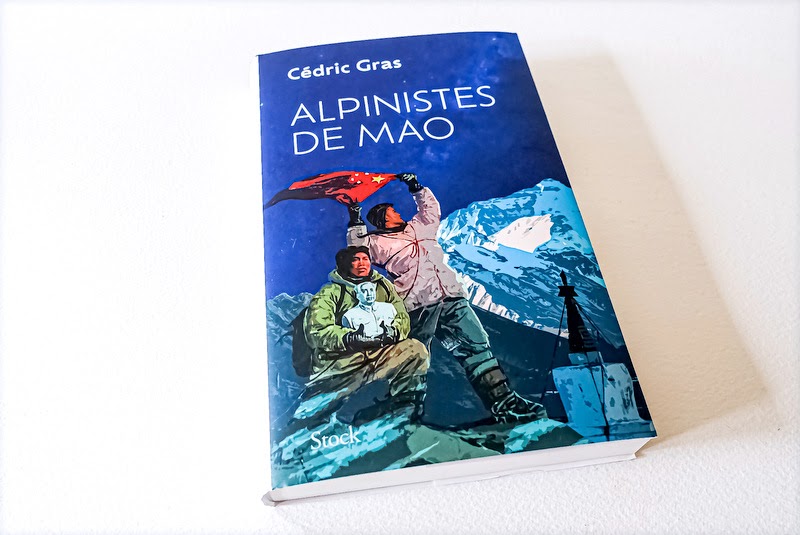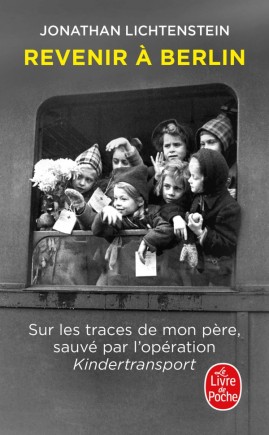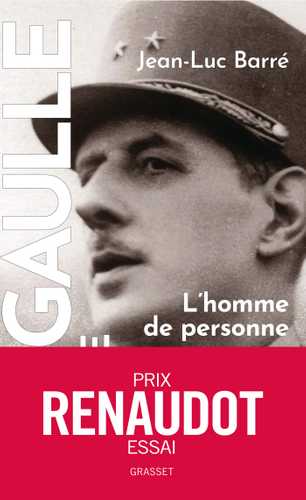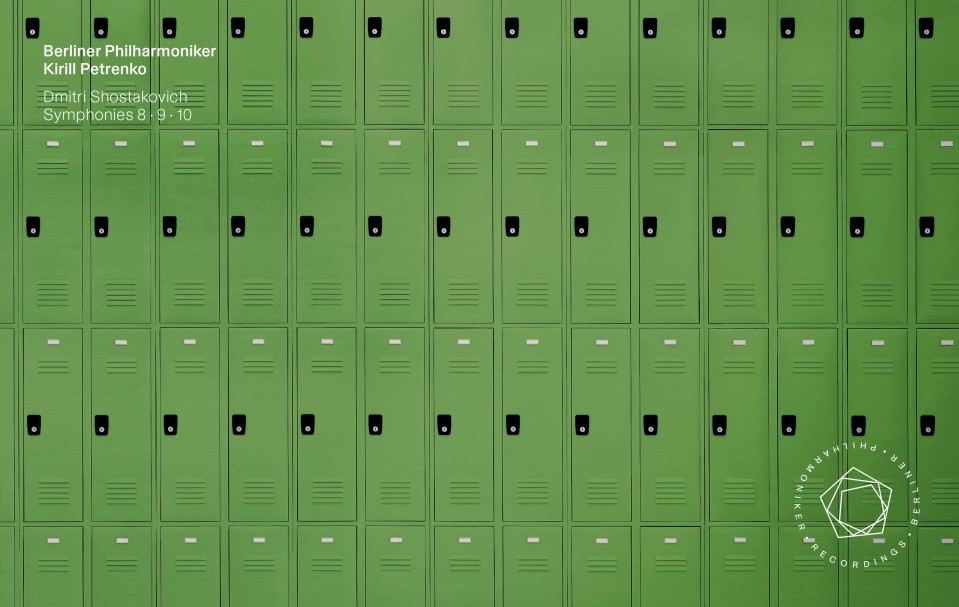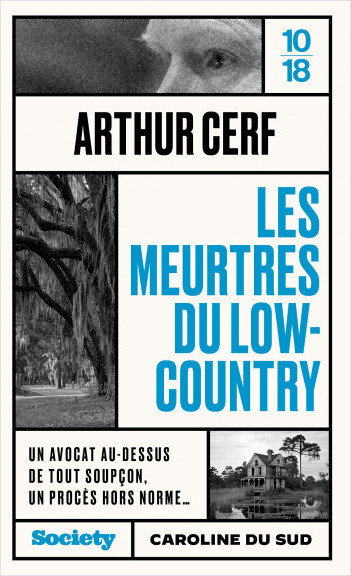Il y a 750 ans disparaissait Rûmi, l’un des grands maîtres du soufisme
La foule a dû être particulièrement nombreuse ces jours-ci à Konya. C’est dans cette ville du sud de la Turquie qu’est mort, il y a 750 ans, le 17 décembre 1273, Jalal ud Din Rûmi, principal représentant de l’un des grands courants de l’Islam, le soufisme. Une ville qui vit passer le pharaon Ramses ainsi que l’apôtre Paul et qui, selon Éva de Vitray-Meyerovitch (1909-1999), première femme à enseigner la philosophie comparée à l’université Al-Azhar du Caire dans les années 1950 et traductrice en français du Mathnawi de Rûmi, demeure « un de ces hauts lieux qui semblent voués depuis la nuit des temps à un extraordinaire destin ». Aujourd’hui alors que l’attention du monde occidental, par méconnaissance ou à des fins politiciennes, se focalise sur les courants fondamentalistes de l’Islam, notamment le wahhabisme et le salafisme, le soufisme mérite d’être mieux connu et apprécié.

Le soufisme tire son nom sans certitude d’ Ahl al-soufa, « les gens du banc » en référence à ceux qui vivaient dans la mosquée du Prophète à Médine et s’il n’a été formalisé qu’en 1766, il se définit comme une voie mystique de l’Islam où l’être, dépouillé de tout égo et à l’âme purifiée face à son créateur, accéderait à l’amour de Dieu par les arts, en particulier la musique et la poésie. Les manifestations les plus connues de ce chemin vers l’amour sont celles des derviches tourneurs, confrérie fondée par Rûmi et pratiquant la sama, cette danse typique, qui furent pendant longtemps des mendiants et des marginaux suscitant la méfiance et le rejet de musulmans plus rigoristes. De plus, les soufis restent persuadés que le Coran possède deux niveaux d’interprétation : celui qu’on lit appelé zahir et celui caché, métaphysique – le batin – vénéré également par les chiites, l’autre grande famille des musulmans avec les sunnites (tenants de la tradition ou sunna). « Si tu ne trouves pas la compagnie d’un homme sage, prends de moi ce qui me vient de mon père et de mes ancêtres. Choisis mon maître Rûmi comme compagnon de route, afin que Dieu t’accorde le désir et la ferveur ; car Rûmi distingue et connaît l’écorce et le noyau » écrivit ainsi Muhammad Iqbal (1877-1938), poète et philosophe soufi considéré comme le père spirituel du Pakistan et dont la pensée popularisée en France par Éva de Vitray-Meyerovitch reparaît aujourd’hui. Tout au long de son histoire, le soufisme fut ainsi formalisé par quelques grands maîtres comme Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111), auteur du célèbre Revivification des sciences religieuses ou Ibn Arabi (1165-1240) et se retrouve dans un certain nombre d’ouvrages notamment le fameux traité du soufisme d’Abu Bakr al-Kalabadhi (+990) et La conférence des Oiseaux de Farid Al-Din Attar (1145-1190/1229)

Malgré un certain nombre d’idées reçues Rûmi n’a pas été le fondateur du soufisme mais l’une de ses figures tutélaires. Né en 1207 dans l’actuel Afghanistan, alors partie de l’empire perse, Rûmi fut le sheikh de la communauté religieuse de Konya, une sorte de maître-éducateur religieux. Sa rencontre avec un derviche errant le poussa vers une forme de mysticisme produisant les premières sohbet (conversations mystiques) qui allaient former une partie de son œuvre conséquente qui comporte également plaisanteries, poèmes allégoriques et extatiques de plus de cinquante mille vers formant le Mathnawî et de nombreux contes regroupés dans le célèbre Mesnevi qui abordent sous la forme de 424 histoires allégoriques de nombreuses questions de la vie qu’elles soient morales ou religieuses. « L’oeuvre de Rûmi est fondamentalement celle d’un poète mystique, musulman et soufi. On pourrait la résumer en une métaphore unique qu’il utilise abondamment, celle du papillon nocturne, attiré inexorablement par la lumière et qui se jette dans la flamme de la chandelle. Cette image signifie l’idéal de la fusion en Dieu dont rêve Rûmi » estime ainsi Jacques Deregnaucourt qui signe la préface de L’essentiel de Rûmi (Almora).
Aujourd’hui Rûmi est considéré comme un saint et le soufisme séduit de nombreux adeptes dans le monde musulman mais également en Europe et aux Etats-Unis où son mysticisme qui accorde une place importante à la méditation offre des réponses à la fois à la quête de sens qui traverse les sociétés européennes et constitue une alternative positive aux courants intégristes de l’Islam.
Par Laurent Pfaadt
Pour découvrir le soufisme et sa philosophie, Hebdoscope vous conseille :
L’essentiel de Rûmi anthologie réalisée par Coleman
Chez Almora éditions, 448 p., qui constitue une bonne introduction
Éva de Vitray-Meyerovitch, Rûmi et le soufisme, collection sagesse
Aux éditions Points, 192 p.
On pourra ensuite poursuivre avec quelques textes fondamentaux comme Le Mesnevi, recueil de contes écrits par Rûmi (Albin Michel), Le traité du soufisme d’Abu Bakr al-Kalabadhi (Actes Sud, Babel) et Le livre de l’Eternité de Muhammad Iqbal (Libretto).