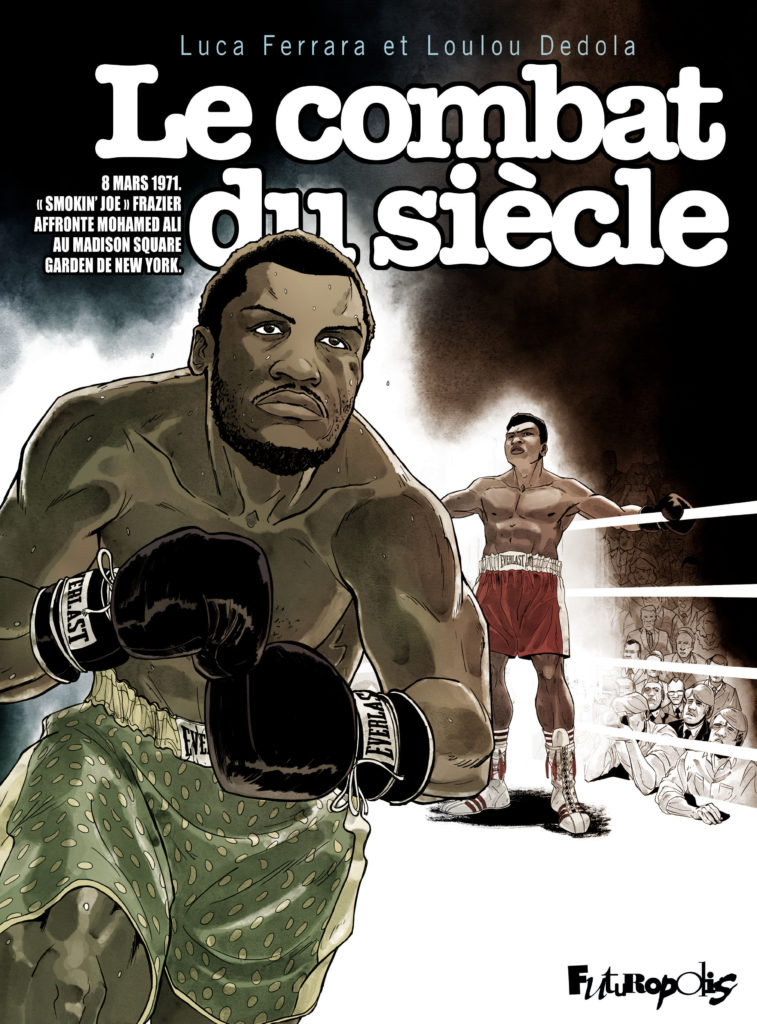Pour trois soirées Le Maillon propose à son public de rejoindre le public allemand à la Reithalle d’Offenburg pour assister à la performance d’un chorégraphe Viktor Cernicky, pour le moins original puisque sa prestation s’opère sur un simple tapis de danse en jouant avec 22 chaises de conférence.

Tenir en haleine les spectateurs pendant 50 minutes avec comme seules partenaires un groupe de chaises est en soi un défi à relever ce que réussit brillamment cet artiste venu de la République tchèque, qui a déjà été remarqué et félicité pour son travail et qui met en corrélation le corps et les objets le situant entre la danse et le cirque.
Grand et mince, vêtu d’un pantalon noir et d’une veste blanche il esquisse des pas de danse martelant le sol en rythme soutenu, évoluant entre un amas de chaises réunies en faisceau et quelques autres disposées ici ou là sur ce plateau nu et blanc fortement éclairé.
Bientôt il s’en saisit et réaliser avec elles d’étonnantes combinaisons.
Nous allons suivre ce travail d’agencement qui consiste à s’emparer de telle ou telle chaise pour venir l’emboiter méticuleusement sur une autre et ce tout en martelant le sol d’un pas de danse au rythme plus ou moins soutenu en accord avec la recherche de la chaise adéquate ou de son placement sur la précédente. Ainsi s’élaborent des figures, de belles compositions dont certaines ne manquent pas de manifester une certaine fragilité ce qui rend notre artiste parfois circonspect, parfois déterminé à poursuivre, d’où ses piétinements plus ou moins nerveux en face de la nouvelle installation qu’il vient de réussir à mettre en place comme s’il voulait la dompter, ce qui ne manque pas de créer suspense et amusement dans le public attentif au moindre de ses gestes pour parfaire son objet.
Ainsi voit-on apparaître des chaises emboîtées formant une longue ligne oblique qui va soudain s’écrouler, puis les voilà assemblées en demi-cercle comme attendant d’être occupées pour écouter un conférencier. Enfin, et c’est le clou du spectacle, voici que le performeur commence à élaborer, toujours allant et venant en martelant le sol, une sorte de pyramide en disposant les chaises qu’il récupère une à une aux quatre coins du plateau les unes au-dessus des autres rendant au fur et à mesure des rajouts l’édifice de plus en plus fragile, son inclinaison laissant présager un écroulement immédiat. Alors, soutenant la colonne qui menace de tomber il ne dispose que d’un déplacement ultra rapide pour s’emparer d’une ultime chaise qu’il réussit à placer précautionneusement au sommet de la construction derrière laquelle il entreprend un jeu d’escalade auquel il renonce sans doute pour ne pas détruire l’équilibre précaire de ce bel édifice qui est comme l’éloge de la persévérance et de la virtuosité.
Un spectacle original et ludique, très apprécié du public.
Marie-Françoise Grislin pour Hebdoscope