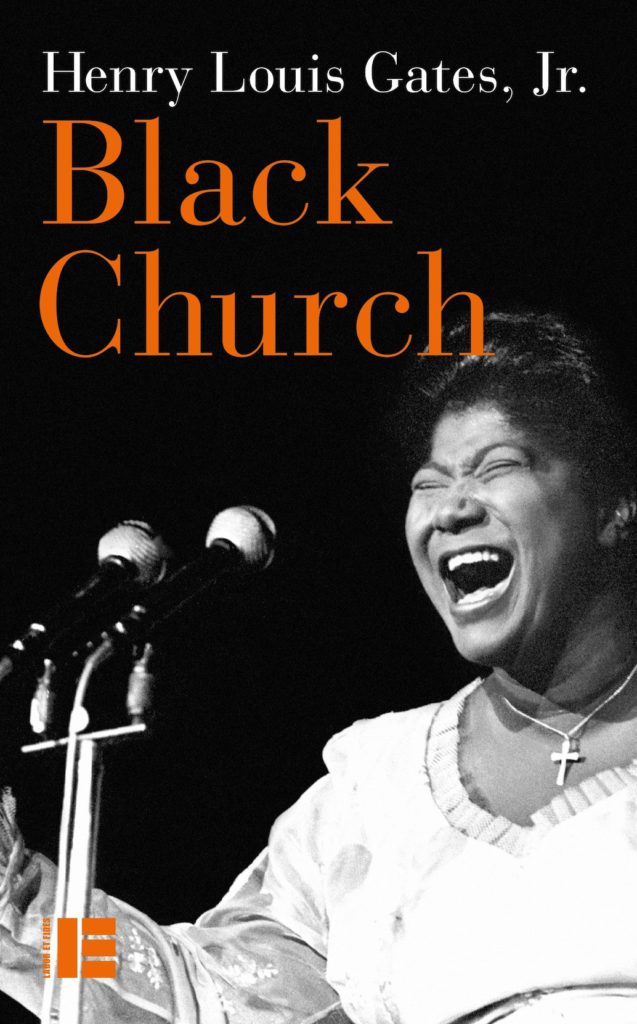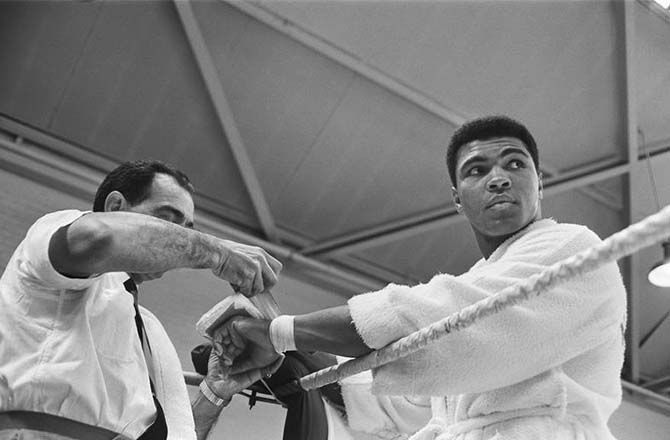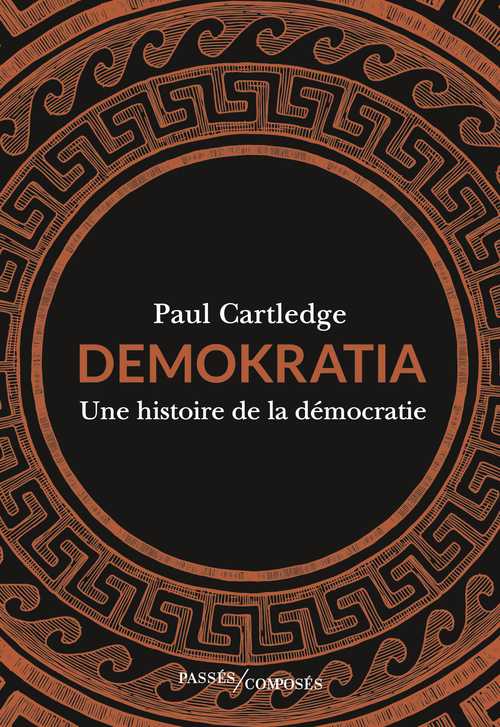François de Riberolles, L’incroyable périple de Magellan, Production ARTE France, Camera Lucida, Minima Films, Belgica Films, Serena Productions, 2 DVD, Arte éditions

« Une idée animée par le génie et portée par la passion » disait l’écrivain autrichien Stefan Zweig à propos de Magellan, dans son admirable biographie parue en 1938. Mais que sait-on au juste du navigateur portugais Fernand de Magellan qui réussit là où Christophe Colomb échoua ? Qu’il rejoignit les Indes par l’ouest en traversant la mer océane. Comme le rappelle le réalisateur de cette magnifique série documentaire, François de Riberolles, « on connait tous le nom de Magellan mais ses exploits sont tombés dans l’oubli car Magellan est un héros maudit ». En somme, un navigateur ayant effectué la première circumnavigation, c’est-à-dire le premier tour du monde sur mer qu’il n’acheva pourtant pas, tué par des indigènes quelque part en Asie. Voilà donc à quoi se résume l’aventure hors du commun de Magellan.
C’est dire tout l’intérêt de cette série documentaire basée sur le récit d’un compagnon de l’expédition, l’italien Antonio Pigafetta, qui plonge sous la surface non pas de l’océan mais de l’histoire officielle pour évoquer toute la complexité de l’expédition du navigateur portugais. Partir à la découverte d’une aventure trop souvent réduite à quelques éléments en compagnie des 237 marins formant cette tour de Babel sur mer (il y eut quelques français) et qui embarquèrent sur les cinq navires de l’expédition a quelque chose d’excitant surtout quand elle est portée par un rythme si prenant. Oscillant entre le film d’animation qui permet magnifiquement d’installer les protagonistes de cette histoire et en donne une dimension presque littéraire, le récit d’aventures mêlant expéditions maritime et anthropologique et l’apport d’historiens, de voyageurs et d’écrivains venus du monde entier et permettant d’explorer toutes les dimensions de cet incroyable périple, le documentaire ne s’octroie aucun temps mort et ne laisse ainsi aucun répit au spectateur. Et même lorsque la mer est étale, il se passe toujours quelque chose à bord de la Victoria, de la Trinidad et des autres bateaux.
Pour comprendre les dessous de l’expédition de Magellan, la série suit deux voies : celle de Magellan lui-même, navigateur portugais entré au service du roi d’Espagne, Charles Quint. Et celle de sa quête, l’ouverture par l’ouest d’une route vers l’île des Moluques, seule productrice à l’époque des girofliers et de ses fameux clous de girofle dont les vertus médicinales et gastronomiques étaient connues depuis l’Antiquité et valaient à cette épice une valeur supérieure à l’or.
De ces deux thématiques découlent tout le reste que la série exploite à merveille : les considérations géopolitiques d’une Espagne engageant un « traître » pour tenter de régner sur un monde divisé depuis le traité de Tordesillas (1494) entre Portugais et Espagnols, mais également l’évolution psychologique d’un homme devant en permanence réaffirmer sa légitimité durant ce voyage qui dura près de trois ans. La découverte enfin de terres et de peuples inconnus jusque-là par un marin doté d’une intuition géniale – notamment lors du franchissement du détroit qui allait porter son nom – et des hommes écrivant, à grands coups de courage et d’exploits quotidiens, l’histoire de l’humanité dans laquelle ils sont entrés de leur vivant ou en y laissant leur vie. « C’est sans doute l’expédition la plus significative de l’histoire de l’humanité » estime ainsi Felipe Garcia-Huidobro Correa, contre-amiral chilien et acteur de cette série documentaire appelée à rester dans les mémoires de tous ceux qui, de 7 à 77 ans, ont rêvé et rêvent toujours d’horizons lointains.
Par Laurent Pfaadt