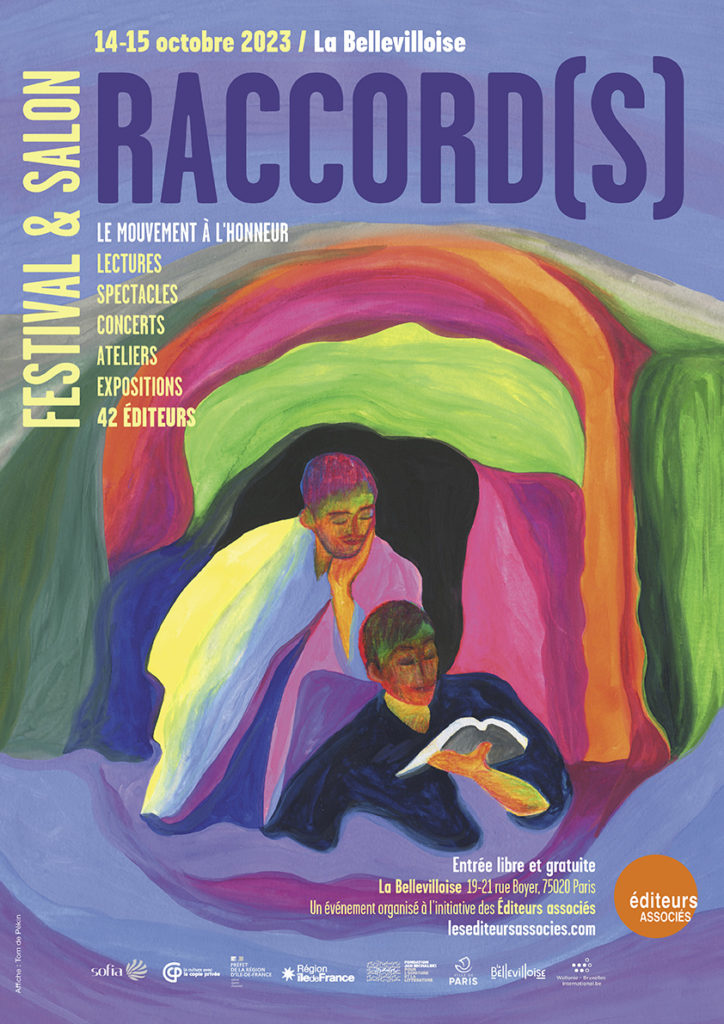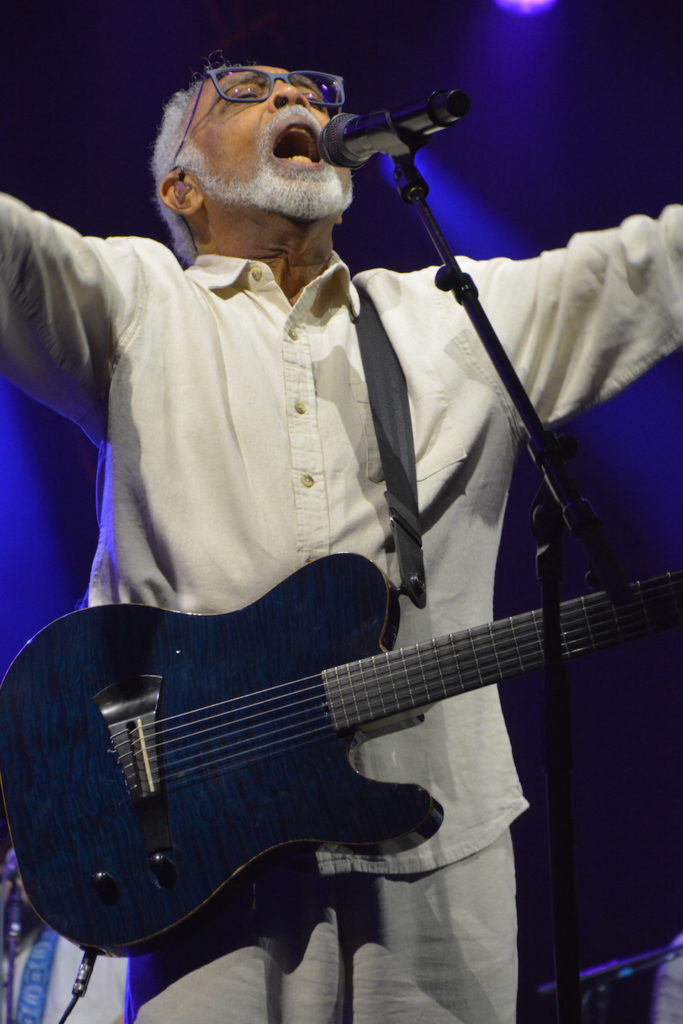Parcourir Musica, c’est prendre le temps de s’arrêter sur quelques grands moments qui témoignent de la richesse et de la diversité d’une programmation prolixe en propositions.
L’entrée dans le Festival en témoigne avec les prestations de l’Ensemble néerlandais Arko-Shoenberg qui a présenté dans une première partie « Les Vespers for a New Dark Age » de Missy Mazzoli avec trois magnifiques chanteuses, trois sopranos qui nous entraînent dans ce parcours aux accents pleins de spiritualité auxquels elles confèrent beaucoup de sensibilité alternant à l’instar des instruments qui les accompagnent, l’alto, la contrebasse, les claviers et la batterie la puissance et la finesse de la partition musicale.

La deuxième partie de la soirée offre de Louis Andriessen une oeuvre très originale « Hoketus » composée en1976 pour deux ensembles de cinq musiciens, aux claviers, bongos, saxo, flûtes de Pan qui se livrent à une sorte de jeu de répétition, comme de rivalité, une battle, en produisant des sons de plus en plus forts et martelés , obligeant l’autre groupe à les imiter sans vergogne. Un moment musical performatif et spectaculaire. Avant une troisième partie qui ne le sera pas moins avec ce « Clipping » qui a donné son nom au spectacle et nous met en demeure de suivre la prestation d’un chanteur dont le débit de paroles est époustouflant, véritable MC(Maître de cérémonie) Daveed Diggs galvanise le public soutenu dans cette performance par les musiciens William Hutson et Jonathan Snipes qui lancent depuis leur table de mixage les sons électroniques qui impulsent les acclamations du public et lui procurent une irrésistible envie de danser.
La Laiterie était comme en fête lors de cette ouverture du Festival dans cette chaude ambiance où l’enthousiasme de tous était manifeste.
C’est lors du concert « Nightmare » au Temple Neuf que nous rencontrons pour la première fois à Musica le compositeur américain Ted Hearne avec »Nobody » programmé par le collectif lovemusic basé à Strasbourg qui a choisi d’interpréter également les compositions de l’islandaise Bàra Gisladottir, « Rage against reply guy », de Natacha Diels »Second nightmare for KIKU »,de Christopher Cerrone »The Night Mare », de Andreas Eduardo Frank « Munster » et d’Helmut Oering »Inferno ». Pour ces jeunes compositeurs, mis à part Oering, lus âgé, les titres de leur composition en disent long sur leur implication dans ce projet de mettre en musique une certaine idée du cauchemar., d’ailleurs leur composition respective n’ont pas manqué de nous faire vivre des instants de sons frénétiques suivis de grande respiration puis de reprises de thèmes enregistrés. Musique théâtralisée aussi avec voix enregistrées où la gestuelle prend sa place tout comme les cris et vociférations. Concert où les interprètes de l’ensemble lovemusic ont montré la pleine mesure de leur talent, et de leur virtuosité.
C’est dimanche que nous avions rendez-vous à L’Opéra du Rhin pour la création de « Don Giovanni aux enfers », spectacle d’une grande originalité autant dans son propos que dans sa réalisation. En effet le compositeur, metteur en scène et vidéaste danois Simon Steen-Andersen a répondu à une commande de l’Opéra national du Rhin et du Festival Musica en s’attaquant au grand mythe de Don Juan tout en inscrivant l’histoire du célèbre personnage dans le temps, pour nous inconnu, de son séjour aux enfers après son non moins célèbre diner avec le commandeur et son refus de se repentir. Son périple dans les enfers va donner lieu à une cascade d’aventures où on le suivra grâce à la vidéo, déambulant dans les couloirs de l’Opéra e jusque dans les sous-sols du bâtiment. Où est Don Juan se demande-t-on par moments ? Précédé, guidé, entraîné par un personnage maléfique ce Polystophélés créé par l’auteur, avatar du bien connu Méphisto, Don Juan doit faire face à toutes sortes de situations et de rencontres qui s’avèrent être de nombreux personnages figurant dans des œuvres opératiques ou littéraires. Le scénario se met ainsi en place par références, collages et montage, parfois surprenants, déroutants, proches de la dérision. Et pour faire advenir tout cela la scénographie se doit d’être à la hauteur. L’on voit donc surgir des installations, de petits praticables mobiles introduisant saynètes et protagonistes tandis qu’autour se rassemblent les témoins, choristes grimés, affublés de tenues grotesques, sortes de pantins, mais, avant tout, chanteurs du chœur de l’Opéra, pleins d’allant et de complicité pour accompagner ces situations farfelues. (Chef de chœur Henrik Haas).
A l’instar des personnages empruntés à différentes œuvres, la musique est aussi faite de citations habilement juxtaposées ou mises en perspective et savamment agencées.
L’orchestre philarmonique de Strasbourg sous la direction du jeune chef polonais Bassem Akiki se plie avec bonheur aux injonctions de ce collage fantasque et drôle comme le fait également dans son intervention l’ensemble Ictus.
Les chanteurs ont le grand mérite d’endosser plusieurs rôles, ainsi la soprano Sandrine Buendia l sera entre autres, une Ombre, Francesca …Ja mezzo -soprano Julia Deit –Ferrand sera Dona Elvira Eurydice… le ténor François Rougier sera Dante, Faust… le baryton Christophe Gay est Don Giovanni, Orphée …Damien Pass fait le commandeur et Polystophélès. et Geoffroy, Buffiere Leporello Charon.. tous de s’y impliquant résolument.
Une œuvre foisonnante qu’on taxera de déroutante et audacieuse comme Musica aime à en susciter la création.
Ce même dimanche un concert d’un tout autre genre nous attendait à l’Espace Django. Intitulé La musique au pied du mur » c’est une rencontre avec des musicien-nes et danseur-ses venus de Palestine à l’initiative d’un fidèle de Musica, Alain Harster, dans le cadre des concerts programmés par le public. Fidèle ami et soutien de ce peuple colonisé lui qui se rend depuis 20 ans dans le camp de réfugiés dAida à Bethléem tenait à donner à ces jeunes gens la possibilité de faire ce voyage, une opportunité pour eux de sortir du camp où ils sont enfermés et d’exprimer leurs talents de musiciens, de chanteurs et de danseurs.
Ce fut une rencontre très chaleureuse avec un public acquis de longue date à la cause palestinienne et qui a incontestablement été conquis par leurs prestations.
La première partie était assurée par le groupe In’EKass composé de musiciens-nes et d’une magnifique chanteuse animée d’une grande ferveur dans son récital de chansons engagées dont l’une, nous explique la joueuse d’oud Rwaida, s’appelle « La balle » et traduit l’émotion de ceux qui voient mourir un des leurs au cours de ce conflit causé par l’occupation de la Palestine par Israël.
La deuxième partie de la soirée était consacrée à la danse, au DABKEH, une danse folklorique très pratiquée en Palestine, ici exécutée avec virtuosité et enthousiasme par les danseur-ses de l’Association Alrowwad, superbes et fiers dans leurs superbes costumes blancs qui donnent toute leur prestance et la grâce à leurs envolées sur scène.
Une soirée témoignage pour admirer et soutenir ces jeunes artistes brillants et déterminés à vivre malgré les murs dressés autour d’eux.
Cette première période du Festival a été très suivie et très appréciée.
Marie-Françoise Grislin pour Hebdoscope