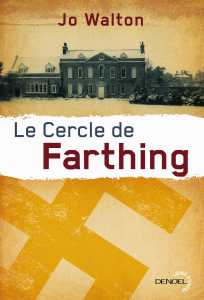 Et si les nazis avaient signé la paix avec la Grande-Bretagne ? Réponse dans ce roman palpitant
Et si les nazis avaient signé la paix avec la Grande-Bretagne ? Réponse dans ce roman palpitant
Depuis le choc Fatherland de Robert Harris en 1992, les uchronies ayant pour thème la victoire des nazis après leur entente avec les puissances alliées et la solution finale n’ont eu de cesse de fasciner de nombreux auteurs notamment anglo-saxons. Ainsi l’écrivain C-J Sanson, bien connu pour ses romans policiers au temps d’Henry VIII imaginait déjà le renversement de Winston Churchill en 1941 et son remplacement par un gouvernement favorable à une paix avec les nazis (Dominion, Belfond, 2014).
Dans le cercle de Farthing de Jo Walton, romancière britannique connue dans le monde entier pour son Morwenna qui a remporté les principaux prix de science-fiction et de fantasy (Hugo, Nebula), nous sommes en 1949 et effectivement, la frange du gouvernement de sa Majesté favorable à une paix avec Hitler, a réussi à changer le cours de l’histoire. L’instable Churchill n’est plus qu’un lointain souvenir et les hommes appartenant au cercle de Farthing – lieu où s’est décidé ce putsch – qui ont sauvé l’Angleterre d’un conflit éprouvant et qui ne cachent pas leur antisémitisme, se réunissent dans une vieille demeure appartenant à une famille de l’aristocratie britannique pour y célébrer leur grande œuvre.
L’atmosphère qui rappelle Gosford Park prend vite une tournure inquiétante lorsque l’homme de la paix avec Hitler, Sir James Thirkie, est retrouvé sans vie. Dans cette enquête qui commence et qu’on ne quitte à regret que le sommeil venant, un coupable est vite trouvé : David Kahn, le mari de Lucy, membre de la famille d’Eversley et hôtesse de la réunion. Car sur le corps de la victime, on a retrouvé l’étoile jaune (et oui, en Angleterre, ils la portent aussi !). Un inspecteur de Scotland Yard est dépêché sur place pour tenter de résoudre cette enquête dont l’issue ne fait guère de doutes.
Et pourtant ! C’est sans compter avec le talent de Jo Walton qui nous conduit à douter en permanence et nous emmène sur des fausses pistes. Dans le même temps, l’auteur déroule sous nos yeux cette société britannique qui, figée dans ses codes sociaux, s’est transformée au contact de l’idéologie fasciste, en haine des classes tout en bafouant les libertés individuelles avec la bénédiction du gouvernement.
Sorte de conférence de Wannsse à l’envers où avait été décidée à Berlin la solution finale de la question juive, le cercle de Farthing se situe dans le cadre classique de l’uchronie entre le roman policier et le drame. Il y a parfois du Agatha Christie dans ces pages. Avec ce premier tome d’une trilogie baptisée « le subtil changement », le cercle de Farthing est un roman en tout point réussi. On attend en tout cas avec impatience la suite de cette histoire réinventée et pas si irréelle que ça…
Jo Walton, le cercle de Farthing, Denoël, coll. Lunes d’encre, 2015
Laurent Pfaadt


