 Adlène Meddi signe
Adlène Meddi signe
un polar choc sur la
décennie sanglante
en Algérie
Les hommes meurent
mais leurs ombres
funestes subsistent
et viennent hanter sans cesse les vivants. C’est en substance ce que
semble nous dire Adlène Meddi dans son troisième roman, 1994,
récent prix Transfuge 2018 du meilleur polar francophone.
A l’occasion de la mort en 2004 du colonel des services de
renseignement, Zoubir Sellami, les protagonistes de ce roman
replongent dix ans en arrière, dans le chaudron des sorcières que
constitua la guerre civile algérienne déclenchée après l’interruption
par l’armée du processus électoral suite à la victoire du FIS. Et en
premier lieu, Amin, le propre fils du colonel, interné et son ami,
Sidali, qui a choisi l’exil pour fuir les spectres de cet assassinat, ce
meurtre qui n’a fait que les hanter. Car 1994 c’est d’abord une bande
d’amis fauchée par la haine et la guerre où la frustration amoureuse
d’un adolescent envers la rebelle Kahina et qui ne devait être qu’une
déception passagère, devint dans ce terreau de violence libérée, de
violence étatisée par le propre père d’Amin, une vengeance
sanglante, personnelle. Car ces adolescents qui voient leurs proches
mourir, vont faire le deuil de leur jeunesse pour devenir comme
leurs pères, des bêtes sauvages. « Ils ont incendié notre jeunesse »
concède ainsi, fataliste, l’un des personnages.
Dans une construction narrative assez astucieuse où ces jeunes
assassins sont devenus vieux avant l’heure et où pierre après pierre,
la trame de la mort de Mehdi, le frère de Kahina, jaillit des ruines de
ces vies et de cette nation, et dessine progressivement un mirage
qui ne se dissipe pas. Dressés sur ces ruines, les pères d’Amin et de
Sidali, le premier véritable Achille algérien et le second ayant choisi
l’oubli pour exorciser cette violence qui les a construit, rejoint par le
général Aybak, sorte de Smiley algérien, ne comprennent pas qu’ils
ont abandonnés leurs enfants à ce monde qu’ils ont conquis et
transformé en cimetière.
Amin comme Sidali, Farouk ou Nawfel se retrouvèrent à devoir
porter un passé qui n’est pas le leur dans un présent qui les dépasse.
Constamment au bord de l’abîme, certains y sombrèrent, d’autres se
sauvèrent. Mais, avec cet héritage sanglant, ils se retrouvèrent tous
à faire la guerre : contre les islamistes, contre leurs pères, contre soi-
même. Et à chaque fois la main qu’ils agrippèrent fut tachée de sang.
« On l’a fait juste parce que vous autres, nos pères, nos légions de pères,
nous faites payer le prix ingrat de votre lâche échec, de votre si belle vie à
l’ombre des nuages noirs que avez refusé de voir, décennie après
décennie » lança un Sidali amer.
A travers ce récit d’une jeunesse volée et fracassée, Adlène Meddi
fait le procès des pères fondateurs d’une nation, solidement
installés sur leurs piédestaux, et que des milliers d’enfants ont
entrepris de détruire. Au marteau.
Par Laurent Pfaadt
Adlène Meddi, 1994, Rivages, 334 p.
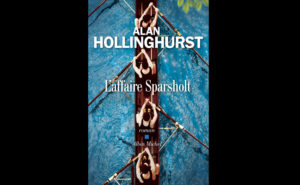 Alan Hollinghurst,
Alan Hollinghurst,
